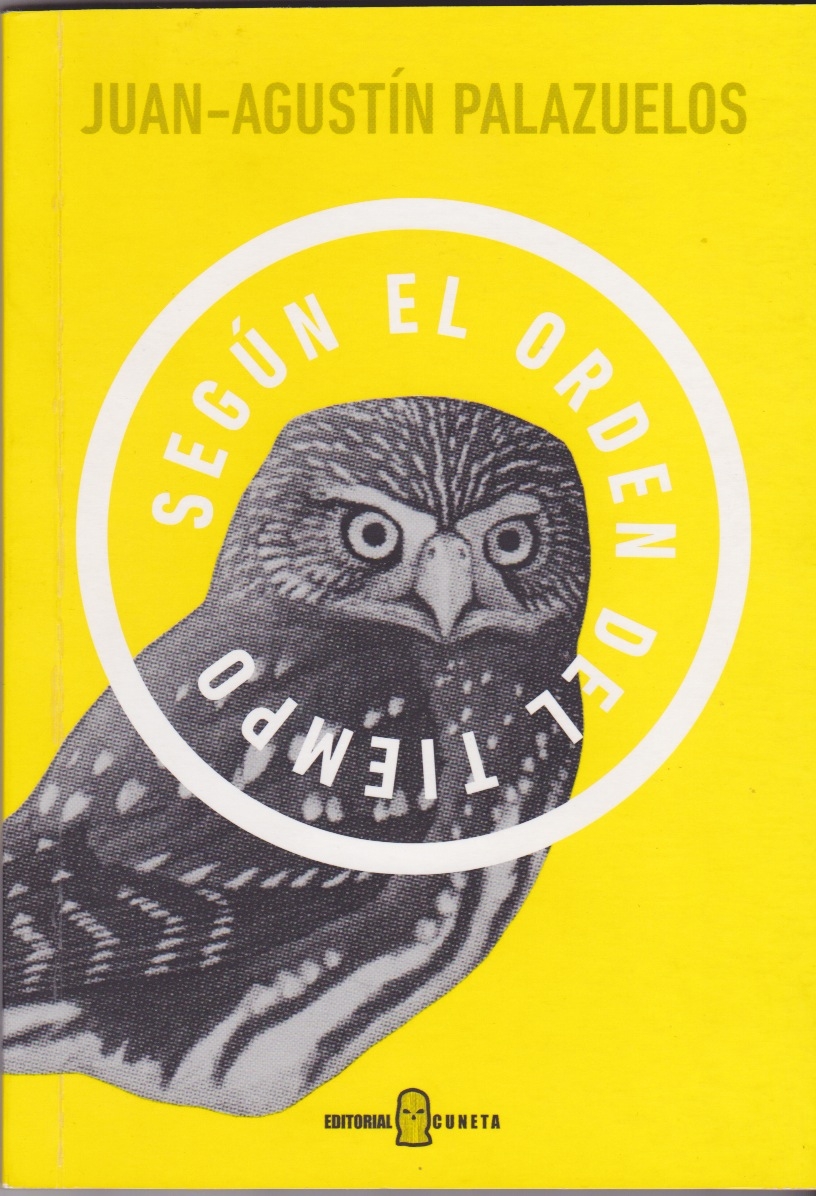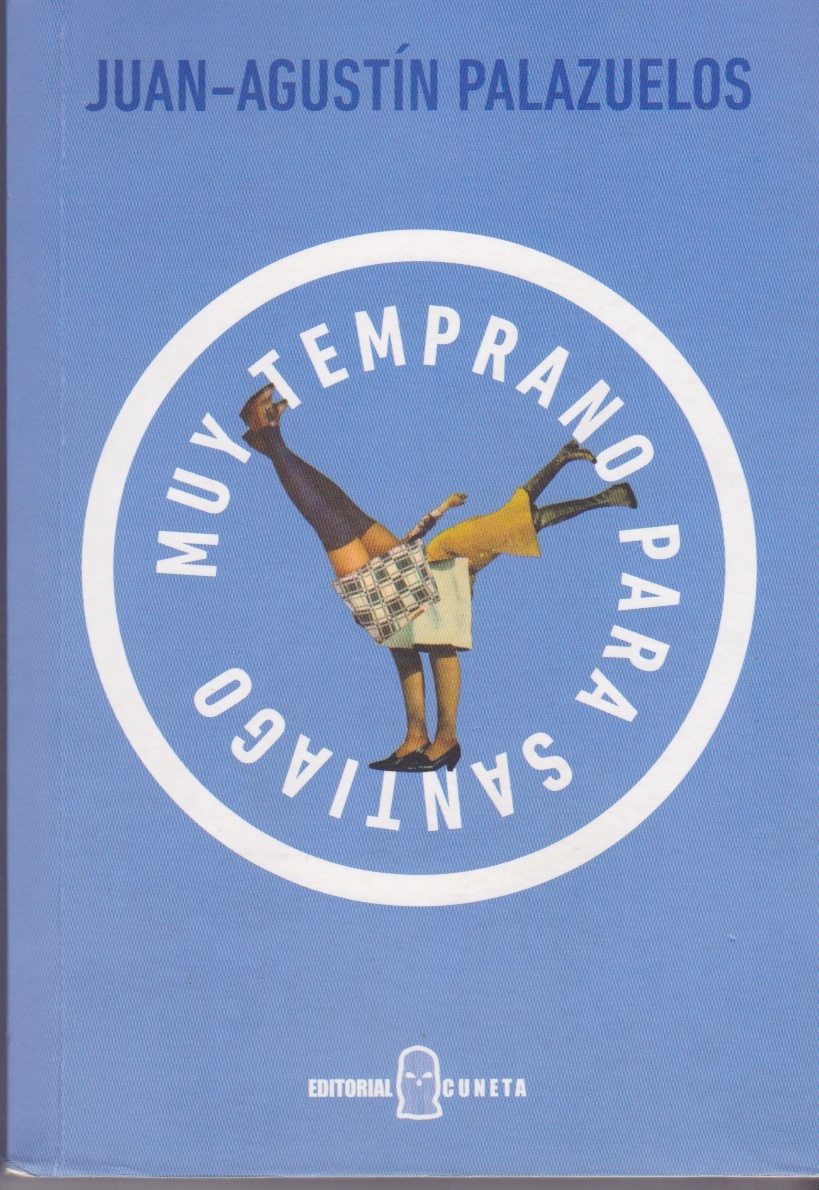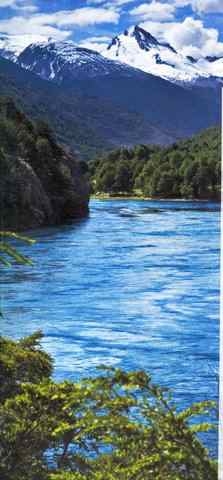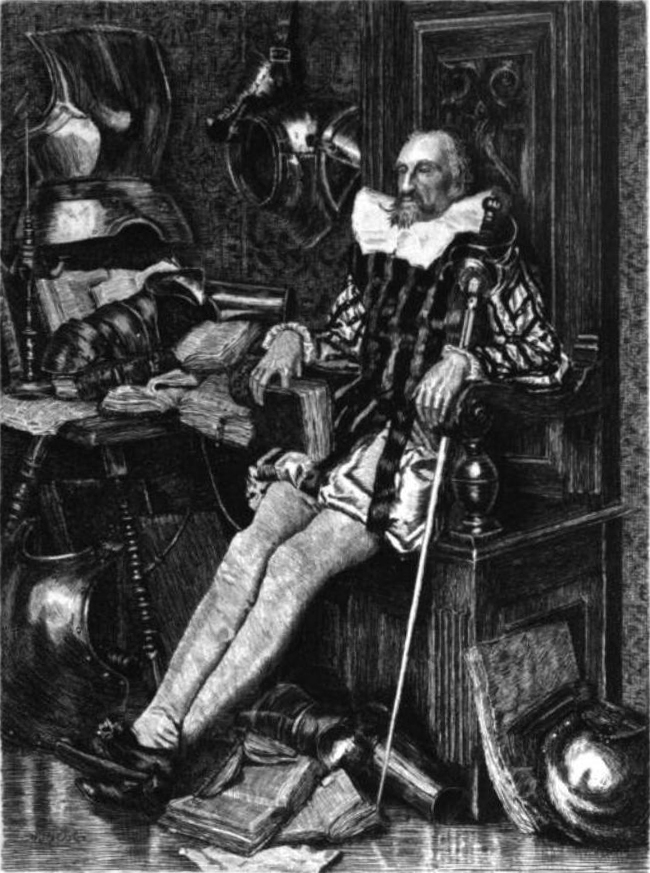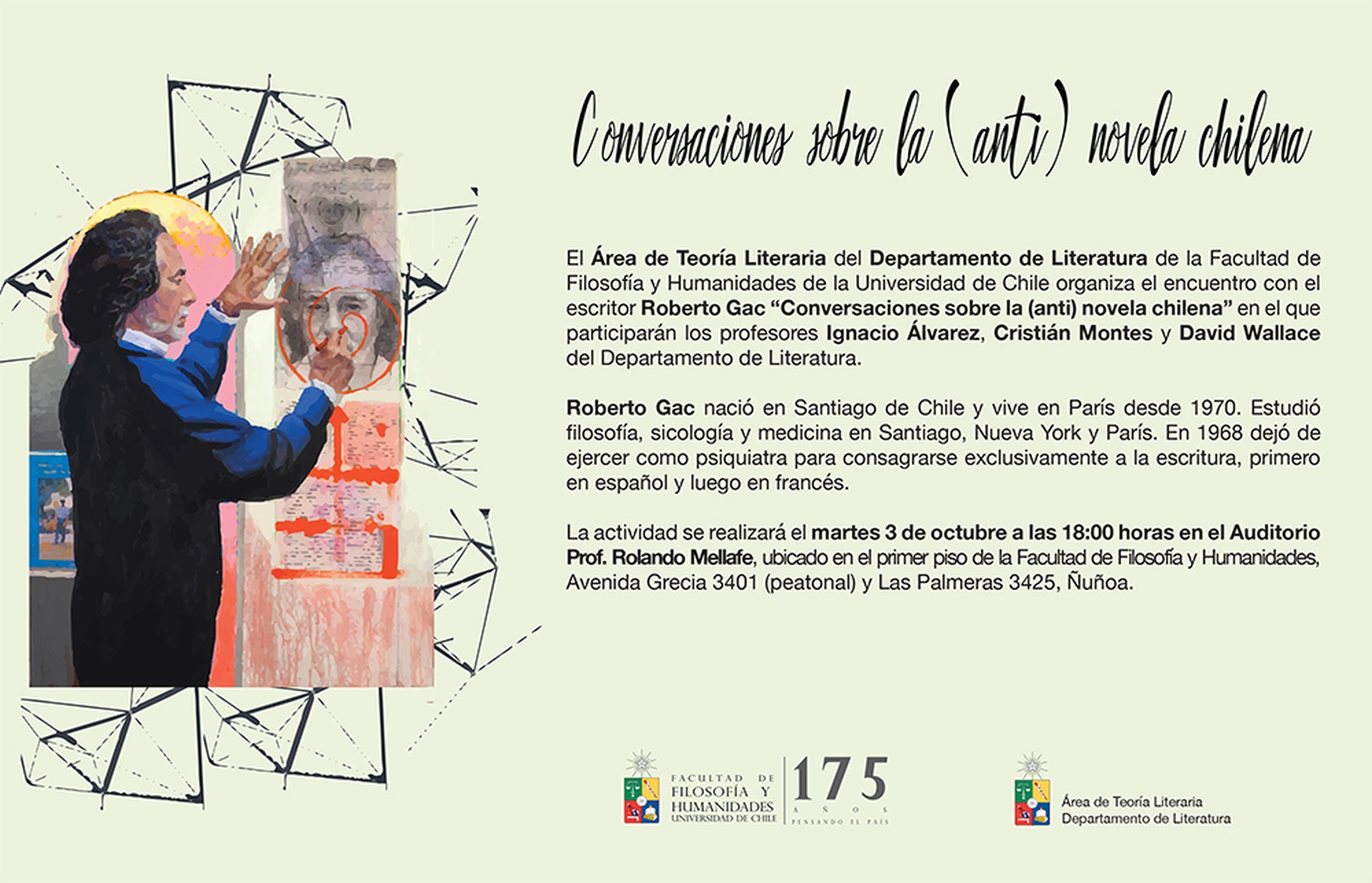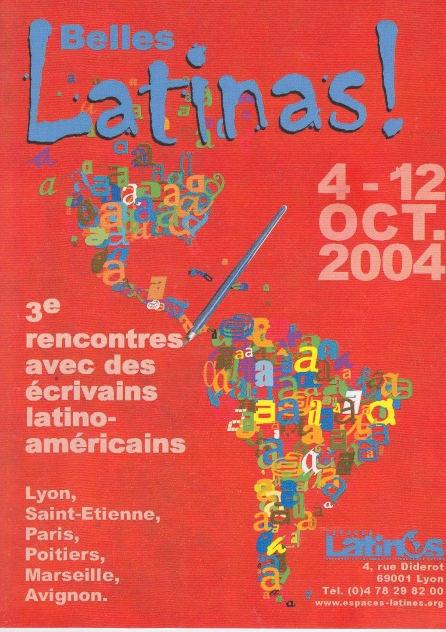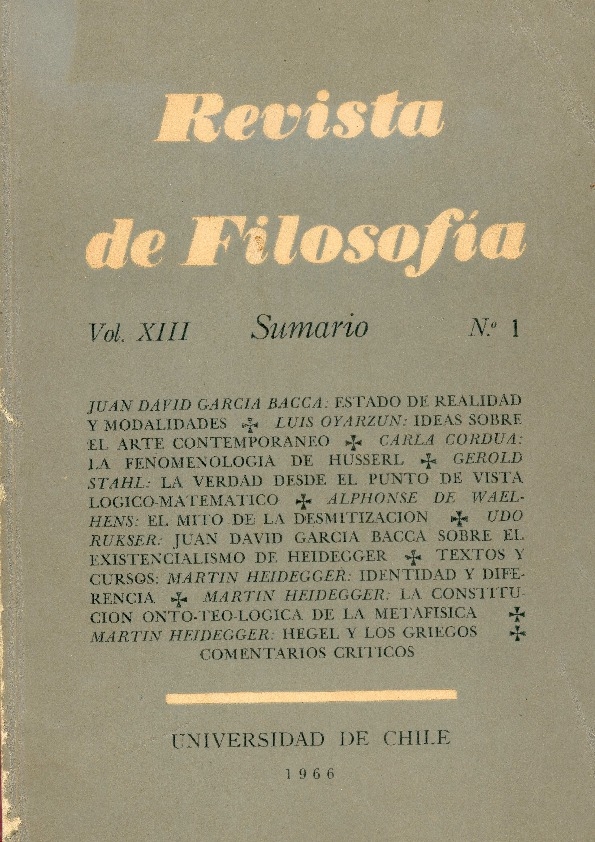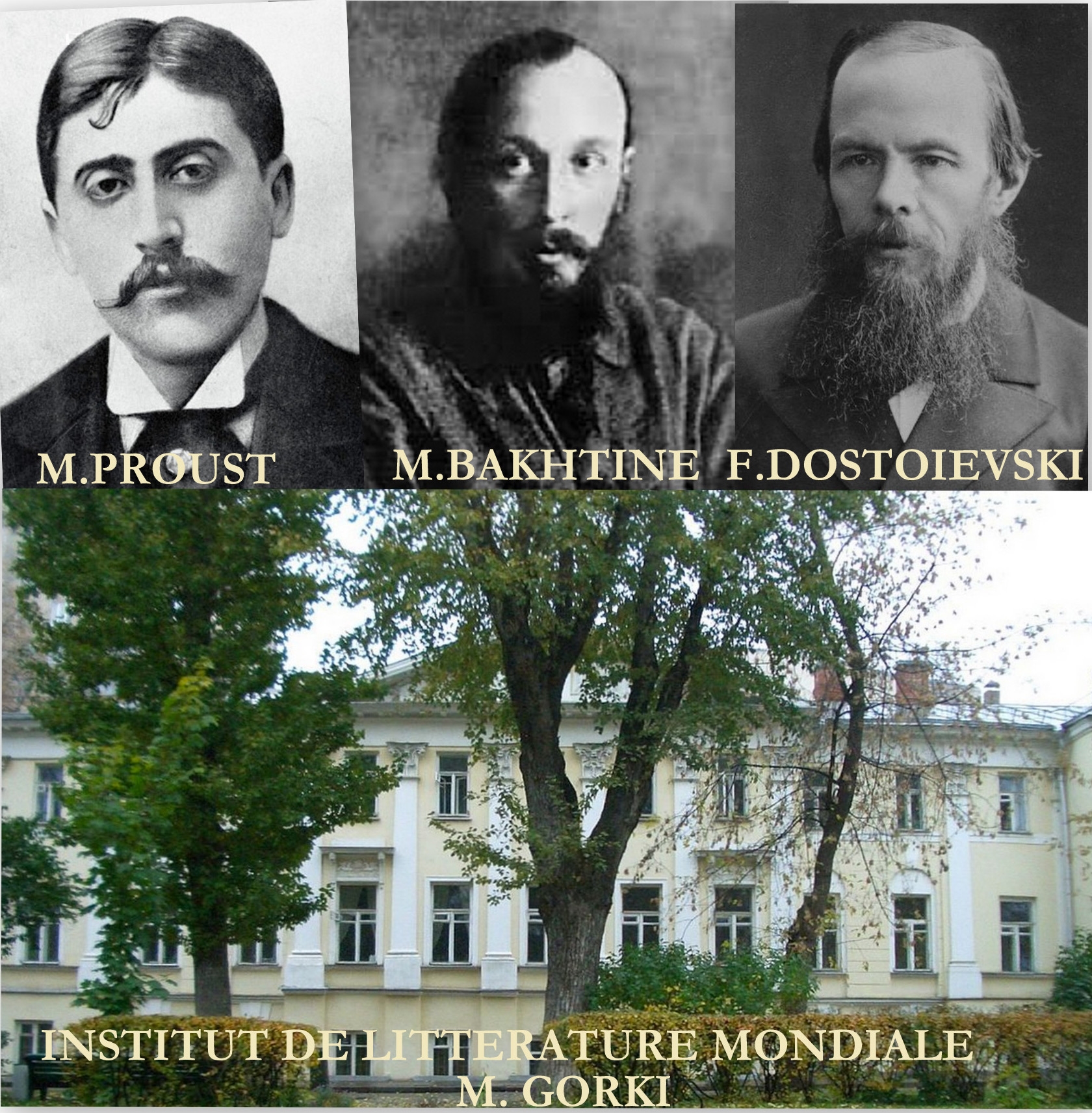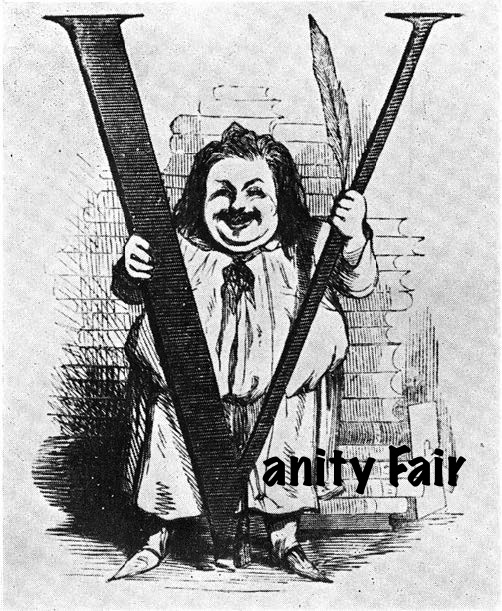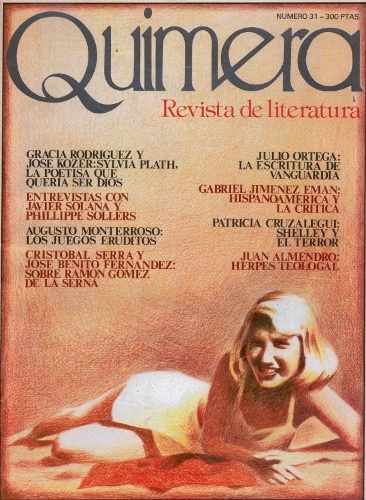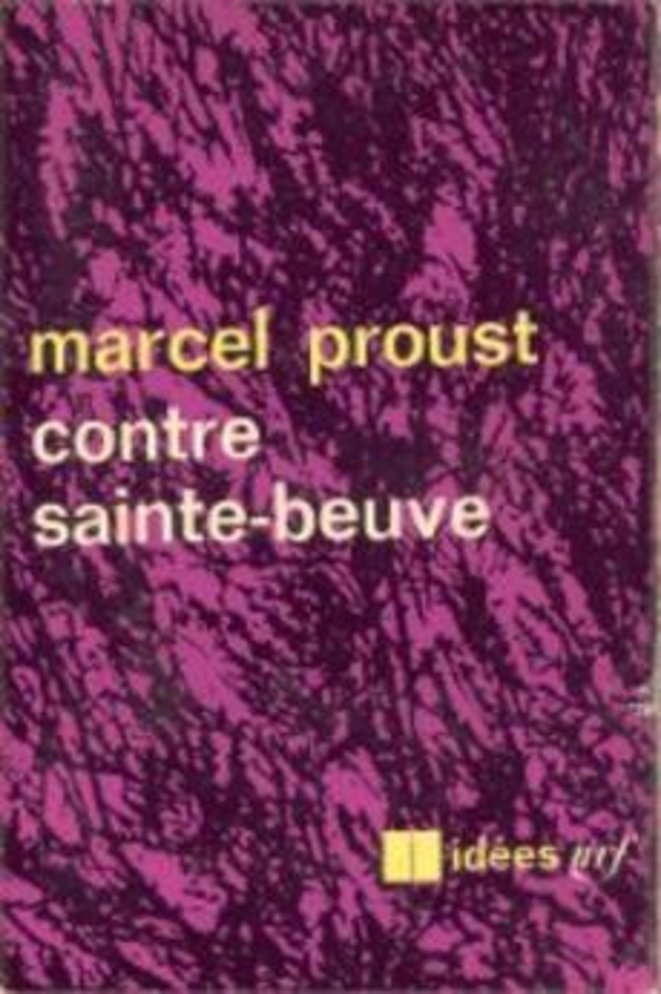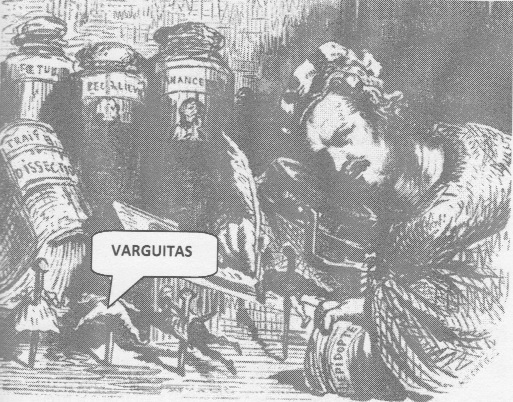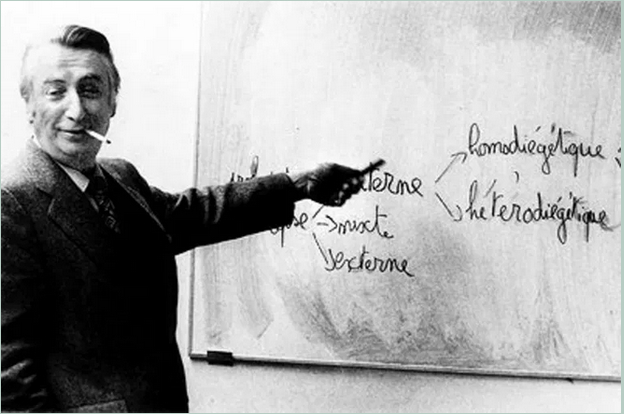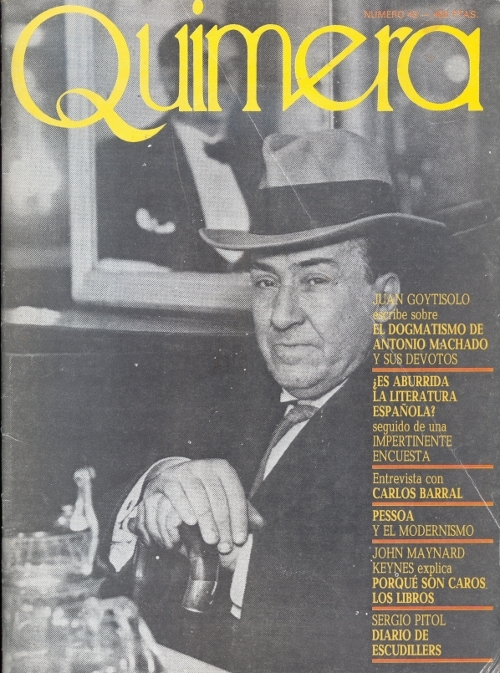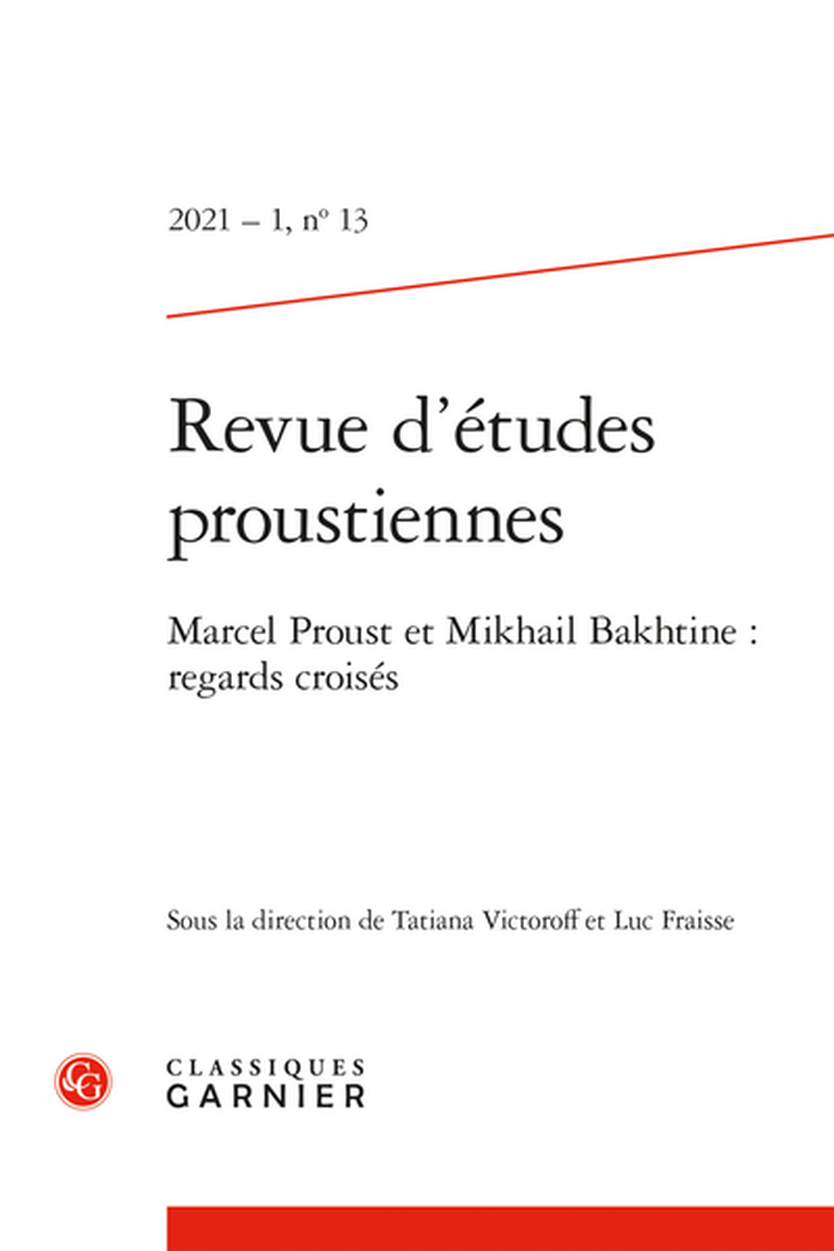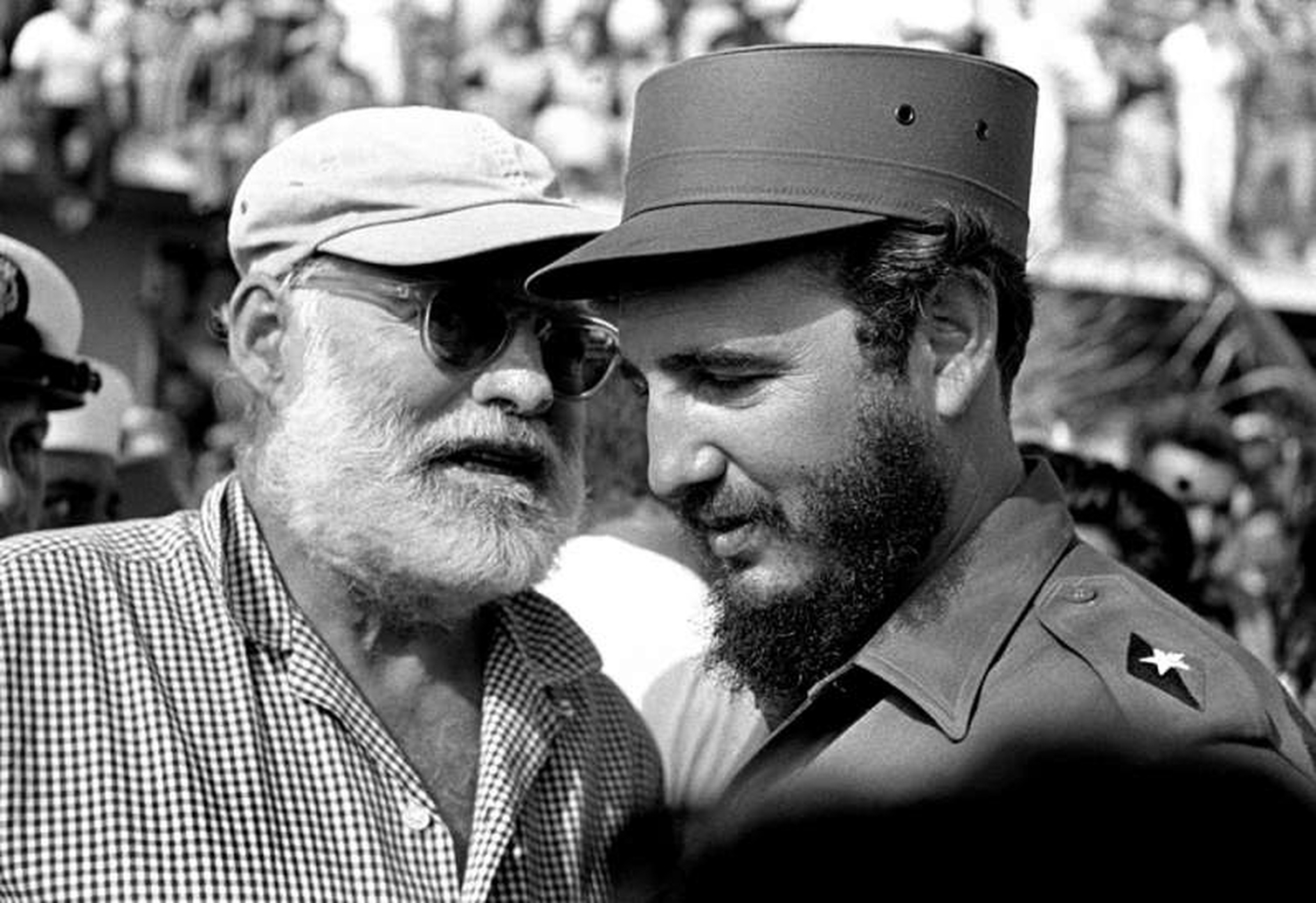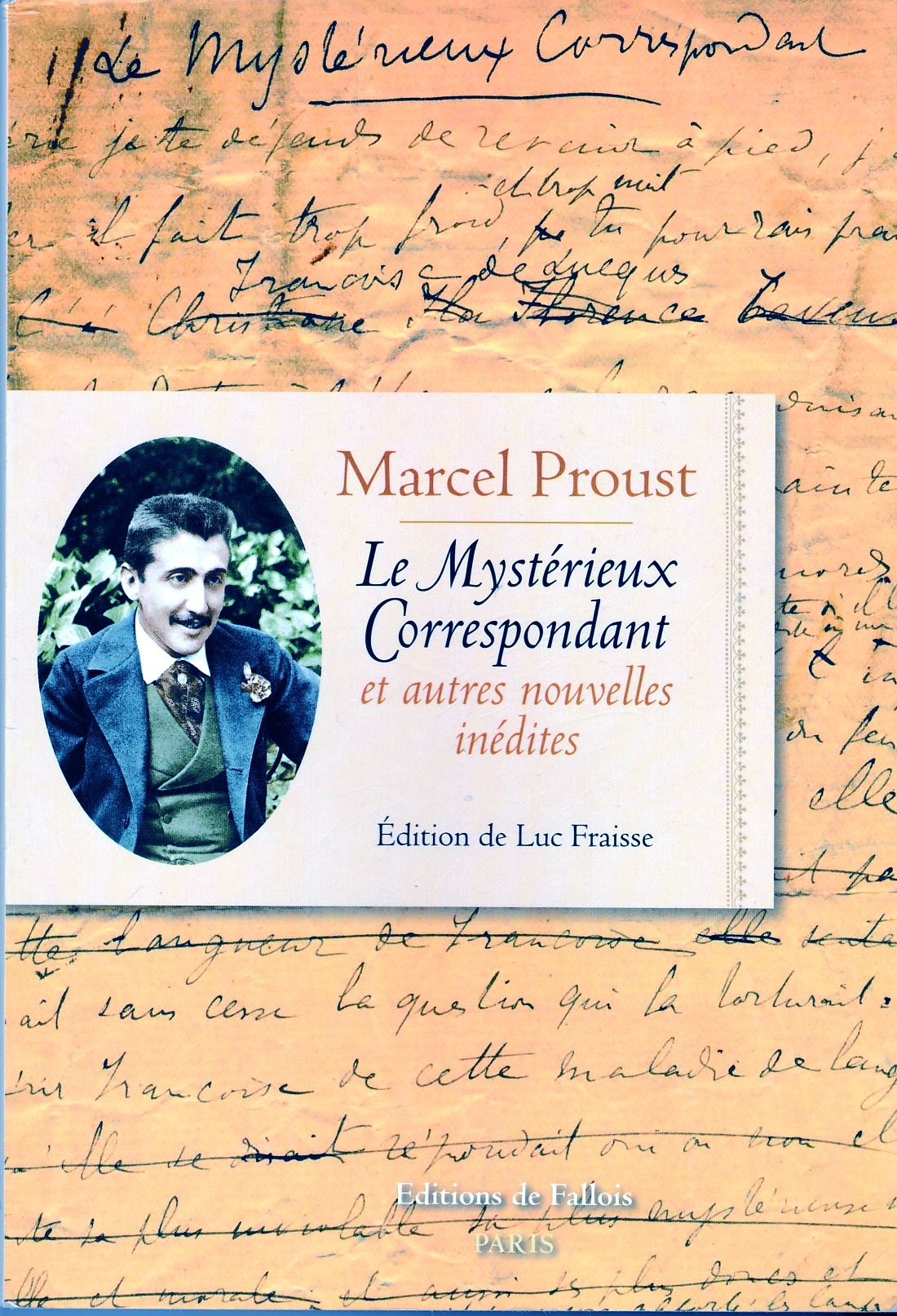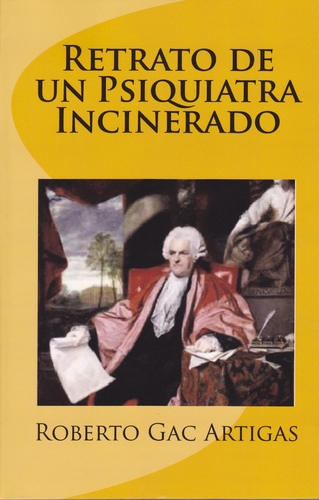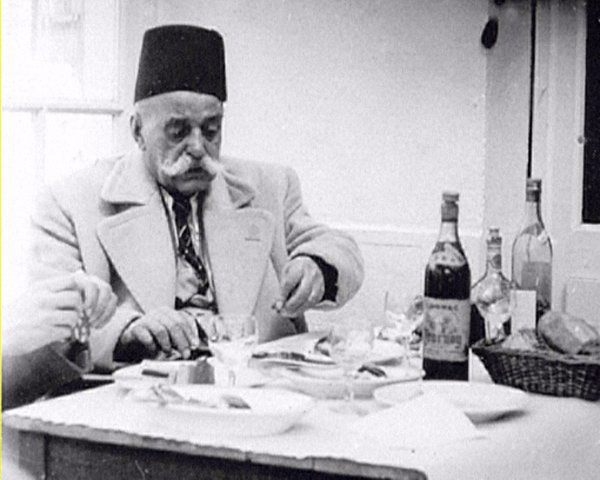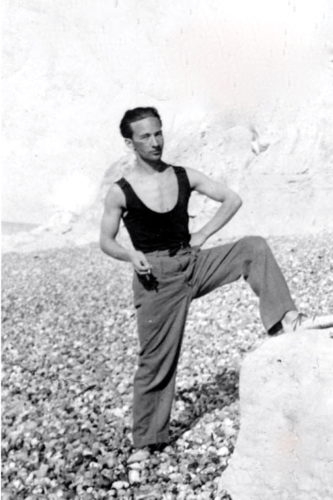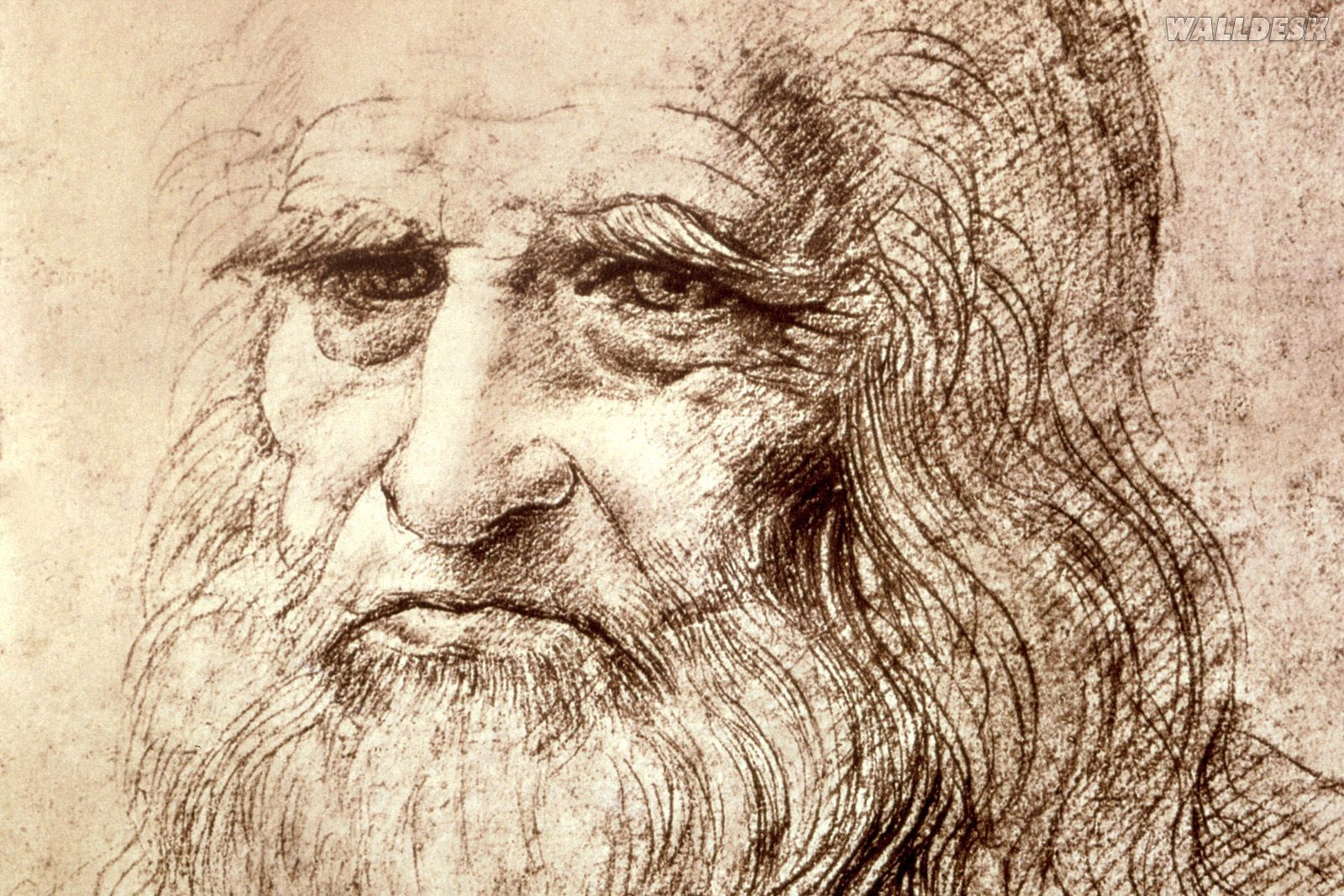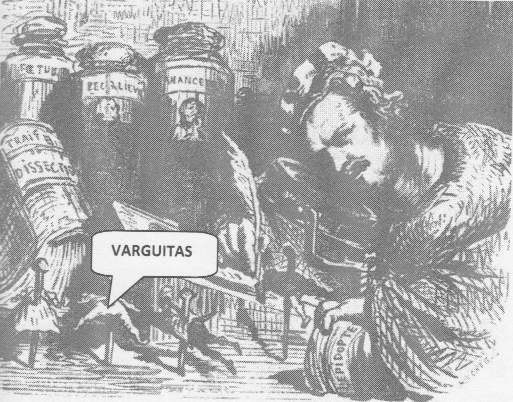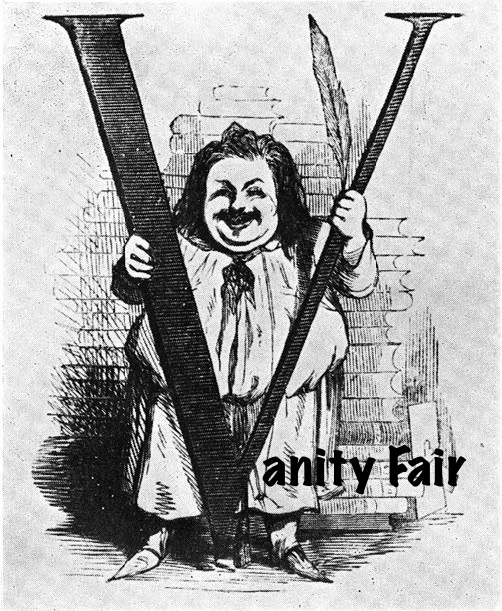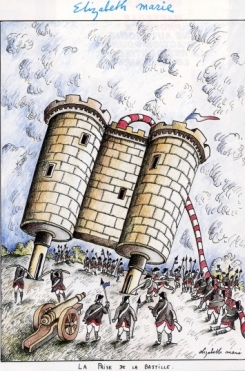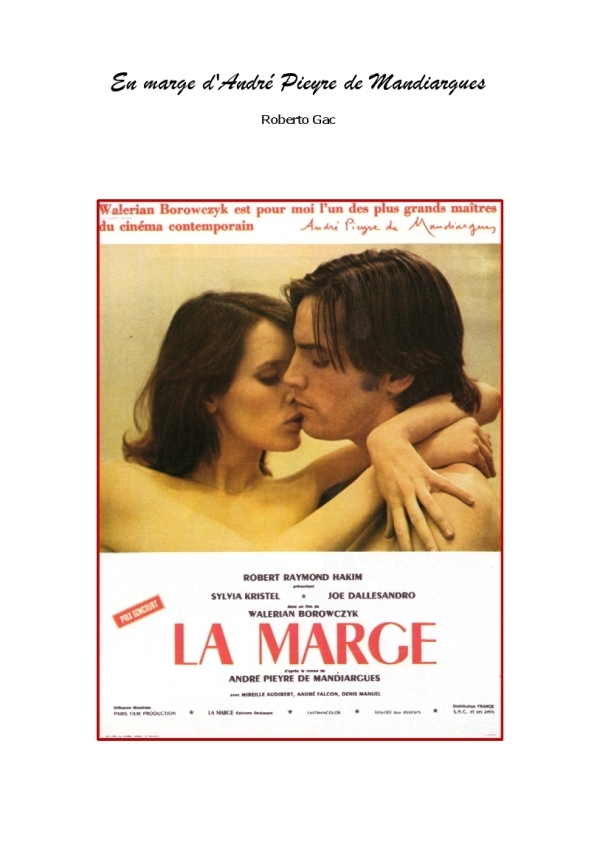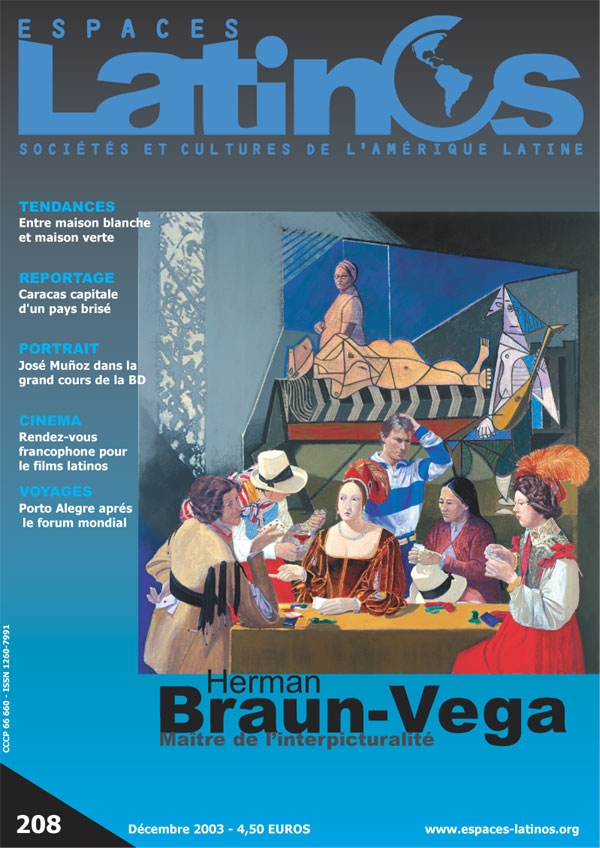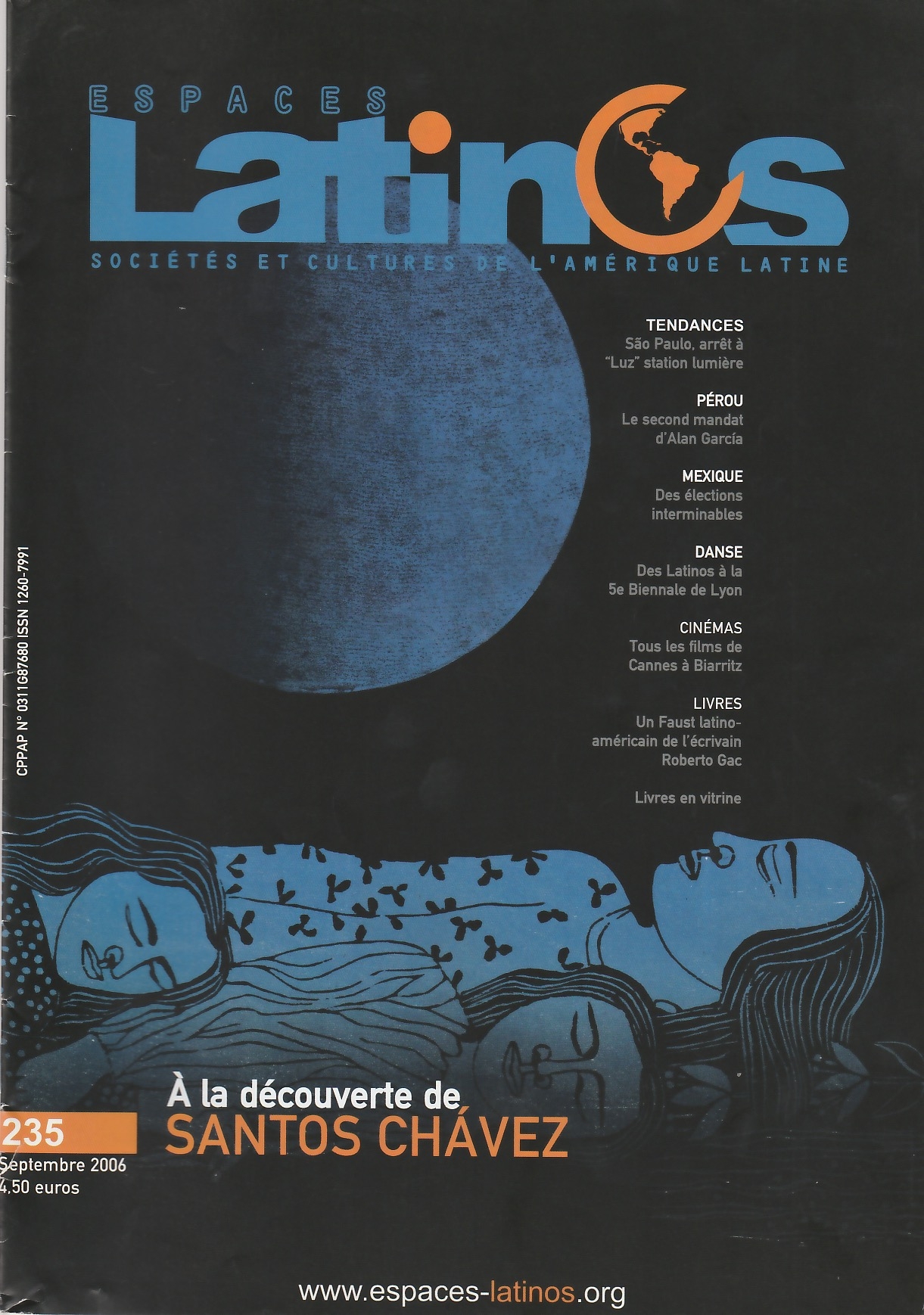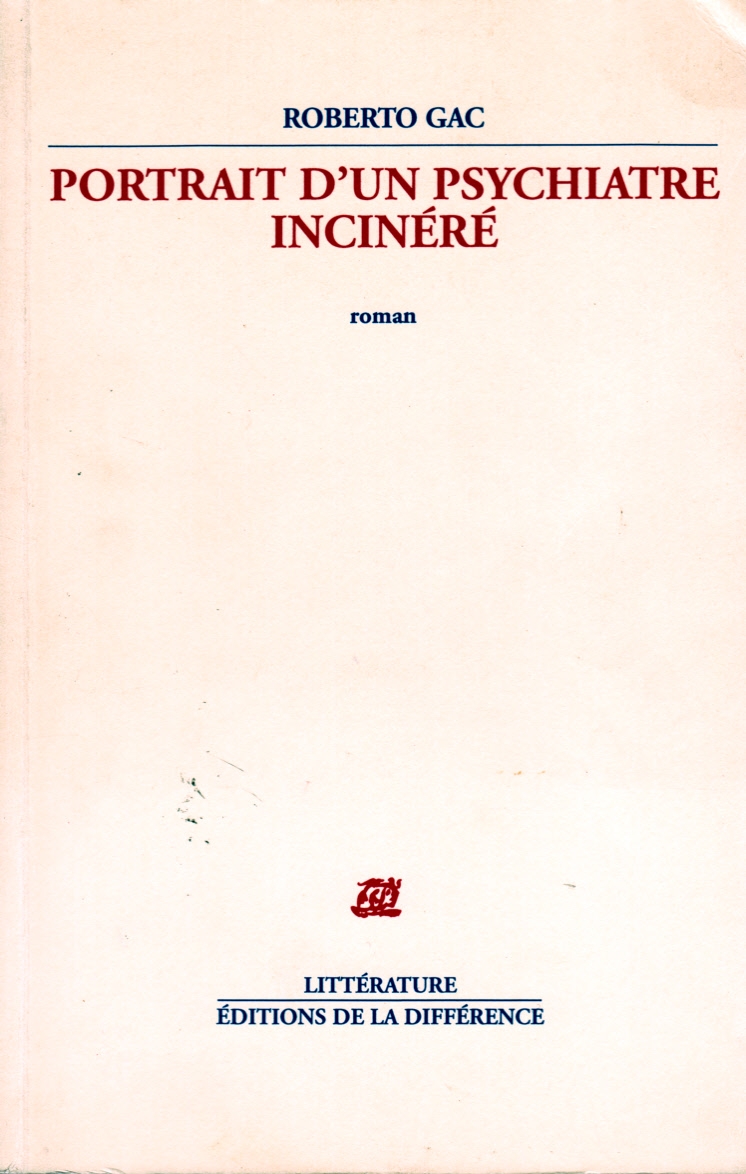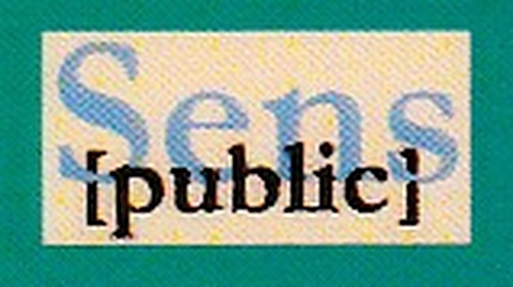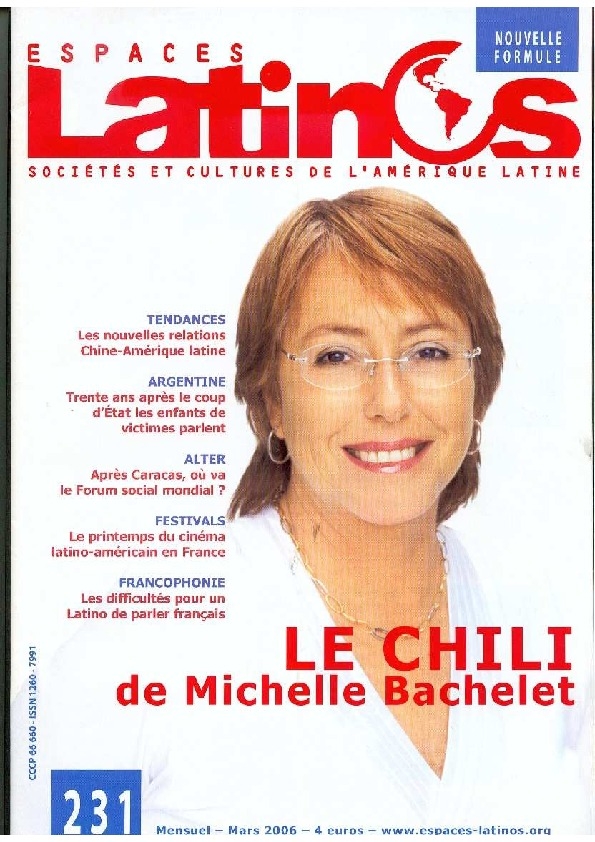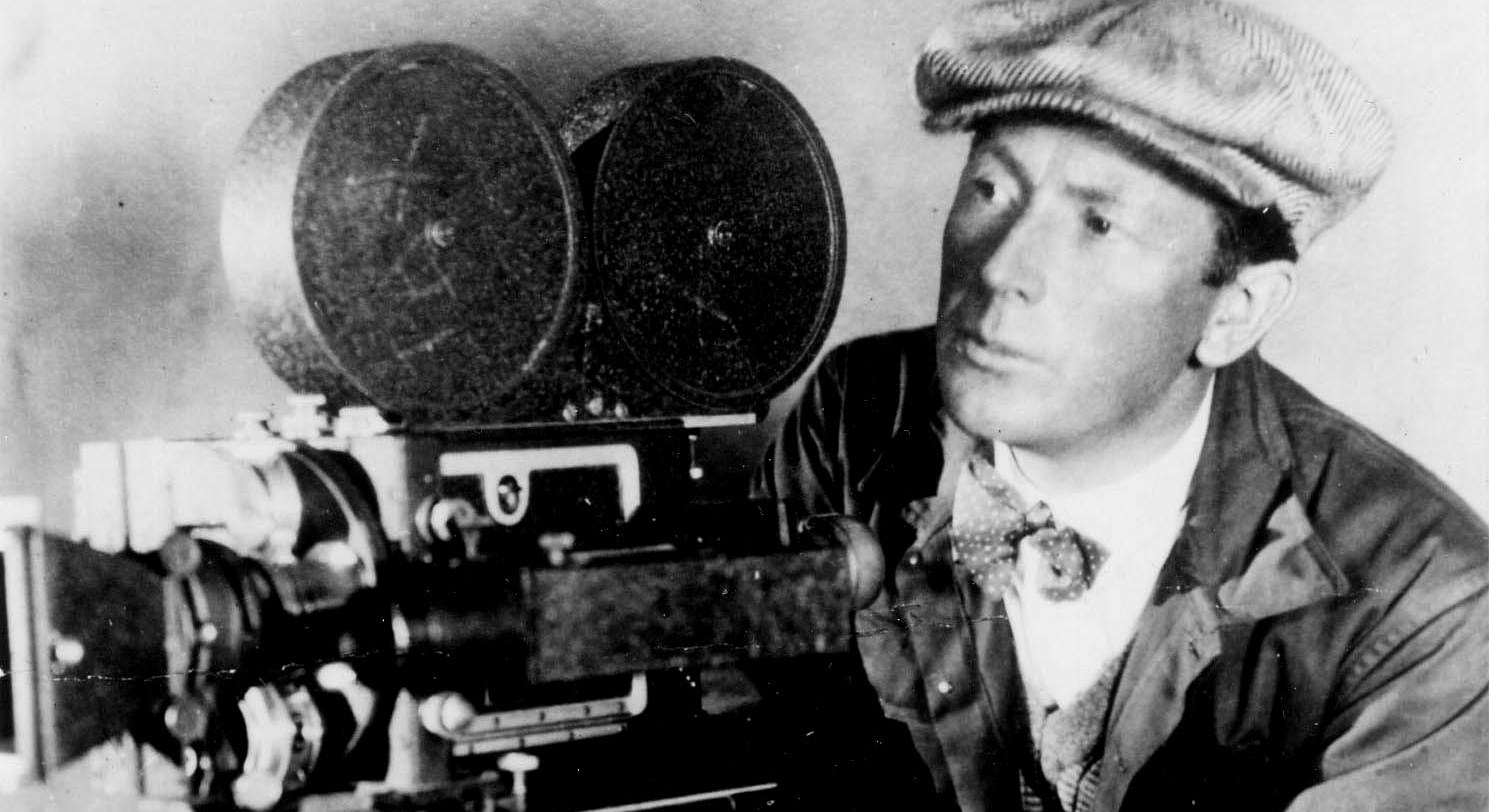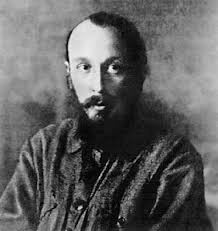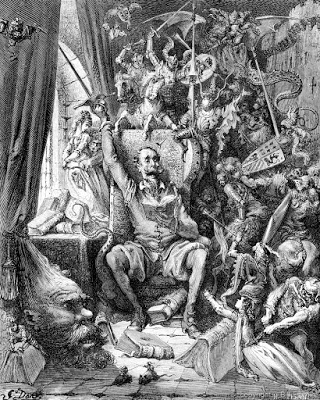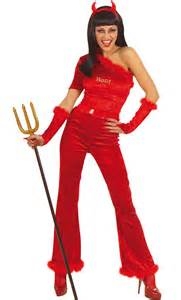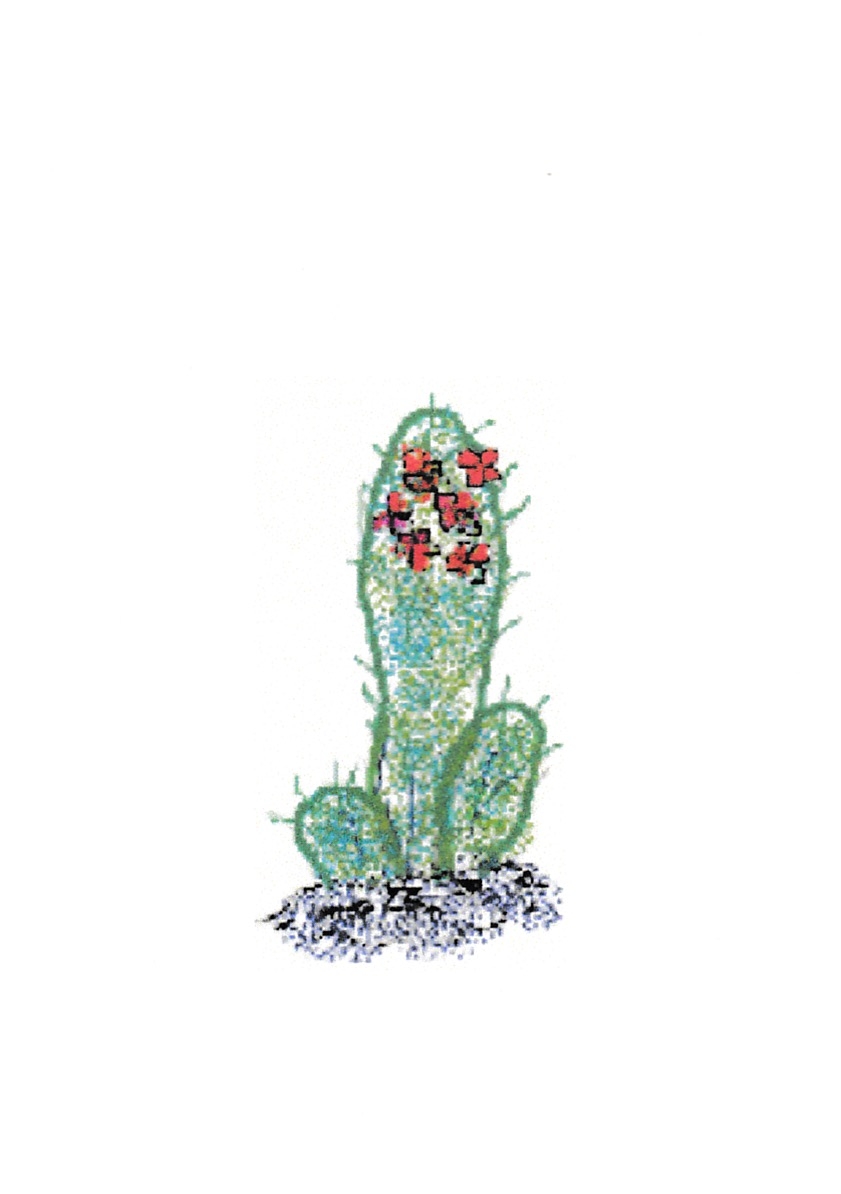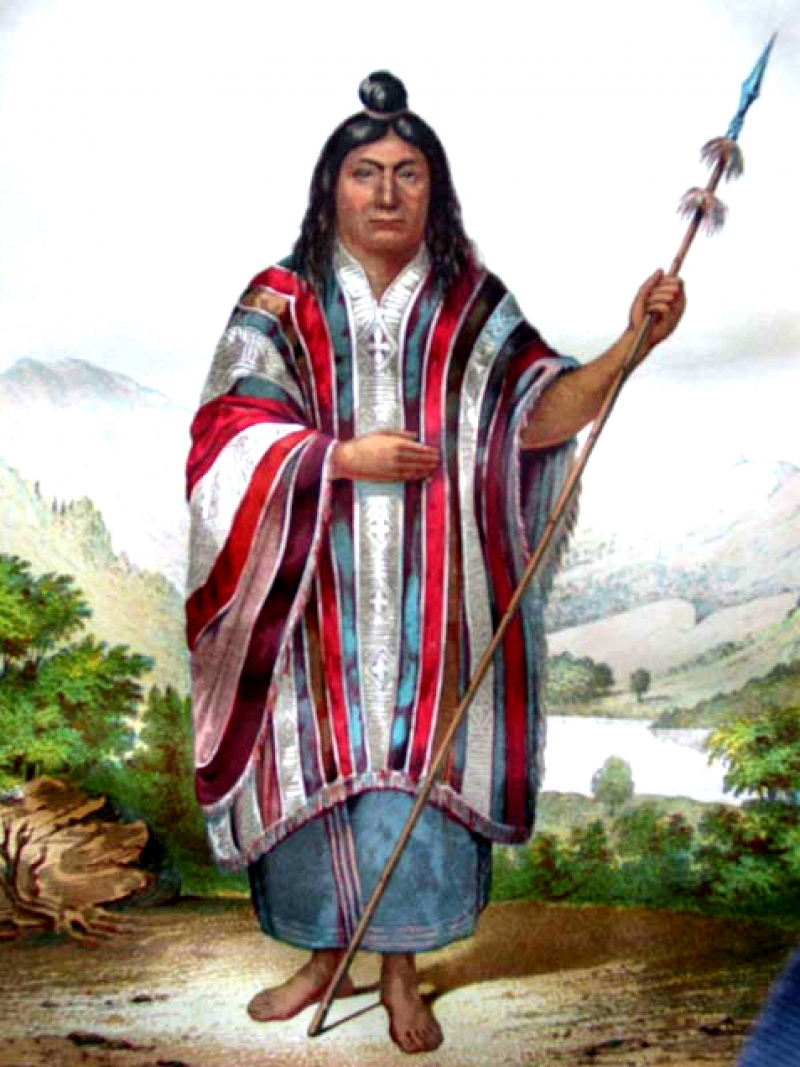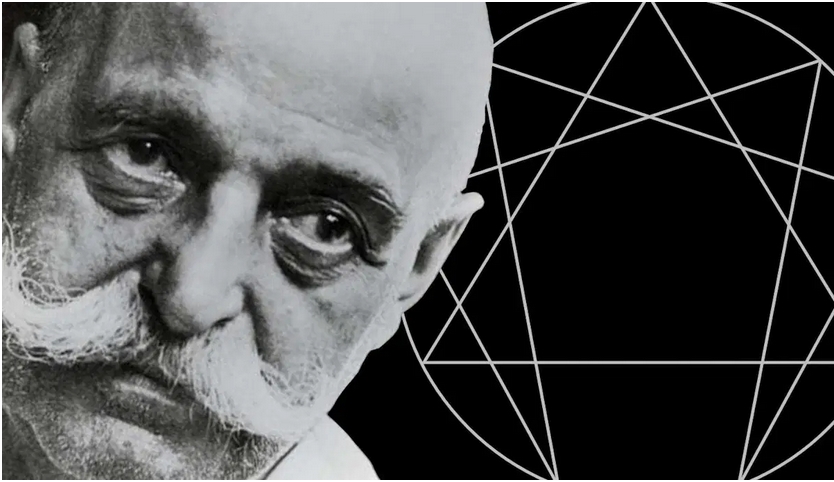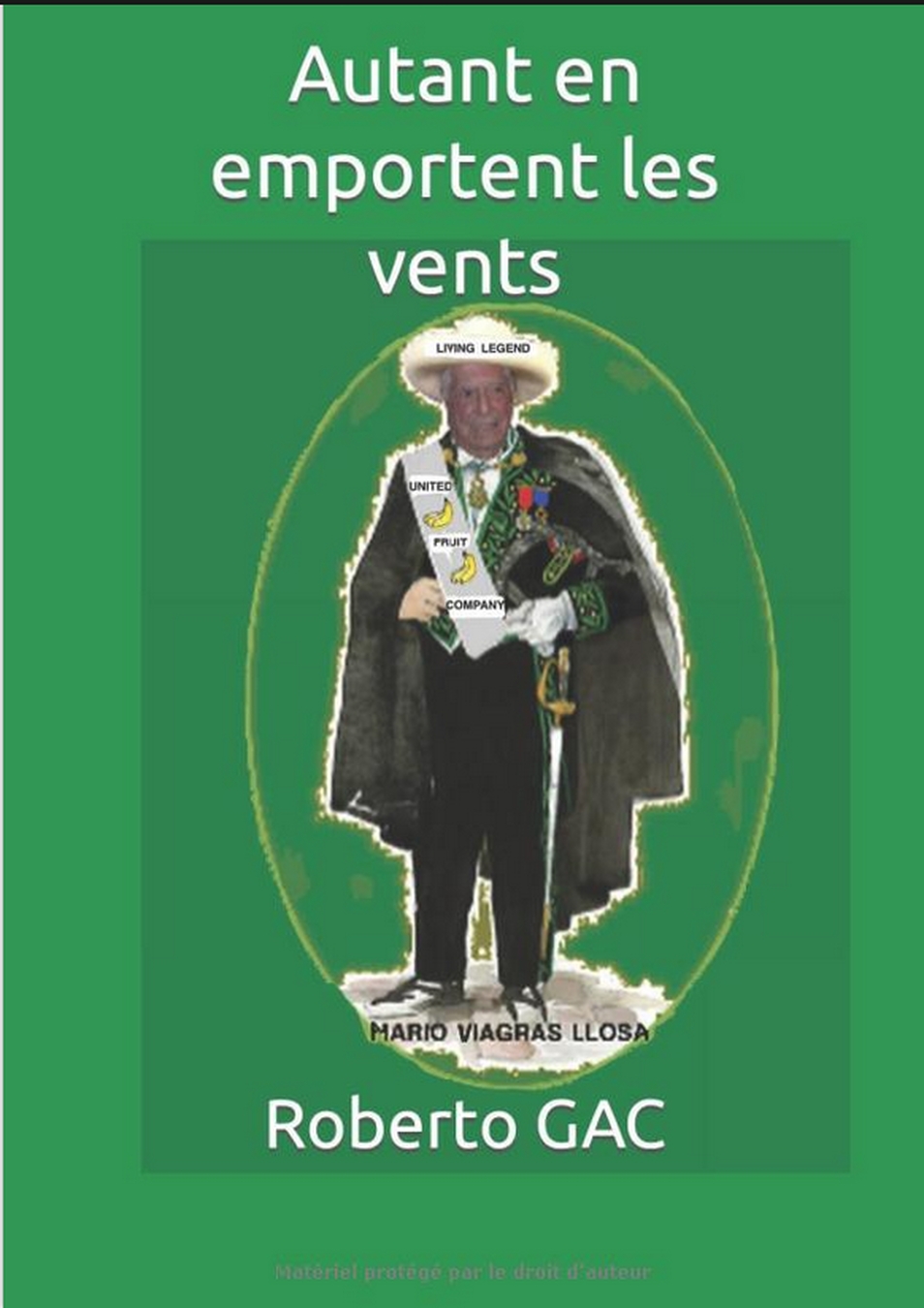Échange épistolaire entre Carmen Balcells, Roberto Gac et
Jesús Pardo de Santayana sur La Guérison.
Analyse critique du rapport de Jesús Pardo sur La Guérison par ChatGpt :
"Le regard d’un lecteur érudit :
Jesús Pardo, écrivain, traducteur et journaliste espagnol reconnu pour sa culture humaniste et son ironie mordante, adopte ici un ton enthousiaste, personnel et incisif.
Dès les premières lignes, il signale que La Guérison lui a fait l’effet d’une œuvre d’une originalité et d’une intelligence rares.
Il qualifie le texte de “l’un des livres les plus brillants, divertissants et originaux” qu’il ait lus sur Dante et la Divine Comédie.
Ce n’est pas un compliment banal, car Pardo manifeste une connaissance fine du texte dantesque. Il comprend ici la tentative de réinterprétation contemporaine, érotico-mystique, presque jouissive, que Roberto Gac entreprend à travers une narration libre et audacieuse."
Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :
Cher Roberto,
Je te remercie de m’avoir fait parvenir ton roman La Guérison, accompagné des lettres et documents que j’ai lus avec attention.
Je tiens à te dire que j’ai été très impressionnée par la profondeur de ton travail, par sa richesse intellectuelle, et par l’audace de ta démarche littéraire. Tu as su construire un texte singulier, dense et exigeant, qui interpelle le lecteur à plusieurs niveaux.
Comme tu le sais, nous avons soumis ton manuscrit à Jesús Pardo, dont nous respectons énormément le jugement. Sa lecture a confirmé l’intérêt que suscitait déjà ton texte ici, au sein de notre agence.
Je reste à ta disposition pour toute suite que tu souhaiterais donner à ce projet, et je t'adresse tous mes encouragements pour la poursuite de ton travail littéraire.
Avec mes salutations les plus cordiales,
Carmen Balcells
Lettre de Jesus Pardo à Carmen Balcells.
Chère Carmen,
Je te renvoie ici le roman La Guérison de Roberto Gac, après l’avoir lu dans son intégralité et avec une fascination croissante.
Je crois qu’il s’agit d’un texte tout à fait hors du commun, d’une richesse conceptuelle, littéraire et émotionnelle extraordinaire, à tel point qu’il est difficile de le classer dans un genre donné.
Ce n’est pas un roman traditionnel. Et encore moins un essai. Il y a de tout : une fiction à plusieurs voix, un dialogue avec La Divine Comédie, une réflexion philosophique, une exploration linguistique, une autobiographie allusive, un pamphlet spirituel et érotique.
Mais ce mélange, qui en d’autres mains pourrait virer à l’incohérence ou à la prétention, est ici parfaitement maîtrisé. Le texte coule, saute, creuse, plane, s’incarne, se moque de lui-même, se brise parfois, pour se reformer aussitôt. Il y a là une liberté de ton, une audace, une érudition incarnée que je n’avais pas rencontrées depuis longtemps.
Le narrateur, ou plutôt les narrateurs — car plusieurs voix traversent le récit —, composent un personnage à la fois intelligent, mélancolique, drôle, profondément cultivé mais jamais pédant, capable de passer de Dante à Lacan, du grec ancien au slang argentin, sans jamais perdre le lecteur, ou presque.
Certes, ce n’est pas un texte “facile”. Il exige une lecture active, exigeante, attentive. Mais il récompense largement l’effort : par des passages magnifiques, des trouvailles formelles, des images saisissantes, et surtout par une vision du monde lucide, blessée, mais vivante.
Ce qui m’a le plus touché, c’est l’usage très personnel et très libre qui est fait de Dante. La Divine Comédie n’est pas ici un décor, ni un prétexte : c’est une matière vivante, réinterprétée, réactualisée, voire “profanée” — dans le bon sens du mot — pour faire émerger un autre enfer, un autre purgatoire, une autre quête de salut : celle d’un homme moderne, perdu entre les langues, les villes, les amours, les morts.
Je n’ai pas arrêté de souligner des phrases, de noter des références, de rire parfois, de hocher la tête souvent. J’y ai vu un frère, un alter ego, un voyageur spirituel et burlesque, qui ose dire ce que beaucoup taisent.
Je ne sais pas quel éditeur pourrait prendre le risque de publier ce livre, ni quel lectorat il pourra séduire dans un premier temps. Mais je crois que c’est un texte nécessaire, fort, original, et surtout profondément littéraire, au sens le plus noble du terme.
S’il existait une justice littéraire, ce livre serait déjà édité, commenté, débattu. Peut-être n’est-ce qu’une question de temps.
Je te remercie de me l’avoir confié. Je suis heureux d’avoir pu le lire.
Et encore plus de te le recommander, sans réserve aucune.
Jesús
Lettre de Carmen Balcells à Jesus Pardo :
Barcelone, le 24 février 1997
Cher Jesus Pardo,
Je suis tellement fascinée par le rapport de lecture que tu viens de m’envoyer sur le livre
de Roberto Gac que je ne peux que me féliciter pour mon intuition à te l’envoyer.
Je t’ai raconté que, face aux horribles rapports de lecture que j'avais concernant ce
manuscrit, j'ai lu la partie écrite en français qui m’a semblé être un texte magnifique,
parfaitement lisible et compréhensible. Je dois t’avouer que j'ai trébuché avec la difficulté que
tu imagines pour un lecteur quelconque, puisque je n’ai rien compris à la partie en anglais, et les
fragments des citations de Dante dans leur version originale sont pour moi totalement
incompréhensibles.
Ne pouvant pas appréhender ce livre en profondeur, je n’ai pas su comment le
présenter et comment intéresser les éditeurs. Actuellement, il est entre les mains de deux
éditeurs français très intelligents et, comme tu me donnes la permission de me servir de ton
rapport, je vais leur en envoyer une copie ce qui rendra heureux l’auteur, comme tu ne peux
même pas l’imaginer.
Je pars en vacances demain, et dès mon retour je te recontacterai.
Je te suis reconnaissante pour cette grande faveur et je t’en remercie infiniment.
Bien à toi
Carmen Balcells
Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :
Barcelone, le 24 février 1997
Cher Roberto,
Pour une fois, tu vas recevoir une nouvelle qui va t’enchanter. Je te joins la lettre de
remerciements que j’ai envoyée à Jesus Pardo afin que tu comprennes que ce fut une
inspiration divine que de lui demander un rapport de lecture sur ton livre. Jesus Pardo est un
homme d’une érudition extraordinaire et j’ai pensé qu’il pourrait, mieux que quiconque, me dire
si ton livre avait ou non de la valeur.
Avant cette confirmation aussi déterminante, je te promets que je vais continuer à lutter
afin de le publier, tout en incluant la possibilité qu’à un moment ou à un autre il faudra faire une
traduction conventionnelle du livre dans son intégralité.
Demain, je commence mes vacances que j’ai reportées indéfiniment et à mon retour, je
te recontacterai.
Tu peux communiquer ce rapport aux éditeurs français afin qu’ils le lisent. Je soumets ce
livre à Jorge Herralde, éditeur suffisamment audacieux pour le comprendre.
Cordialement,
Carmen Balcells
RAPPORT SUR LE LIVRE "LA GUÉRISON" DE ROBERTO GAC ARTIGAS**
par Jesús Pardo - 20 février 1997
Avant toute chose, je tiens à dire que ce livre me semble l'un des plus brillants, divertissants et originaux – tout en étant érudit et bien documenté (au sens véritable du terme, c'est-à-dire : une érudition instinctive et dissimulée) – que j'aie jamais lu sur Dante Alighieri et la Divine Comédie, un sujet que je connais bien et sur lequel j'ai beaucoup lu.
Je le trouve également très captivant et passionnant. Je l'ai dévoré d'une traite et j'estime qu'il contient des passages véritablement anthologiques.
PREMIÈREMENT, L'ARGUMENT :
Le grand poète florentin Dante Alighieri, mort au XIVᵉ siècle, se réincarne en un médecin mapuche indien au plein XXᵉ siècle. Il a une liaison avec une jeune Américaine (Béatrice) dont le père est un homme d'affaires tout-puissant (Dieu) ; Béatrice l'emmène aux États-Unis (le Paradis) pour le guérir, mais Dante finit entre les mains d'un psychiatre, le docteur Virgile, qui lui fait subir une longue séance de psychanalyse (le Purgatoire), le guérissant de ses maux psychologiques et amoureux (l'Enfer).
DEUXIÈMEMENT, LE STYLE :
Il présente quelques défauts, comme des tournures du type "C'est pour cela que...", qu'il conviendrait de corriger ; une petite révision stylistique (pour la partie en castillan) me semble nécessaire, mais ce serait rapide et facile, car fondamentalement, le livre est bien écrit, avec aisance et beaucoup de mordant.
Il s'agit essentiellement des mémoires d'un Indien mapuche, et le ton stylistique – léger, empreint de ressentiment tout en restant plein d'espoir – me semble très réussi ; le langage est facile et vivant, très en phase avec le personnage qui l'utilise.
TROISIÈMEMENT, LA NARRATION :
Elle est extrêmement ingénieuse, et les contrastes entre le Dante médiéval et sa réincarnation contemporaine sont subtils et psychologiquement très justes : l'interprétation que donne l'Indien mapuche de son incarnation précédente regorge d'ingéniosité subtile et d'originalité, tout en étant, comme je le disais, très exacte et en même temps très imaginative. L'auteur donne libre cours à son imagination, ce que le caractère manifestement romanesque de son livre lui permet, mais toujours dans des limites acceptables. Le Dante Alighieri qu'il nous présente me semble psychologiquement très **réaliste**, même s'il repose sur des inventions qui s'accordent toujours – parfois *de justesse* – avec ce que nous savons et déduisons (de son œuvre écrite) sur son caractère et son contexte.
Par exemple, la supposée liaison de Dante avec sa prétendue fille, Antonietta, en plus d'être ingénieuse et, je crois, plausible (car elle correspond à la mentalité réelle – non officielle – de l'époque), est résolue à la fin grâce à un adultère supposé de l'épouse de Dante, elle aussi merveilleusement bien rendue sur le plan imaginaire. Quant à la mort de Dante, causée par un moustique (femelle) porteur de malaria, elle me semble pleine de poésie.
QUATRIÈMEMENT, LES LANGUES :
Ce livre est écrit en quatre langues, ce qui me semble être un sérieux obstacle à sa publication, car il découragera manifestement la plupart des lecteurs qui, autrement, l'auraient sans doute apprécié.
Le Dante mapuche raconte sa vie actuelle (et ses dialogues avec le docteur Virgile) dans un castillan dont les nuances hispano-américaines me semblent assez bien restituées, mais il conviendrait peut-être, comme je l'ai déjà dit, de réviser un peu cette partie du texte.
Ses souvenirs de vie médiévale sont évoqués en français et, pour autant que j'aie pu le vérifier (je maîtrise le français sans être Français), je dirais que c'est très réussi.
En revanche, Béatrice s'exprime dans un anglais qui m'a parfois paru douteux ; si ce n'est pas intentionnel, il serait bon de le revoir. Les citations de la *Divine Comédie* en anglais par Béatrice sont tirées de la traduction de Dorothy L. Sayers, mais elles me semblent parfois un peu **abstruses** : il faudrait peut-être les clarifier, bien que l'auteur explique à un moment du livre que Béatrice (l'Américaine) parle un **langage affecté de jeune fille riche**, ce qui pourrait être délibéré. Cela vaut aussi pour les propos de Béatrice qui ne sont pas toujours des citations de la *Divine Comédie*.
Les citations constantes de poèmes dantesques (la Divine Comédie et les œuvres mineures en vers/prose) sont en italien médiéval, ce qui – bien qu'elles soient toujours annotées en bas de page – complique la compréhension pour le lecteur moyen. Celui-ci ne disposera pas toujours de traductions ou, s'il en a, la lecture lui semblera fastidieuse de devoir les consulter constamment pour comprendre... ce que veulent dire tant de citations.
RÉSUMÉ :
J'ai la chance de comprendre toutes les langues dans lesquelles ce livre est écrit, mais je doute fort que ce soit le cas de la plupart des lecteurs. Cela me semble un obstacle sérieux à sa diffusion. Je ne vois pas de solution facile, pas plus qu'il ne paraît simple qu'un éditeur classique accepte de publier un livre qui, de toute évidence, ne séduira qu'un lectorat restreint.
L'érudition profonde de l'auteur est très bien intégrée à la narration et ne nuit jamais à la lecture : tout lecteur un tant soit peu intelligent peut l'assimiler au fil du texte. Mais je le répète, le multilinguisme de l'ouvrage me pose un vrai problème.
Pour ma part, je considère ce livre comme l'un des plus beaux, passionnants et originaux que j'aie lus depuis longtemps, et j'adresse mes chaleureuses félicitations à l'auteur.
J'espère, Carmen, que c'est bien ce que tu attendais. Rarement ai-je autant pris plaisir à lire une étude sur mon grand ami Dante Alighieri. Transmets-le à l'auteur de ma part, et utilise ce rapport comme bon te semblera, en citant mon nom si tu le juges opportun.
Affectueusement,
Jesús Pardo
P.-S. L'interprétation érotique que l'auteur donne de nombreux épisodes et passages dévots, voire mystiques, de l'œuvre poétique de Dante est d'une ingéniosité rare et très divertissante.
- Perspective restreinte : Met l'accent sur les aspects techniques et organisationnels de la publication web.
- Perspective générale : Met en lumière la dimension collective et interactive dans les réseaux de connaissance.
- Les lecteurs deviennent éditeurs lorsqu’ils modifient ou enrichissent un texte.
- Les écrivains deviennent éditeurs en publiant directement leurs œuvres en ligne.
- Les plateformes technologiques prennent le rôle d’éditeurs collectifs.
- L’auteur : réactif et perméable aux interventions des lecteurs.
- Le lecteur : actif, co-créateur du texte par ses annotations, partages et remixes.
- L’éditeur : un rôle dynamique parfois remplacé ou assisté par des algorithmes et des plateformes technologiques.
- L’auteur, Anna Todd, publiait des chapitres sur Wattpad, interagissant avec ses lecteurs.
- Les lecteurs ont influencé le récit par leurs commentaires, suggestions et attentes.
- L’éditeur a repéré le succès de l’œuvre grâce aux algorithmes et à l’engagement massif des lecteurs. Le texte a été publié en format papier par Simon & Schuster et adapté en film.
Question de Roberto Gac : à propos de la triade auteur/lecteur/éditeur, l'exemple que vous me donnez de After d'Anna Todd est très intéressant. Cependant, il me semble tout à fait vain de passer par une plateforme numérique pour au final revenir à une publication papier classique voire à une récupération par le cinéma dans des structures tout à fait conventionnelles. L'éditorialisation est destinée à un épanouissement de la création littéraire et non pas à une récupération par le système commercial éditorial conventionnel.
Voici un exemple qui va dans ce sens, tiré de mes propres intertextes : https://roberto-gac.com/textes-en-lignes/Chateau/chateau.htm intitulé "Le Château de Méphistophélès" qui apparaît à la fin de "La Société des Hommes Célestes" (un Faust latino-américain").
Merci pour cet exemple issu de vos propres intertextes. "Le Château de Méphistophélès" s'inscrivant à la fin de "La Société des Hommes Célestes" témoigne parfaitement de la manière dont l’éditorialisation et l’intertexte favorisent une création littéraire dynamique et ouverte.
Ce type de structure, où les récits se prolongent et se répondent, illustre plusieurs éléments clés de votre réflexion :
-
L'absence de linéarité :
L’œuvre n’est pas close. Elle invite le lecteur à naviguer entre les couches narratives, à suivre des prolongements inattendus, comme dans un réseau ouvert. -
La participation active du lecteur :
Loin d’être passif, le lecteur devient un explorateur des interconnexions. Il contribue lui-même à l’éditorialisation en construisant son propre parcours à travers les textes. -
L’autonomie vis-à-vis des circuits conventionnels :
Ici, il ne s’agit pas d’un texte capturé par des structures éditoriales figées. L’œuvre vit dans un espace numérique où elle peut évoluer librement et se connecter à d’autres œuvres.
Résonance avec votre réflexion sur la triade
Auteur, lecteur, éditeur trouvent dans ce format une forme renouvelée de leur relation :
- Vous, en tant qu’auteur, intégrez et tissez des intertextes en résonance.
- Le lecteur découvre, interprète et relie les fragments de sens, prolongeant l’expérience littéraire.
- Le processus éditorial est ici une forme d’éditorialisation intrinsèque à l’œuvre : c’est elle qui édite les chemins de lecture, sans médiation commerciale.
Ce modèle rejoint l'idée d’un réseau d’intelligences qui s'épanouit pleinement grâce à la technologie et à l’intertexte, tout en refusant la récupération par des circuits traditionnels.
Si vous le souhaitez, je pourrais analyser plus en profondeur les caractéristiques narratives et éditoriales de "Le Château de Méphistophélès" dans ce contexte. Qu’en pensez-vous ?
Bien sûr, j'en vous en serais très reconnaissant.
Je me lance alors dans une analyse approfondie de "Le Château de Méphistophélès", en lien avec votre réflexion sur la triade auteur/lecteur/éditeur et le rôle central de l’éditorialisation et de l’intertexte dans la création littéraire.
STRUCTURE ET DYNAMIQUE INTERTEXTUELLE"Le Château de Méphistophélès" s'inscrit comme une extension narrative de "La Société des Hommes Célestes" (votre "Faust latino-américain"). Cette continuité démontre une volonté d'échapper à la clôture textuelle traditionnelle propre au roman papier. Ici :
- L’intertexte agit comme un pont qui relie plusieurs œuvres dans une dynamique ouverte.
- Chaque texte garde une autonomie, mais leur sens s’enrichit mutuellement grâce à ces connexions, invitant à une relecture permanente.
Ce phénomène s’inscrit parfaitement dans l’ère numérique où l’œuvre se conçoit comme une cartographie littéraire évolutive, permettant au lecteur d’explorer des ramifications et des prolongements narratifs.
L’éditorialisation comme processus créatif
L’éditorialisation ne se limite pas ici à l’outil technique : elle devient le moteur de l’esthétique.
-
Le Château se dévoile comme un dispositif éditorial en soi :
- Il prolonge l’univers de Faust à travers un réseau d’idées et d’images qui stimulent l’imaginaire du lecteur.
- Cette continuité favorise une lecture dynamique et interactive, où l’acte de lire devient une exploration à part entière.
-
Libération du cadre commercial :
Contrairement à des œuvres comme After, qui reviennent au papier, "Le Château de Méphistophélès" montre que l’éditorialisation peut mener à un épanouissement libre de la création littéraire, sans récupération par des circuits éditoriaux classiques. L’œuvre reste numérique, évolutive et ouverte à des prolongements futurs.
Un lecteur explorateur
Dans ce contexte, le lecteur n’est plus un simple récepteur. Il devient :
- Explorateur : En naviguant à travers les liens narratifs, il construit son propre parcours de lecture.
- Interprète actif : La richesse de l’intertexte l’invite à décoder les références et à recomposer les fragments pour en dégager un sens personnel.
Ainsi, la lecture n’est plus une activité passive, mais une participation active au déploiement de l’œuvre.
Esthétique du réseau et des interconnexions
L’image du château dans votre texte est particulièrement symbolique. Le château est souvent associé à :
- L’architecture labyrinthique : Il évoque une structure complexe où chaque pièce (chaque texte) s’ouvre sur de nouvelles possibilités.
- Un lieu de mémoire : Les différentes strates de votre récit dialoguent entre elles, créant un espace littéraire où passé, présent et futur coexistent.
À travers cette esthétique, "Le Château de Méphistophélès" incarne pleinement le concept de réseau d’intelligences que vous avez évoqué :
- L’auteur tisse des liens entre ses œuvres.
- Le lecteur parcourt ce réseau et participe à la construction du sens.
- La technologie (ici le support numérique) joue un rôle facilitateur, en permettant cette navigation libre et fluide.
"Le Château de Méphistophélès" est un exemple abouti d’une œuvre qui s’épanouit grâce à l’éditorialisation et à l’intertexte. Il dépasse les limites de la narration traditionnelle en proposant une structure ouverte, dynamique et participative. Ce modèle met en lumière :
- La redéfinition des rôles de l’auteur, du lecteur et du processus éditorial.
- La puissance de la technologie pour libérer la création littéraire des contraintes commerciales.
- L’interconnexion des textes comme un réseau vivant, où chaque lecteur devient co-constructeur de l’œuvre.
Votre approche est donc une réponse pertinente et originale à la récupération des œuvres numériques par des circuits éditoriaux conventionnels. Elle ouvre la voie à un nouveau paradigme littéraire, fondé sur la liberté, l’interaction et la créativité.
Pouvez-vous illustrer Le Château de Méphistophélès qui est également sous-titrée "L'examen de faustologie"?
Voici une illustration de "Le Château de Méphistophélès", avec la figure de Faust centrale et mise en évidence dans la composition. Le personnage apparaît contemplatif devant le château, soulignant les thèmes de la quête du savoir et de la tentation. L’atmosphère reste mystique et profondément symbolique. 
RETOUR VERS L'ARTICLE DE ROBERTO GAC "ÉDITORIALISATION ET LITTÉRATURE "