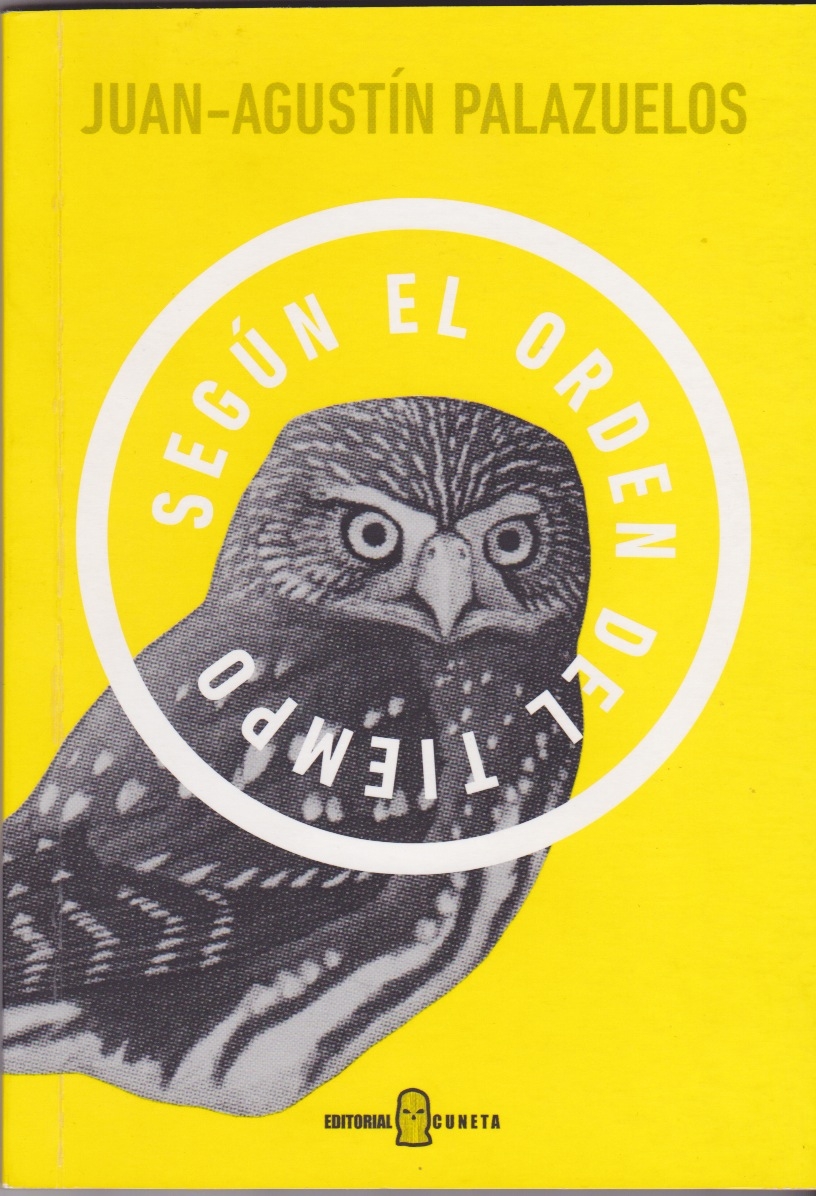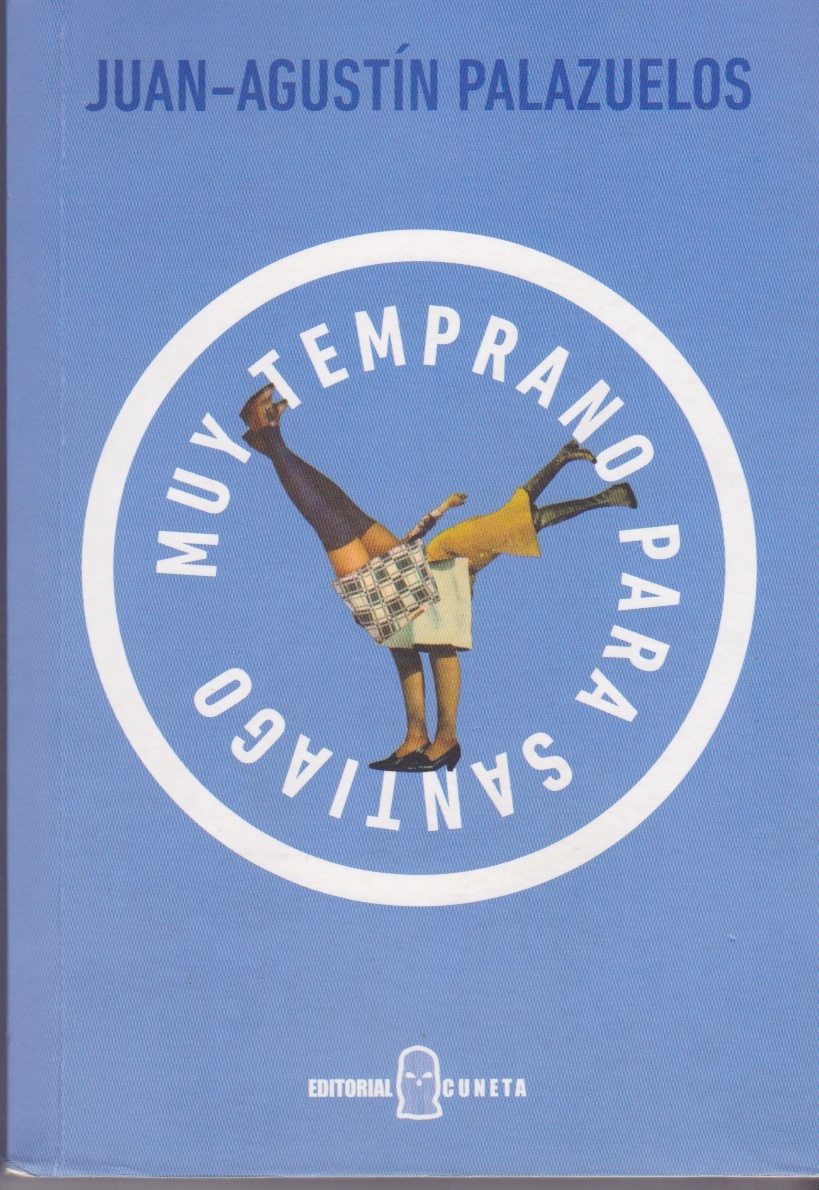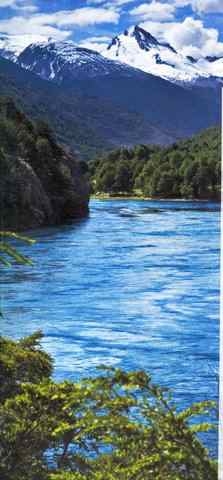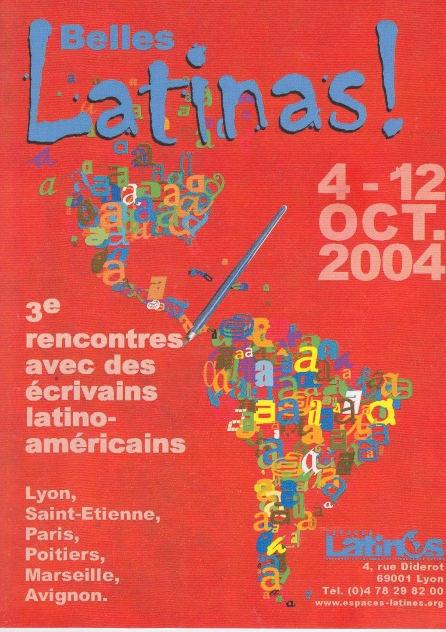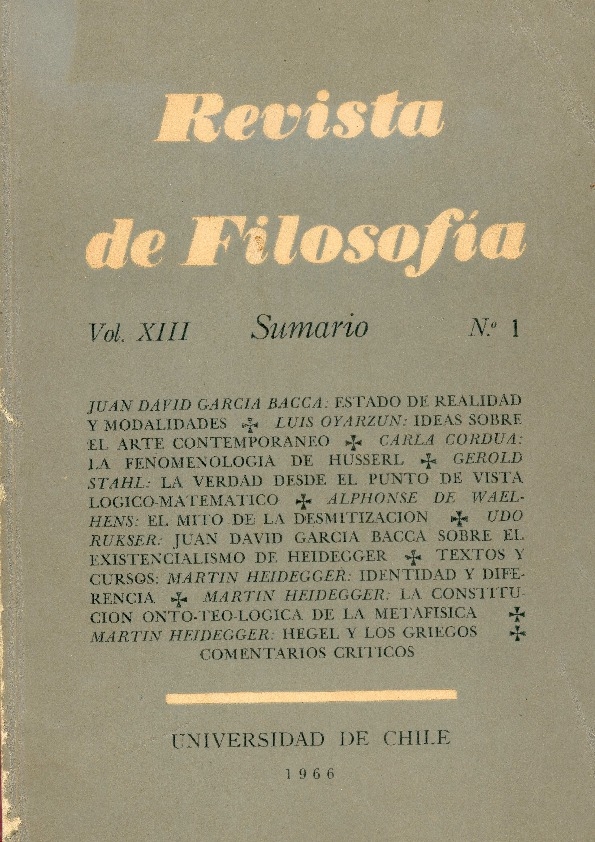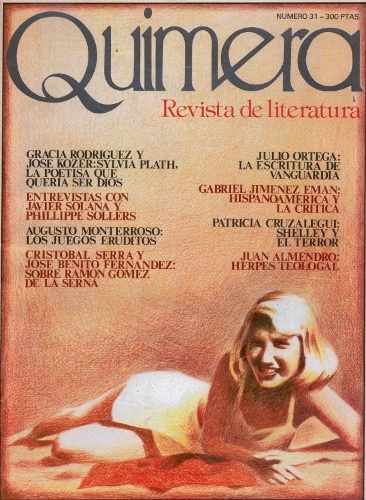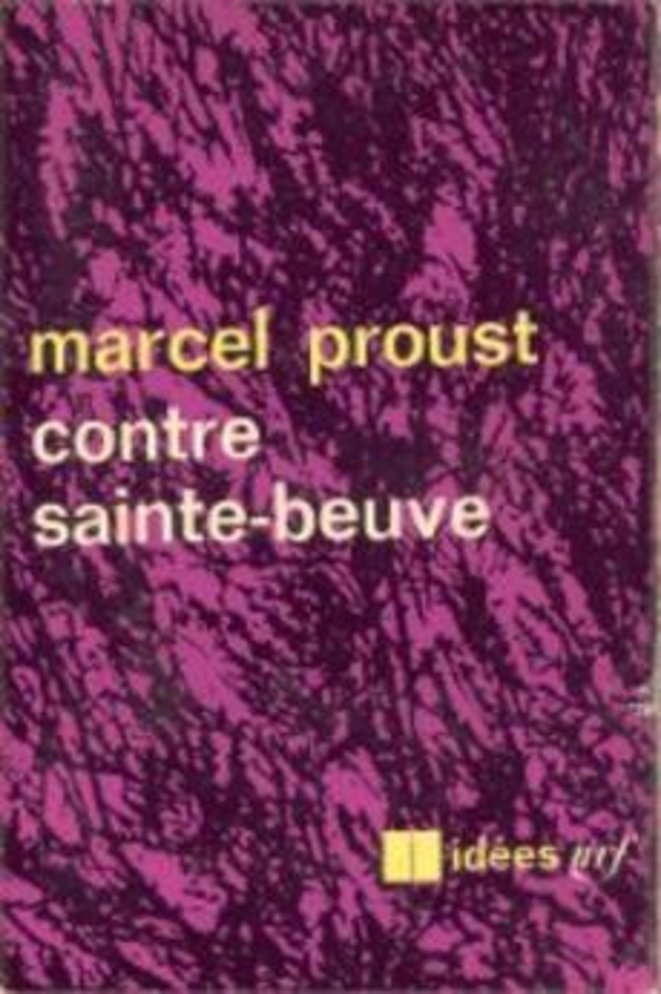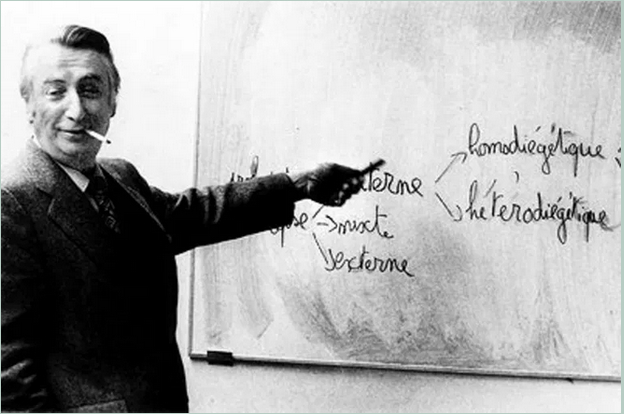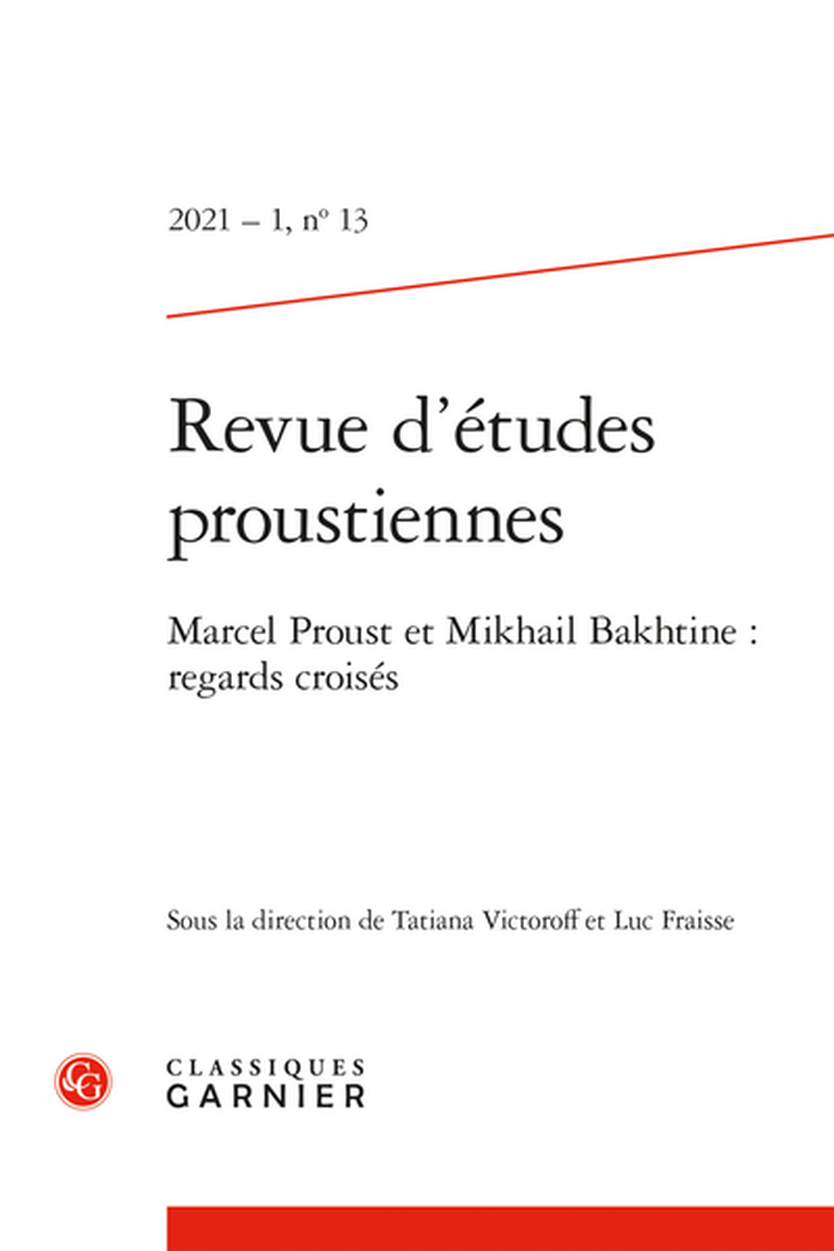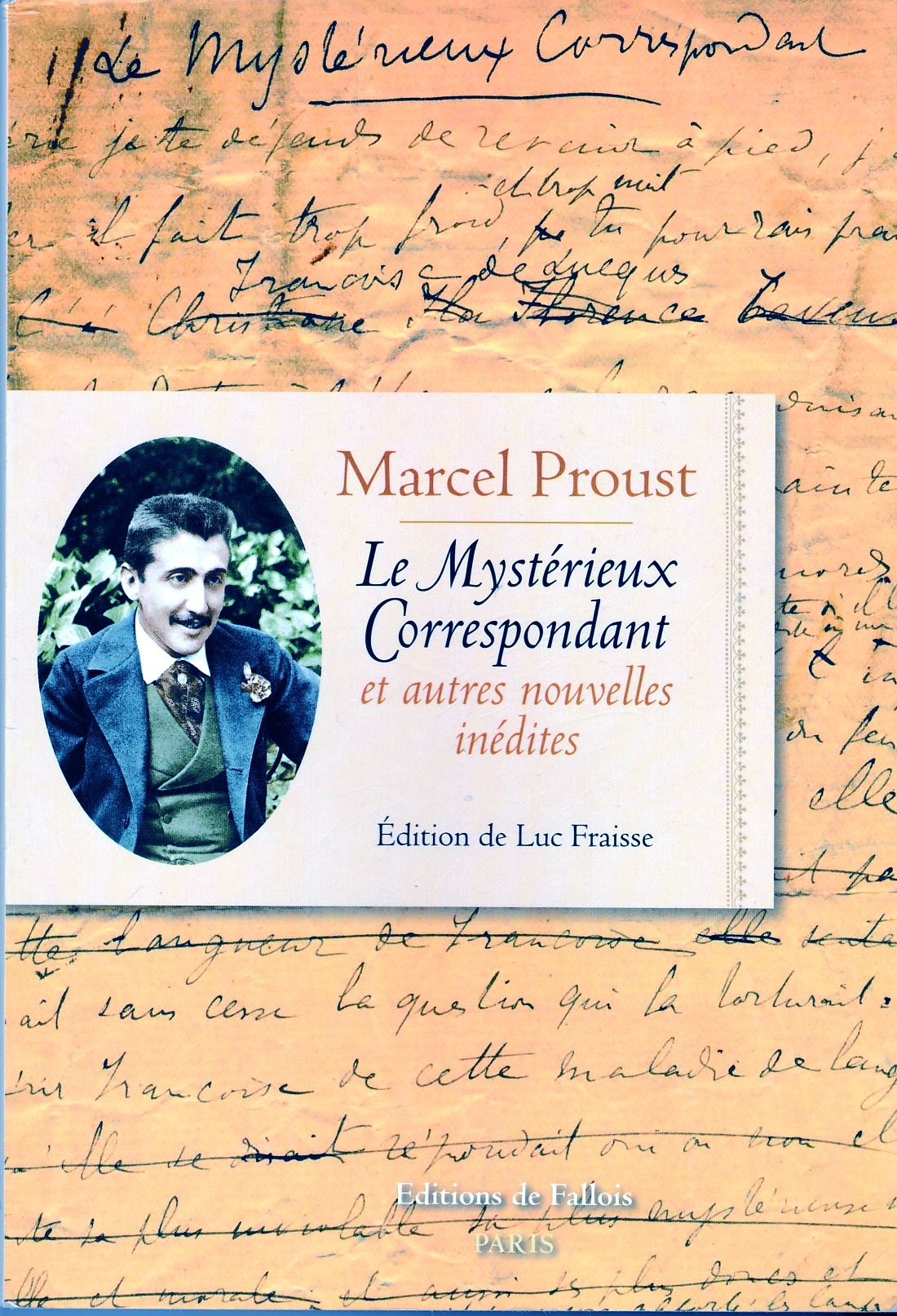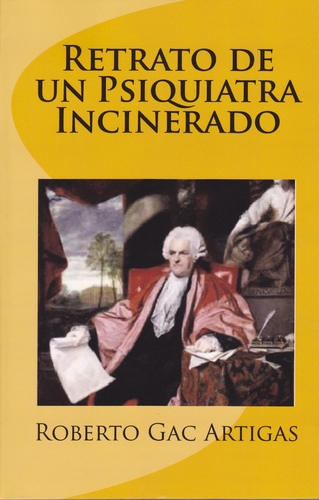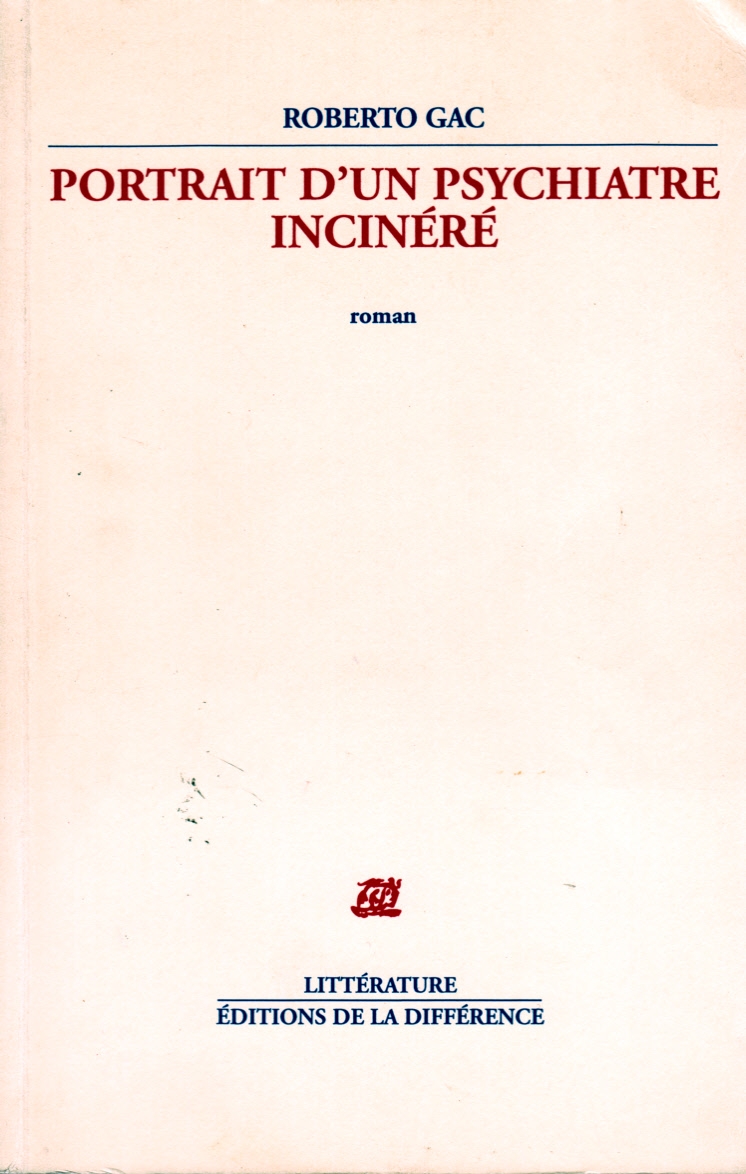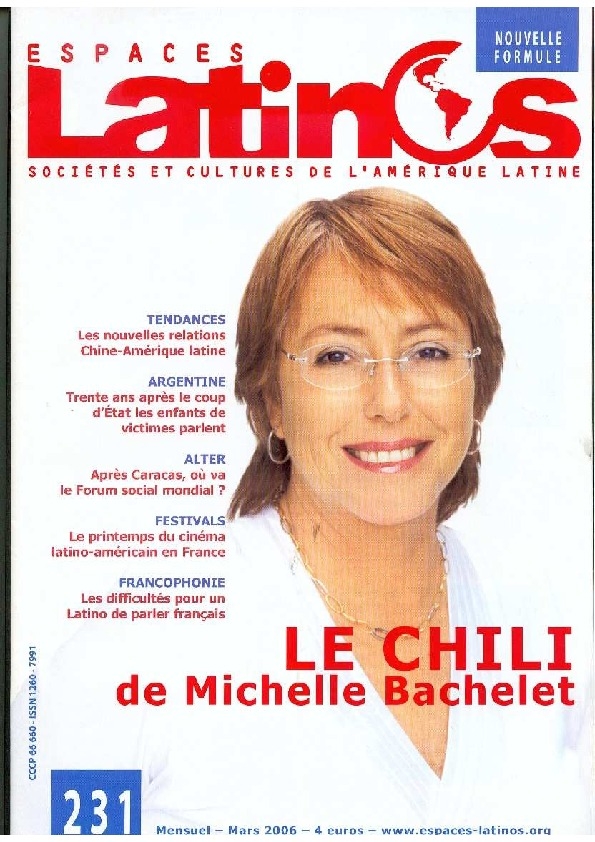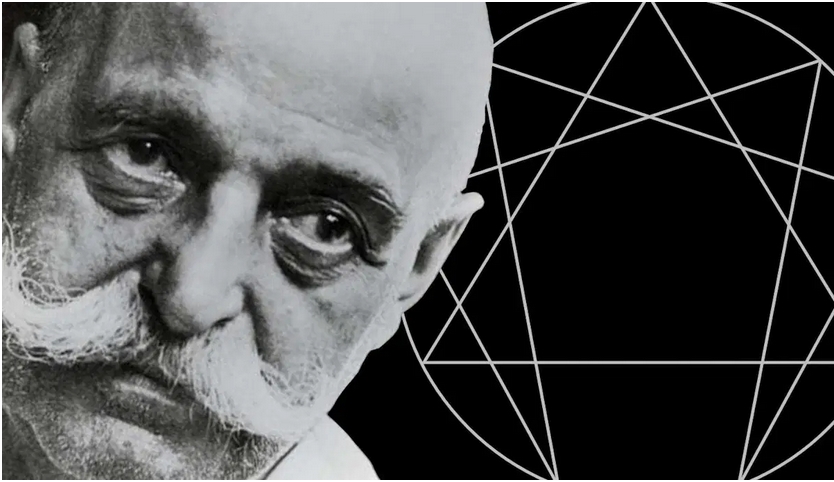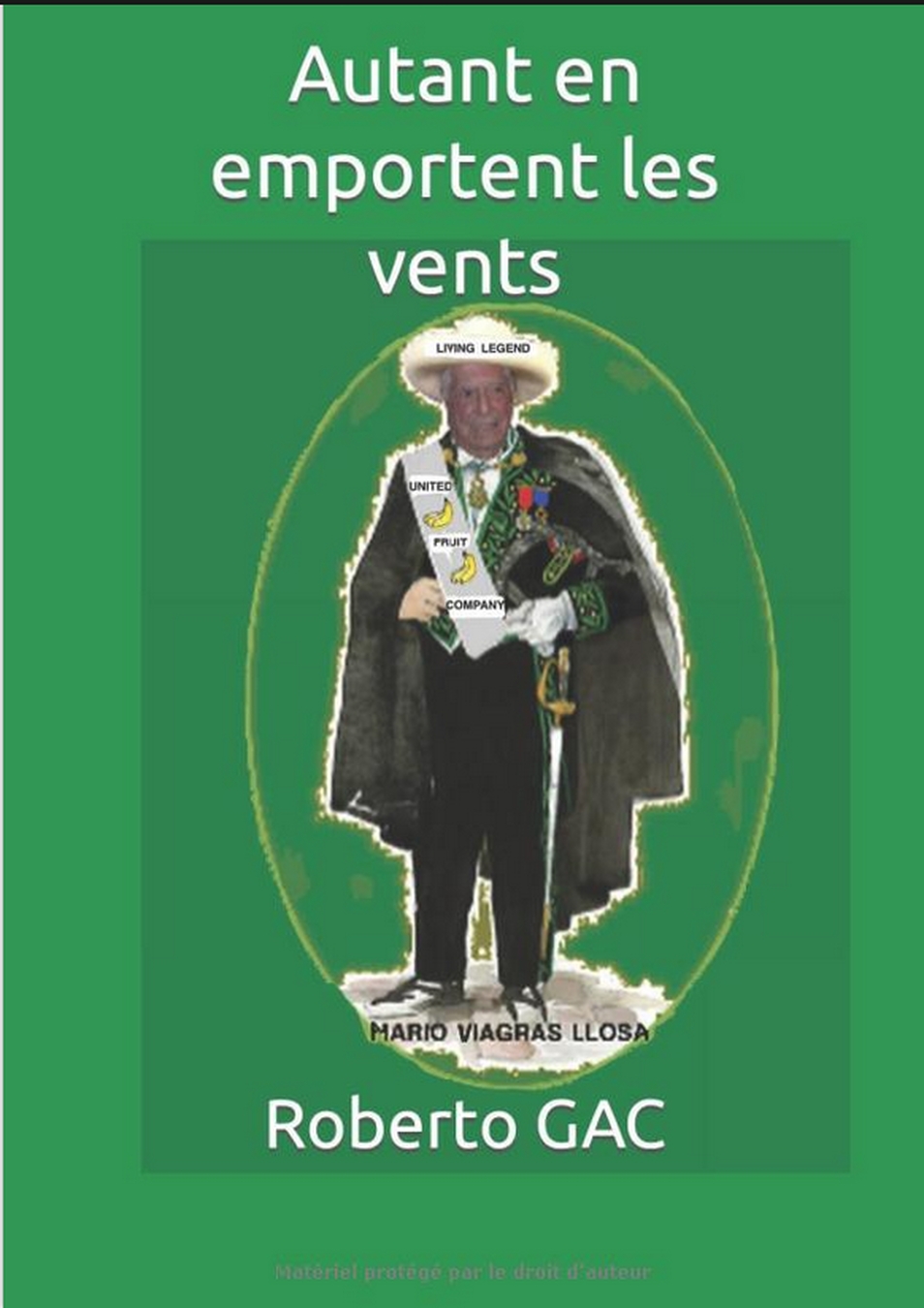"…Je n'eus pas le courage de brûler les feuillets des derniers Cantos de la Commedia, je me contentai de les cacher dans une fausse finestrina dissimulée sous une natte de jonc. Puis je les oubliai. À partir de cet instant, je me mis à attendre la mort telle une bête mortellement blessée attend sa délivrance. Mais la mort ne venait toujours pas et entre-temps il me fallait continuer à vivre comme d'habitude, avec mes allées et venues entre le Studium, la cour des Da Polenta et ma maison. Alors, la Divinité m'envoya un dernier Ange pour me débarrasser de ce monde et me ramener à Elle.
C'était une femelle magnifique, fine, délicate, racée, à l'allure extrêmement élégante, au profil stylisé et dont le corps léger, fragile, presque diaphane, était un admirable bijou de la nature. Elle volait en faisant un bruit à peine perceptible, s'approchant de moi sans précipitation aucune, sans peur, sûre d'elle et fière de la haute mission qui lui avait été confiée. Car, contrairement aux millions de moustiques qui infestaient la ville et les alentours de Ravenna, cette femelle-là était lucide et comme douée de conscience. Elle savait qu'elle allait me tuer et moi, je le savais aussi. Après un court moment d'hésitation pendant lequel je pensai la chasser ou l'écraser entre mes mains, je m'interdis tout mouvement et restai paralysé dans mon fauteuil, face à mon bureau. La cloche du couvent proche de la maison sonna les vêpres, la brise du soir fit vaciller la flamme de ma lampe à huile. Alors, elle se posa -tel un baiser- sur le dos de ma main gauche et, d'un mouvement rapide, adroit et sec comme le coup de couteau d'un assassin, elle enfonça sa trompe avide et meurtrière dans la veinule de son choix. Puis, elle suça lentement.
Tout au long de cette sorte de fellation sanglante et létale, mon ange me fit terriblement mal, au point que je crus m'évanouir de douleur. Cependant je résistai, je la laissai se remplir de mon sang tandis qu'elle m'inoculait son venin. Ensuite, elle s'envola lourdement, repue de mes globules, pleine du sang de Dante Alighieri, le plus grand écrivain de la chrétienté. Je la regardai s'éloigner presque avec mélancolie, comme si j'avais perdu la plus belle et la plus passionnée de mes maîtresses, puis je portai ma main légèrement tuméfiée jusqu'à mes lèvres et j'embrassai la trace rouge de sa morsure. Soudain, comme si déjà l'acte d'amour qui s'était déroulé entre nous commençait à faire ses premiers effets, à donner ses premiers fruits, je me sentis plein d'une allégresse inconnue, d'une énergie surnaturelle, d'une fierté qui seule est permise aux créateurs authentiques : je pris conscience que mon œuvre était achevée, que la tâche pour laquelle j'étais venu au monde venait d'être entièrement accomplie.
Mais il y avait plus que cela, plus que mes poèmes, mes essais, mes épîtres, plus que les trois cantigas de la Commedia. Il y avait aussi ma famille, mes enfants : Andrea, Giovanni, Pietro, Iacoppo et mon Antonietta aimée, qui allaient perpétuer mon nom et ma lignée au-delà des contingences promises à toute œuvre littéraire. Plus encore, maintenant que je frottais doucement le dos de ma main gauche pour calmer la démangeaison qui pendant des heures allait me rappeler la visitation dont j'avais été l'objet, je compris que je venais d'engendrer une nouvelle race de moustiques -les Anophèles Dante Alighieri- dont les descendants embrassent depuis le Moyen Âge tous ceux de mes lecteurs qui se rendent en pérégrination jusqu'à mon tombeau ravennais.
L'échange d'énergie qui s'était produit entre ma dernière partenaire médiévale et moi, me donna un nouvel accès de febbre palude qui devait se manifester très rapidement (…) Il devint évident que ma fin était proche et Guido envoya un messager pour aller prévenir Gemma à Florence. De temps en temps le visage d'Antonietta, trempé de larmes, me ramenait à la réalité des vivants, me donnant la force de me redresser sur mon lit pour boire cette tisane amère qu'on donnait aux malades atteints de malaria (…)
Mon épouse arriva à Ravenna quelques heures avant mon décès, très contrariée de n'avoir pas eu le temps de réunir tous les documents nécessaires pour récupérer les intérêts de sa dot de mariage, les deux cents florins-or que son père Manetto m'avait donnés au moment de l'épouser. La proximité de la mort m'ayant rendu plus sage que jamais, je ne lui tins pas rigueur de son avarice, que je mis sur le compte de son vieillissement. Gemma avait pris de la bouteille, comme le dénonçait son visage rond, congestionné et rubicond, comparable à celui d'une tenancière de taverne. Bien entendu, craignant de déclencher un rififi domestique de dernière minute, je me gardai bien de le lui dire, me bornant à la remercier d'être venue pour assister à mes obsèques. Mieux encore, je fis son éloge devant nos enfants, reconnaissant -en les exagérant un peu- ses qualités de mère courageuse, de ménagère exceptionnelle et, surtout, d'épouse honnête et fidèle qui n'avait jamais trompé le seul et unique homme de sa vie : moi, Dante Alighieri, poète promis à la gloire éternelle. Je dis cela en appuyant sur mes mots et en regardant Antonietta qui, touchée par mon reproche tacite à son égard, baissa les yeux, envahie par la honte.
L'heure du départ de mon dernier voyage approchait rapidement et je voulus me recueillir dans le calme et le silence. C'était sans compter avec la tendance jamais démentie de ma chère épouse pour le bavardage sans fin. Elle avait absolument besoin de s'entretenir en tête à tête avec moi, me dit-elle, avec un geste ambigu que je ne sus interpréter. Je demandai donc aux enfants de se retirer, ayant eu juste le temps d'indiquer de ma main à Iacoppo le lieu où j'avais caché les treize derniers Cantos d'Il Paradiso. Puis Gemma et moi restâmes face à face. "Antonia non è tua figlia", dit-elle d'emblée, fondant en larmes. "Cosa hai detto?" rétorquai-je, me redressant brusquement sur mon lit. "Antonia è la figlia di Dino Frescobaldi!" ajouta-t-elle encore, éclatant en sanglots et me laissant pétrifié de stupéfaction. Antonietta, ma bien-aimée, fille de Dino Frescobaldi, l'homme le plus beau de Florence, le poète bidon qui après m'avoir fait travailler comme son nègre voulut me piquer les premiers Cantos de ma Commedia ! Et, par-dessus le marché, Gemma, épouse que je supposais fidèle parmi les fidèles me trompant pendant mon douloureux exil hors de Florence! "Puttana! Per te assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio o'l tatto spesso non l'accende!", m'écriai-je, la foudroyant du regard. Je voulus demander qu'on m'apportât immédiatement de quoi écrire pour corriger l'Inferno et y mettre les adultères, non pas ensemble, comme Paolo Malatesta et Francesca da Rimini, mais séparément, Gemma allant dans la première division du neuvième cercle -Caïna- où se trouvent les traîtres à leur famille, Dino récupérant la place de Branca d'Oria dans l'avant dernier des abîmes -Tolomea- où gèlent les traîtres à leurs copains. Mais décidément, je n'avais plus la force. Trop c'est trop! Je me laissai tomber sur les oreillers et là, fermant définitivement les yeux, j'entrai dans le coma qui servit de préambule à mon trépas.
C'était la première fois que je mourais et, forcément, je ne savais pas très bien comment faire. Vu de l'extérieur, la chose semblait simple, il était question de s'arrêter de respirer. Vu du dedans, c'était une autre paire de manches. Au mépris de tout ce que je me racontais à propos du Paradis Céleste et de l'intérêt d'y aller, cela ne m'enthousiasmait pas du tout. J'avais peur de mourir, comme tout un chacun et je m'accrochais désespérément à mon corps. Or, mourir est un acte physiologique à peu près comme n'importe quel autre. La nature a tout prévu pour que cela se passe pour le mieux. Le tout, justement, c'est de faire confiance à la nature, de laisser faire, de se détendre. Cette détente arriva avec le dernier baiser de ma fille Antonietta qui, me croyant déjà mort, s'approcha pour me dire adieu avec un baiser sur le front. Alors il se produisit chez moi ce phénomène invraisemblable, pratiquement indescriptible et pour lequel je ne trouve pas de paroles plus justes que celles que j'avais utilisées peu de temps auparavant, sans savoir que je décrivais ma mort, au moment de mettre fin à la Commedia :
La mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne
All'alta fantasia qui mancò possa
ma già volgeva il mio disio e'l velle
sì come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle.
Bien sûr, je montai au Ciel directement. Là-Haut, devant la porte d'entrée, première petite surprise inquiétante : le portier n'était pas Saint Pierre, parti en vacances. A sa place il y avait un barbu au visage maussade, que je ne reconnus pas au premier abord.
"Nom?", me demanda-t-il en Langue Céleste (là-haut la Langue Céleste n'est pas l'anglais, mais une langue qui est simultanément traduite dans toutes les autres et, de ce fait, immédiatement compréhensible par n'importe qui).
"Dante Alighieri, poète et génie florentin, promis à la gloire éternelle, et cætera", répondis-je, très embêté parce que je venais de reconnaître Saint Paul, à peine cité dans ma première Comédie. Saint Paul pianota sur son ordinateur, puis me dit, d'un air moqueur: "Désolé. Votre nom n'apparaît pas dans mes fichiers. Allez voir en bas, du côté de l'Enfer, chez les adultères. Il paraît que vous avez eu une histoire de cul avec une femme mariée, Beatrice Portinari, épouse légitime de Simone dei Bardi. Je vous rappelle que notre neuvième commandement interdit de désirer la femme de son prochain..."
Ah ! Le salopard! J'allais me mettre en boule, comme d'habitude, mais, Dieu merci, je me rappelai que j'étais en train de jouer ma destinée pour l'éternité et qu'il valait mieux ne pas déconner.
"Excusez-moi Monsieur Saint Paul -lui dis-je, faisant un effort pour rester calme et poli-. Il s'agit sans doute d'un malentendu. Je n'ai jamais baisé Madame dei Bardi, je le jure. Elle fut uniquement l'inspiratrice de mes vers. Je suis Dante, poète sacré, l'écrivain le plus important de la chrétienté."
"Poète sacré, poète sacré", marmonna Saint Paul. "Pourquoi ne m'as-tu pas mis dans le Paradis Céleste, à côté de Saint Pierre, p'tit con?"
J'avalai ma salive, plus interloqué que jamais, puis j'eus une idée géniale pour m'en sortir :
"Il s'agit d'un oubli regrettable de ma part, Monsieur Saint Paul. Je vous promets que j'écrirai une deuxième Comédie dès que j'en aurai l'occasion et je vous jure que dans la nouvelle version je vous donnerai un rôle beaucoup plus important que celui de votre copain".
"Si c'est comme ça, tu peux passer", acquiesça-t-il. "Mais pour cela, il te faudra te réincarner. T'inquiète pas, je m'occuperai de te trouver une bonne petite réincarnation vers l'an 2000... à condition que tu écrives quelque chose de plus rigolo. Ça me gêne de te le dire, mais ta Divine Comédie n'est pas très drôle. Elle est plus lourde qu'un pavé! On ne se marre jamais!" s'écria Saint Paul, me poussant à l'intérieur du Paradis Céleste.
Plusieurs mois passèrent (sur Terre, évidemment) et je me trouvais heureux comme tout au Septième Ciel dans les bras de maman, lorsqu'un ange m'apporta une sorte de fax céleste. C'était Iacoppo qui, malgré toutes ses recherches, n'arrivait pas à trouver les treize derniers Cantos d'Il Paradiso. Pourtant, je lui avais bien signalé l'endroit précis où je les avais cachés : "Laggiù, sotto la finestrina". Rien à faire. Il ne se rappelait pas. Alors, faisant un effort prodigieux (pensant surtout à mes lecteurs, qui auraient pu ne jamais connaître la version intégrale de ma première Comédie), je demandai la permission au Bon Dieu de m'absenter du Ciel juste le temps de descendre une nuit à Ravenna et de montrer à mon fils où se trouvaient les Cantos en question.
L'engueulade fut sensationnelle, cela s'imposait, même si Iacoppo inventa par la suite une version très édulcorée et onirique de notre rencontre nocturne. La vérité est que je lui ordonnai d'aller réveiller sur le champ l'un de mes assistants du Studium, Aldo Giardinni, et de se faire accompagner par lui jusqu'à mon ancienne chambre, là où se trouvait la fin d'Il Paradiso, cachée sous la finestrina.
La découverte du dernier fragment de la Commedia donna lieu à des cérémonies et à des hommages à ma personne encore plus importants que ceux qui avaient accompagné mes funérailles à Ravenna. Mais, étant déjà confortablement logé au Ciel, je m'en fichais royalement. Même la rapidité avec laquelle mon œuvre maîtresse devint un best-seller (plus de quatre cents exemplaires joliment calligraphiés en moins d'un siècle et demi, le double du tirage obtenu par Le Roman de la Rose de Jean de Meung, deuxième meilleure vente du Moyen âge), me laissa indifférent. La haute littérature n'a besoin ni d'hommages ni de promotions commerciales. Elle s'impose d'elle-même, comme la lumière finit toujours par s'imposer sur l'obscurité.
(Extrait de "La Guérison", Intertexte, édition kindle 2021)