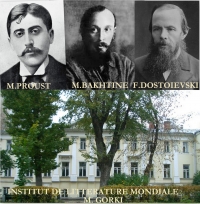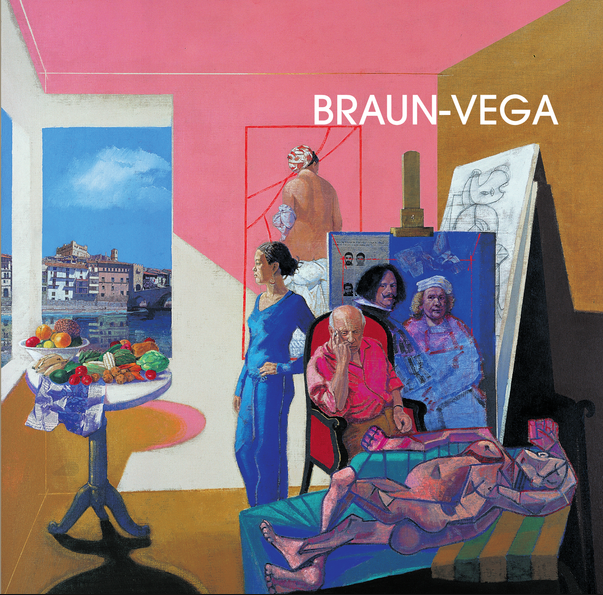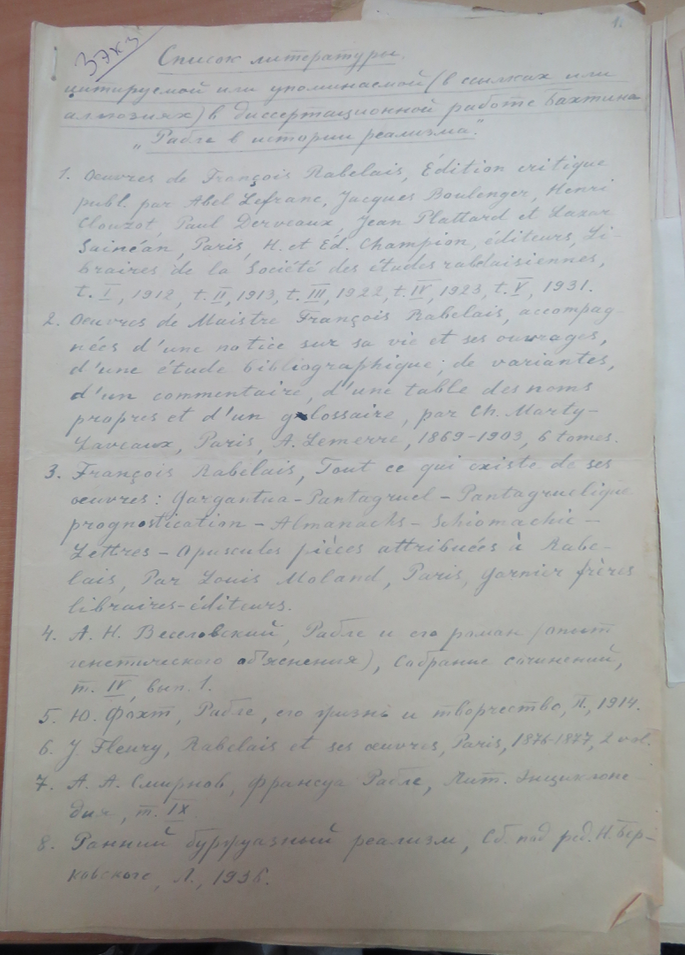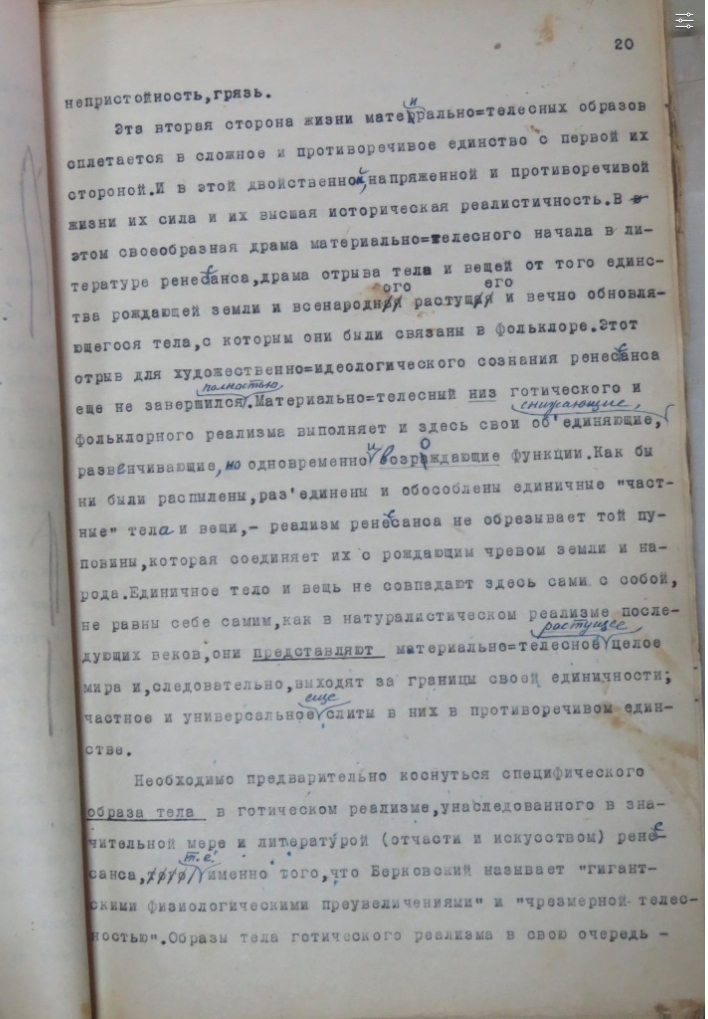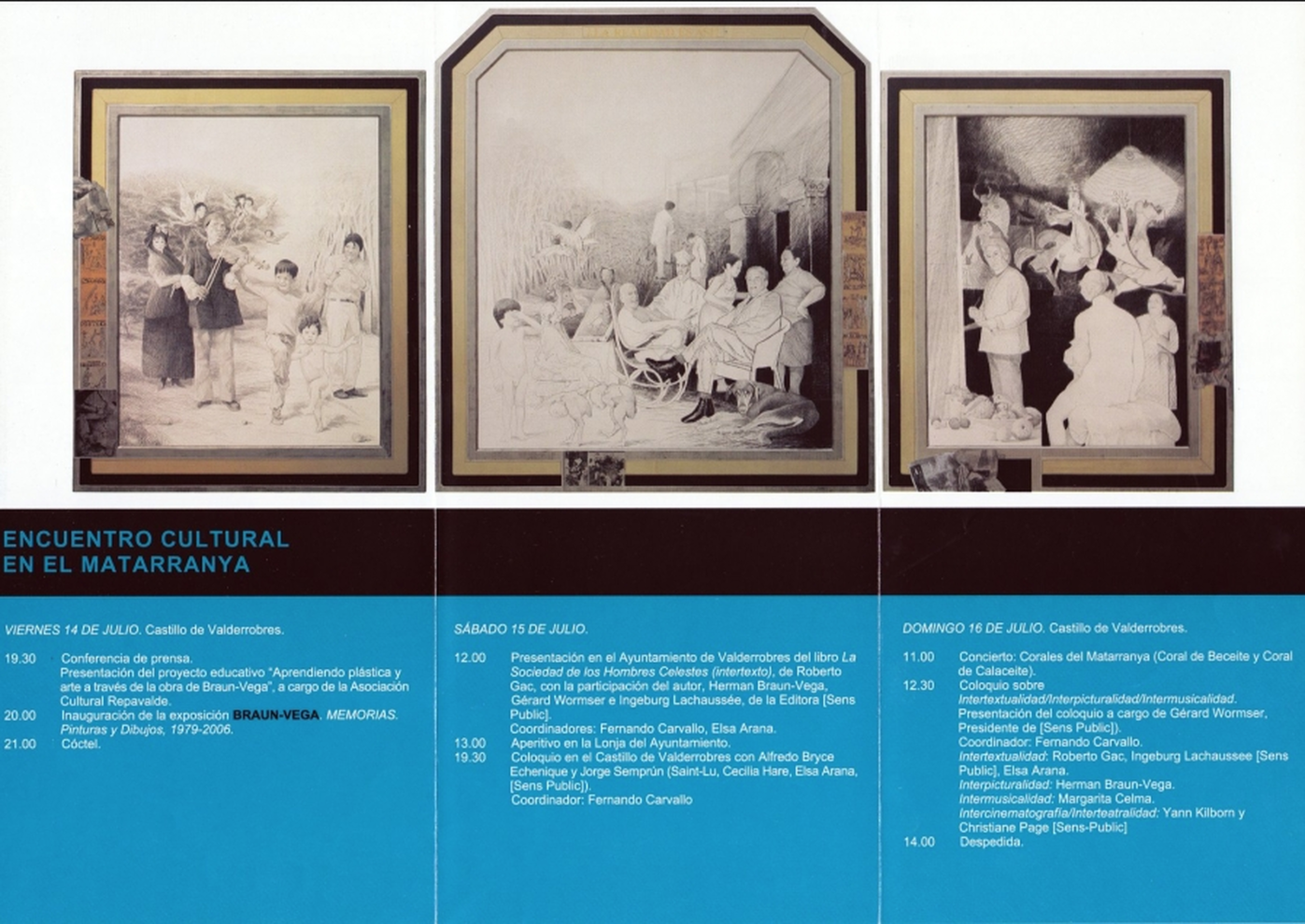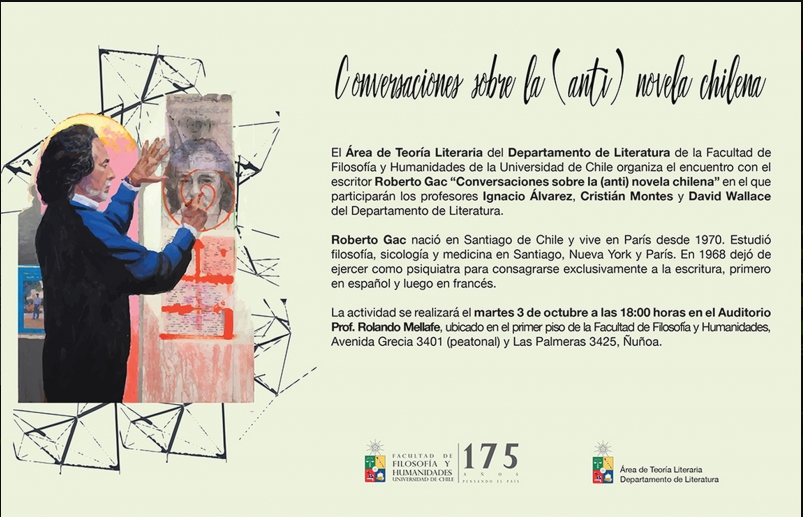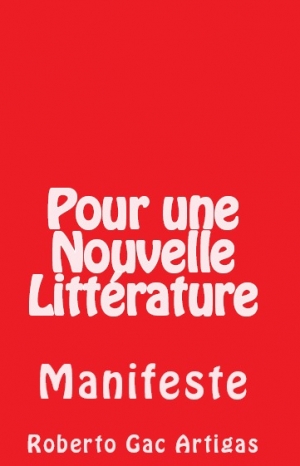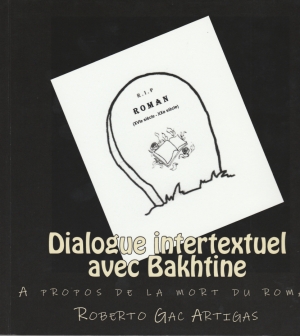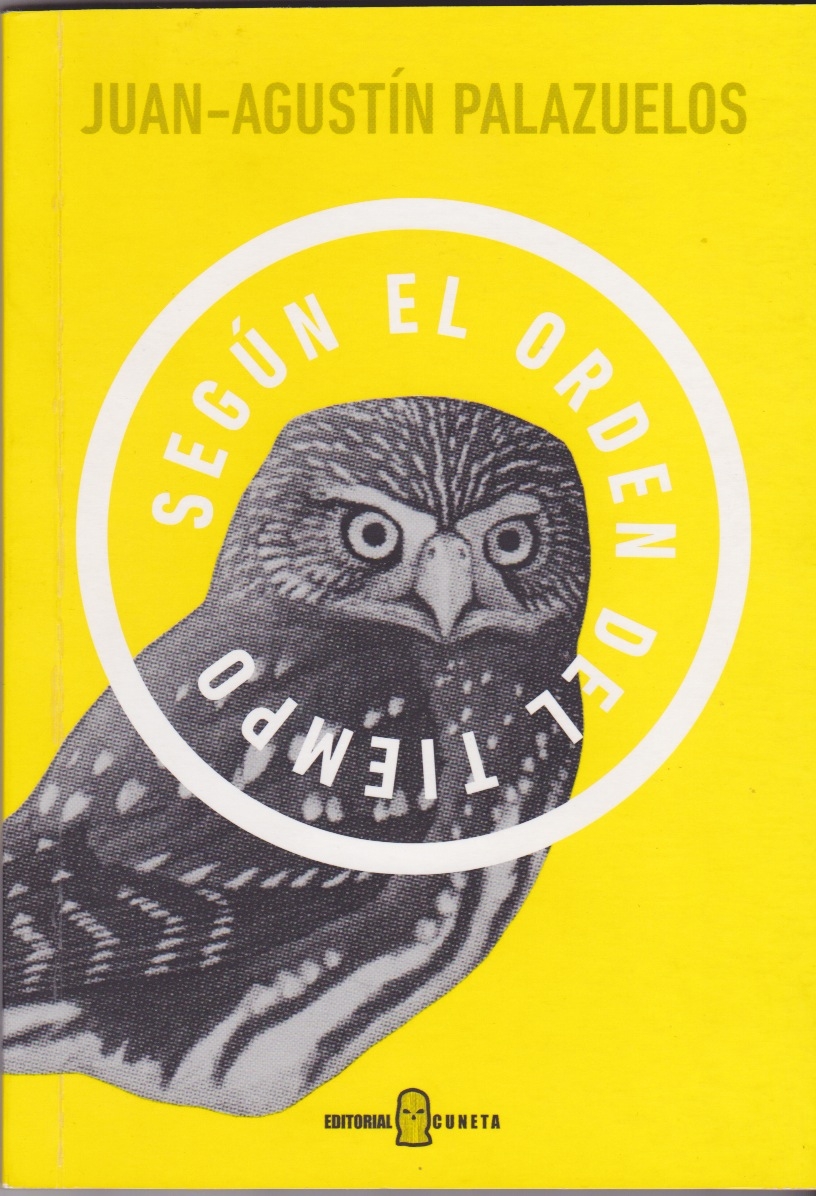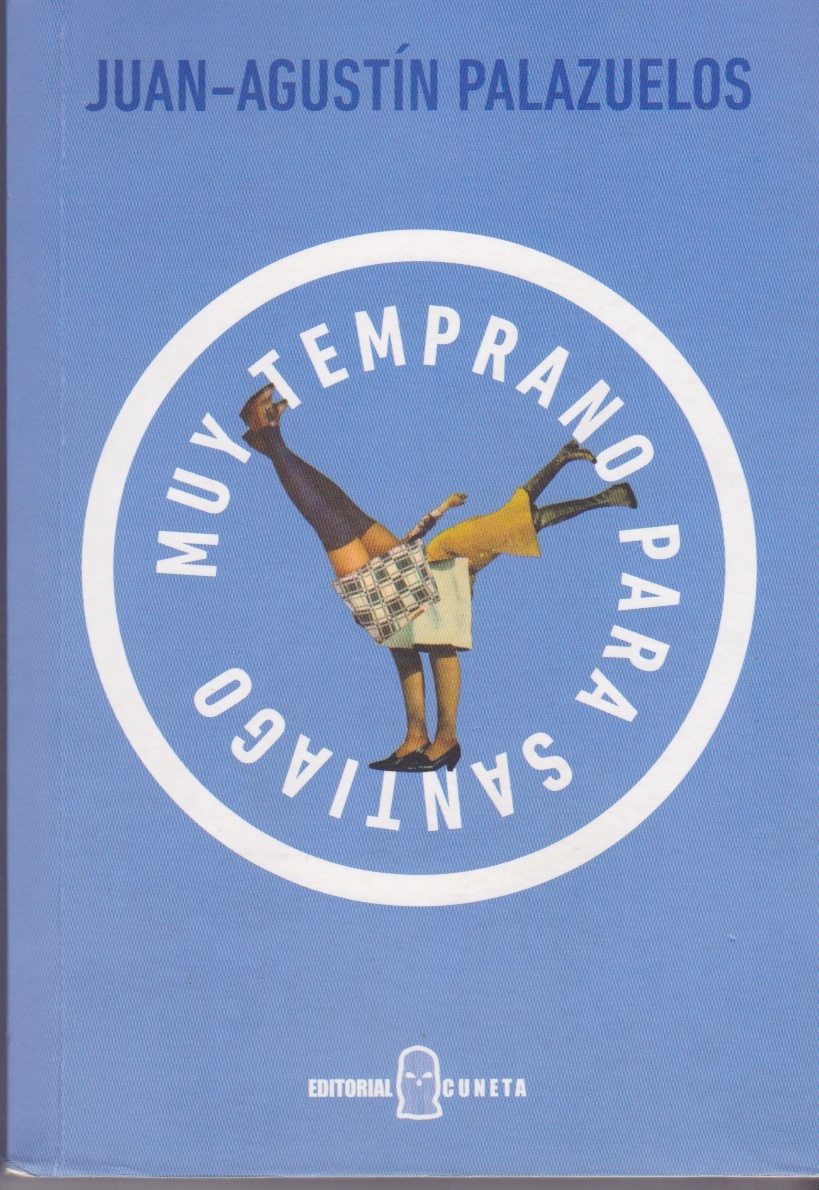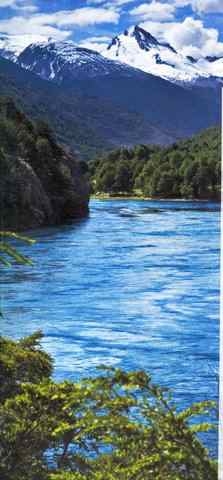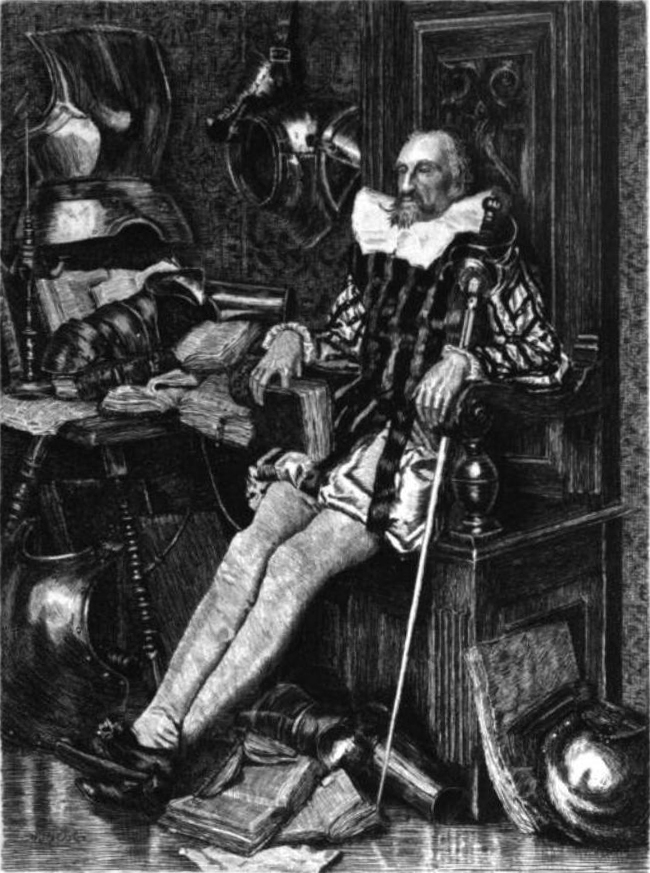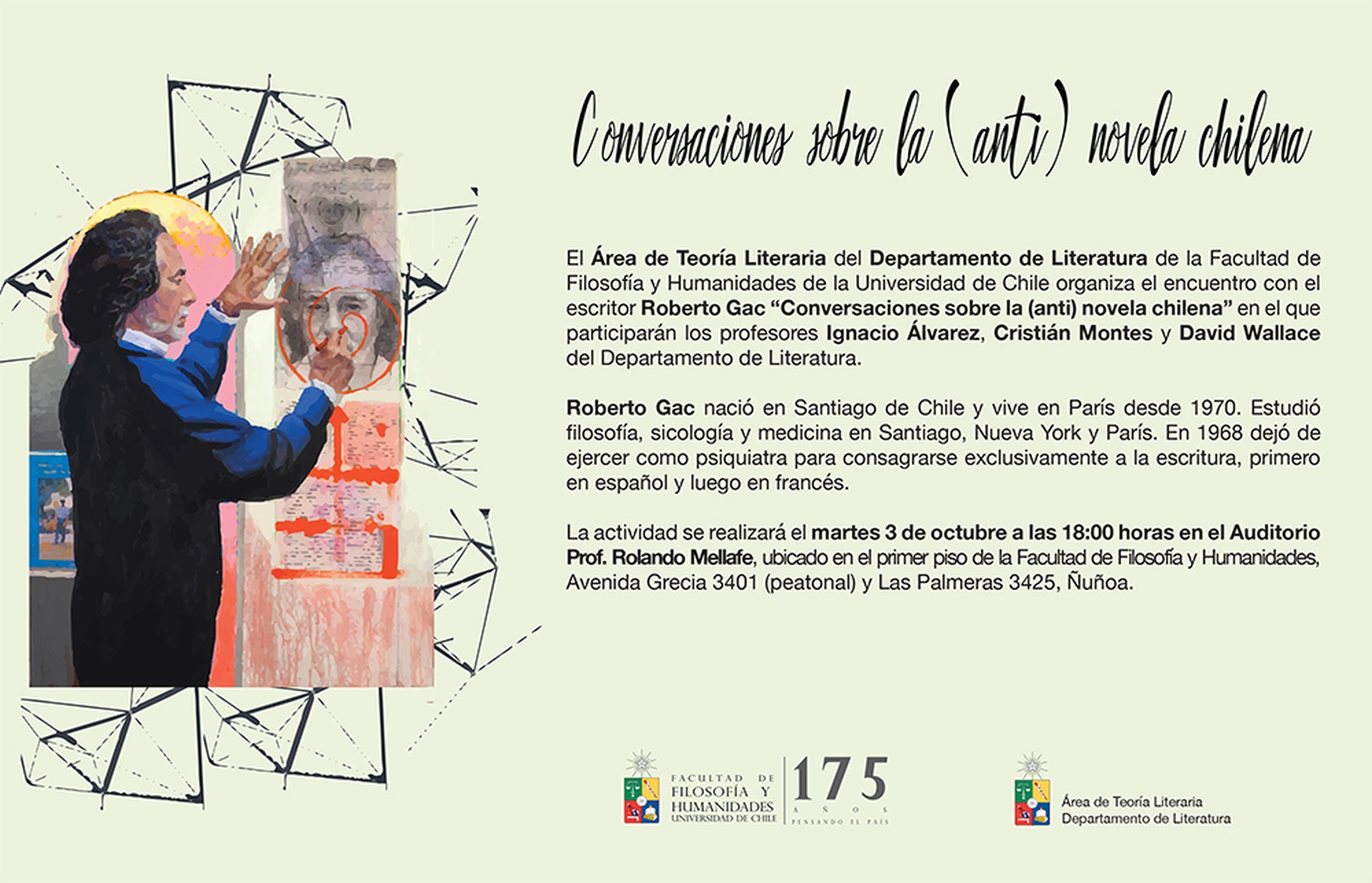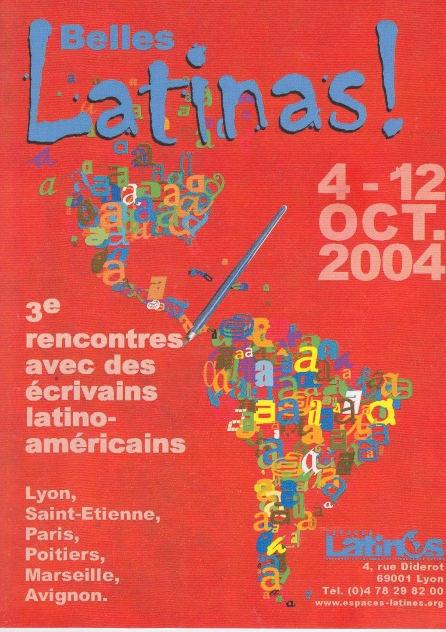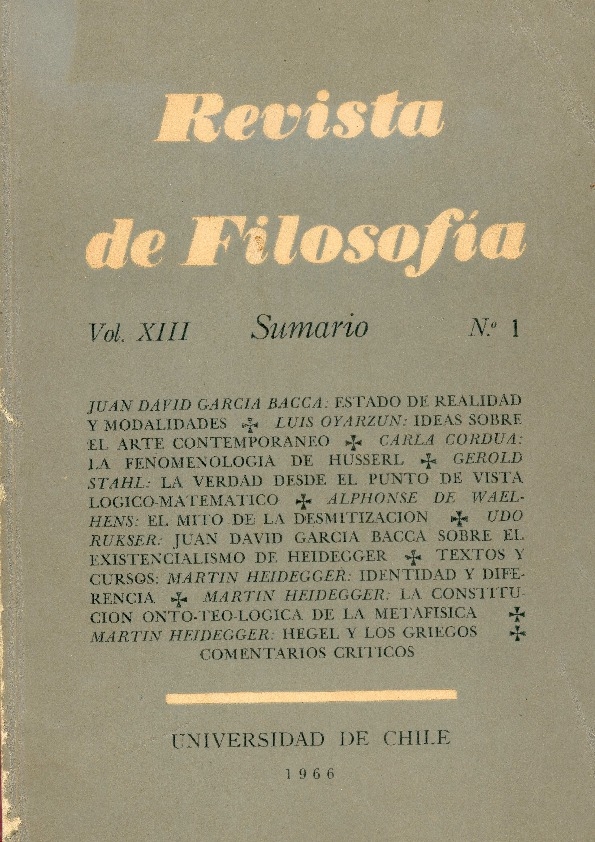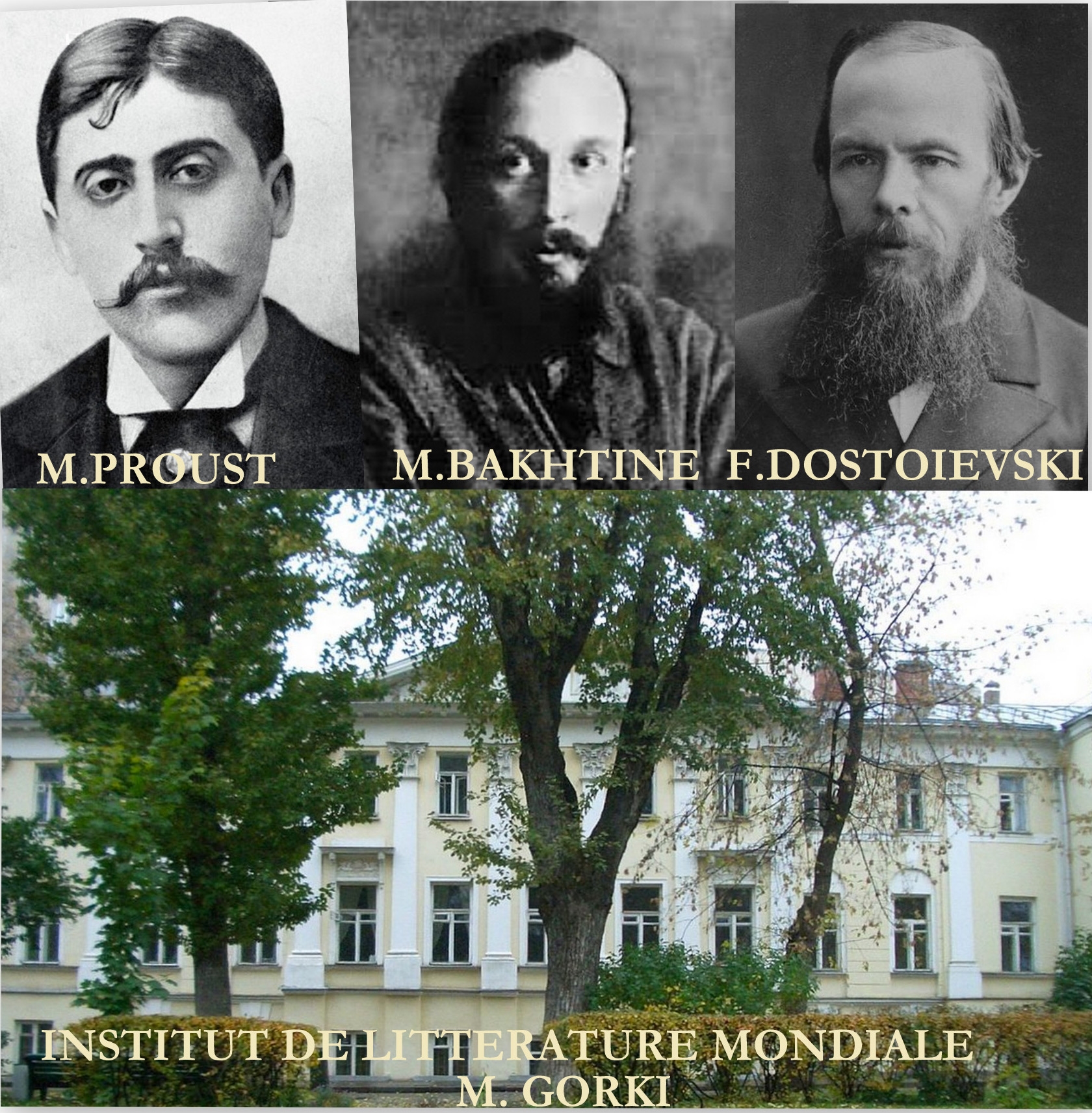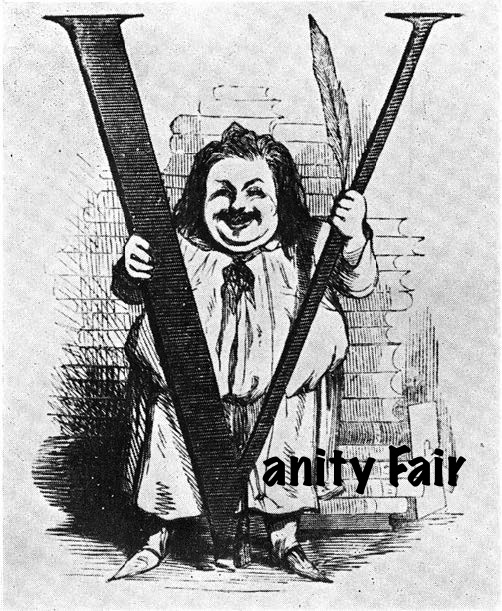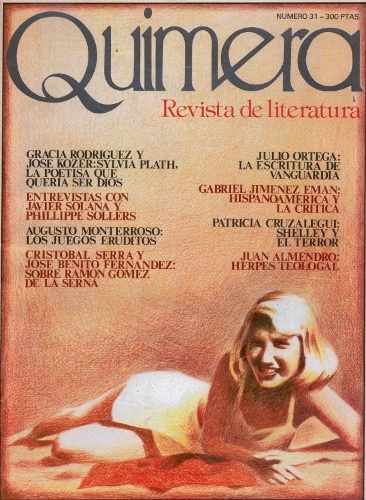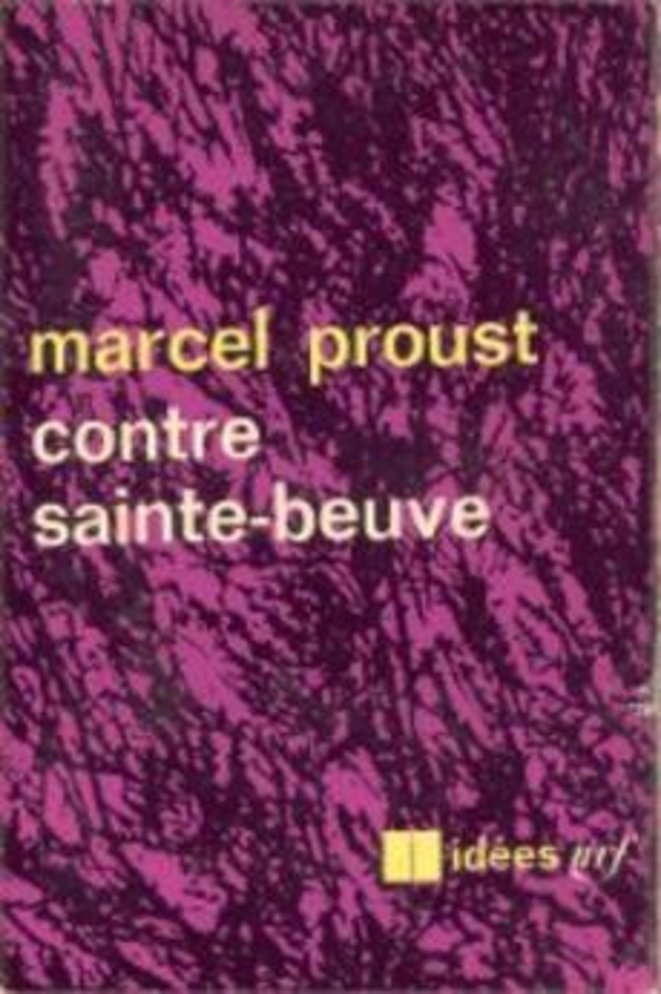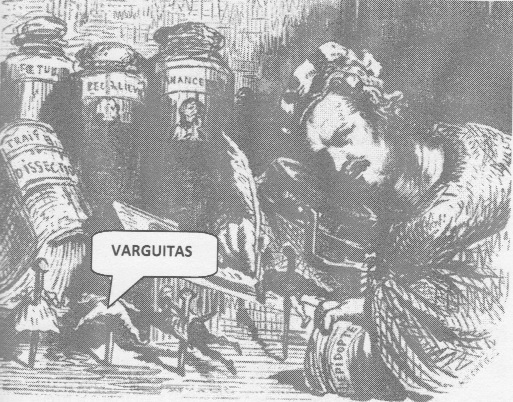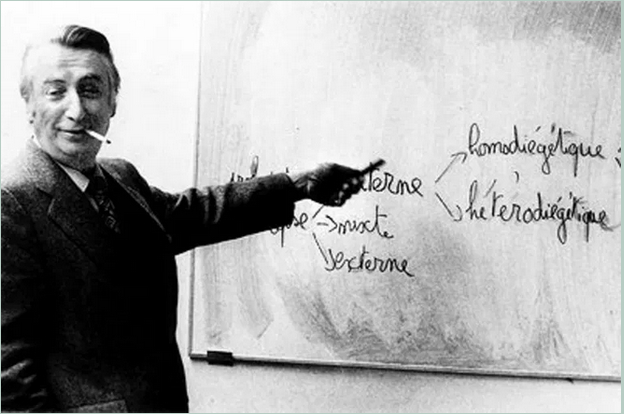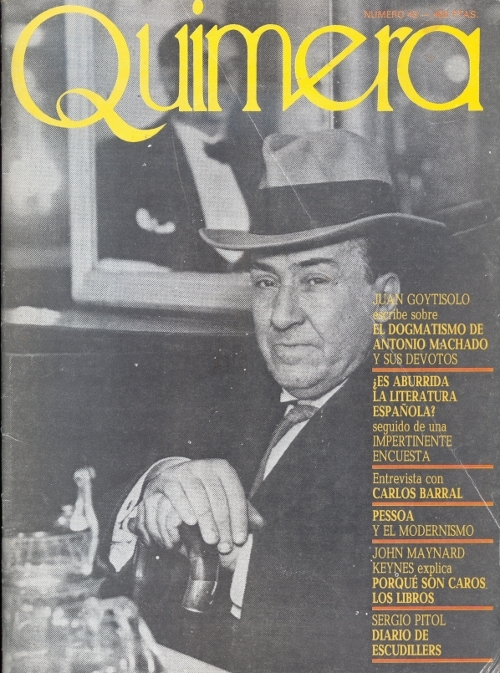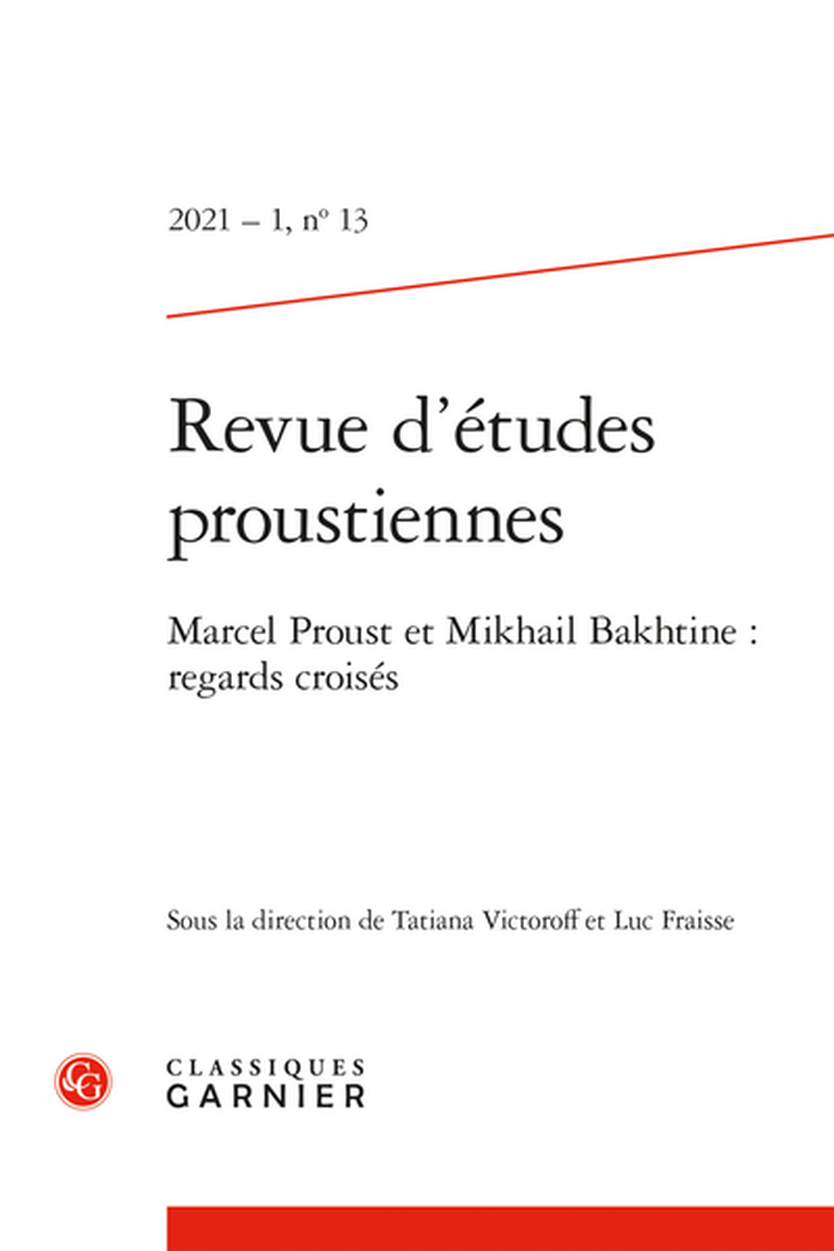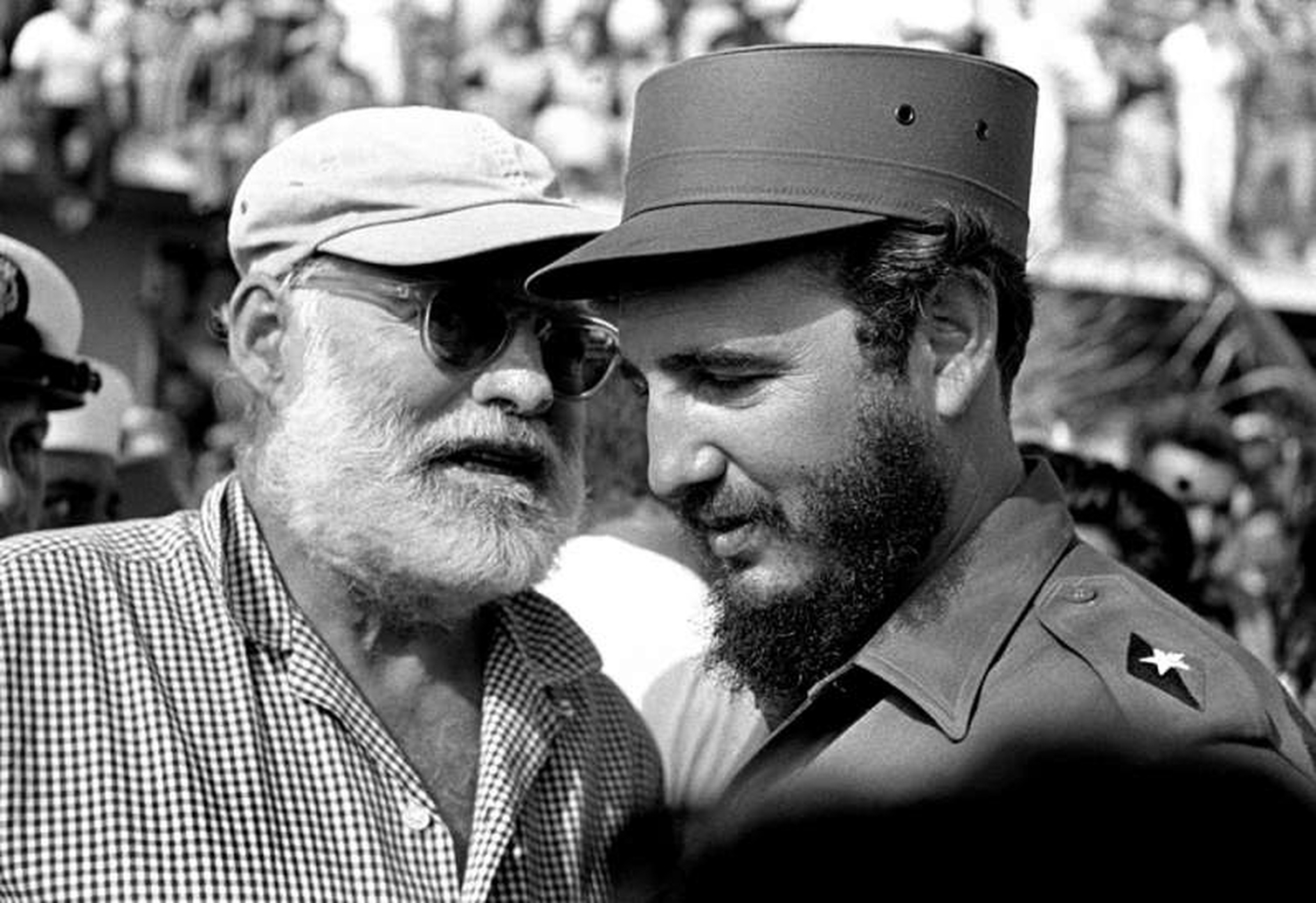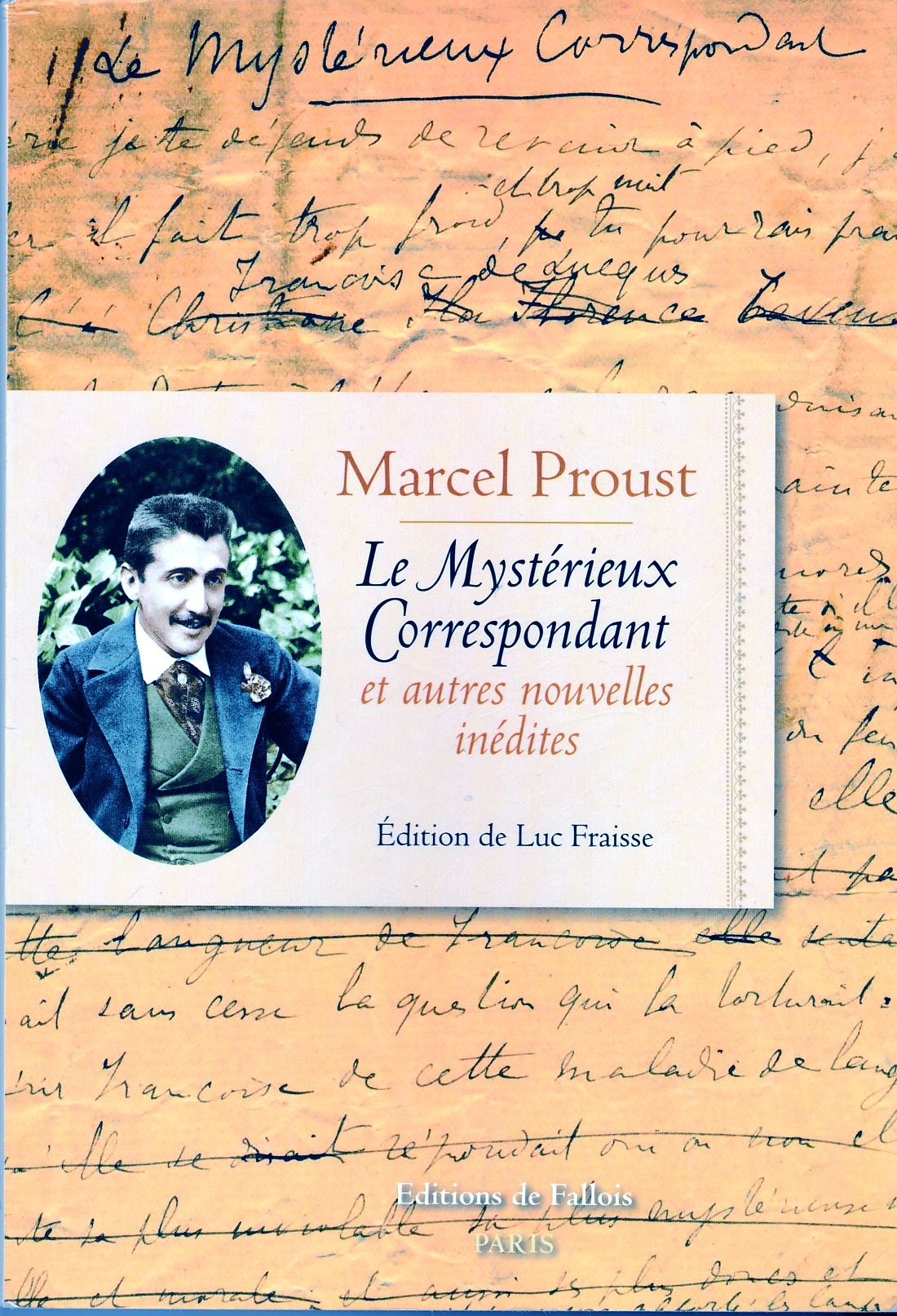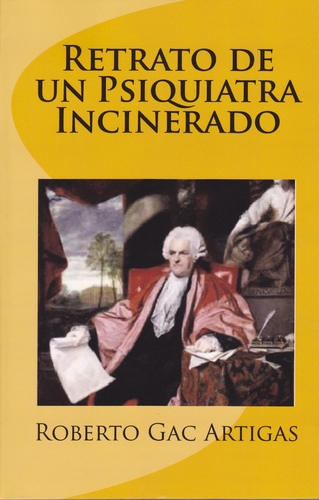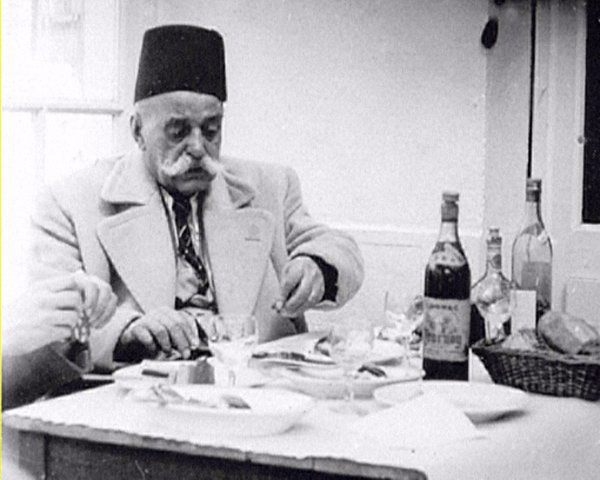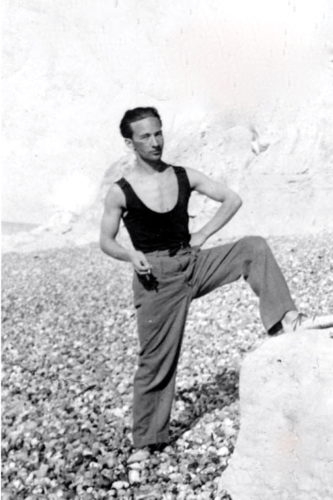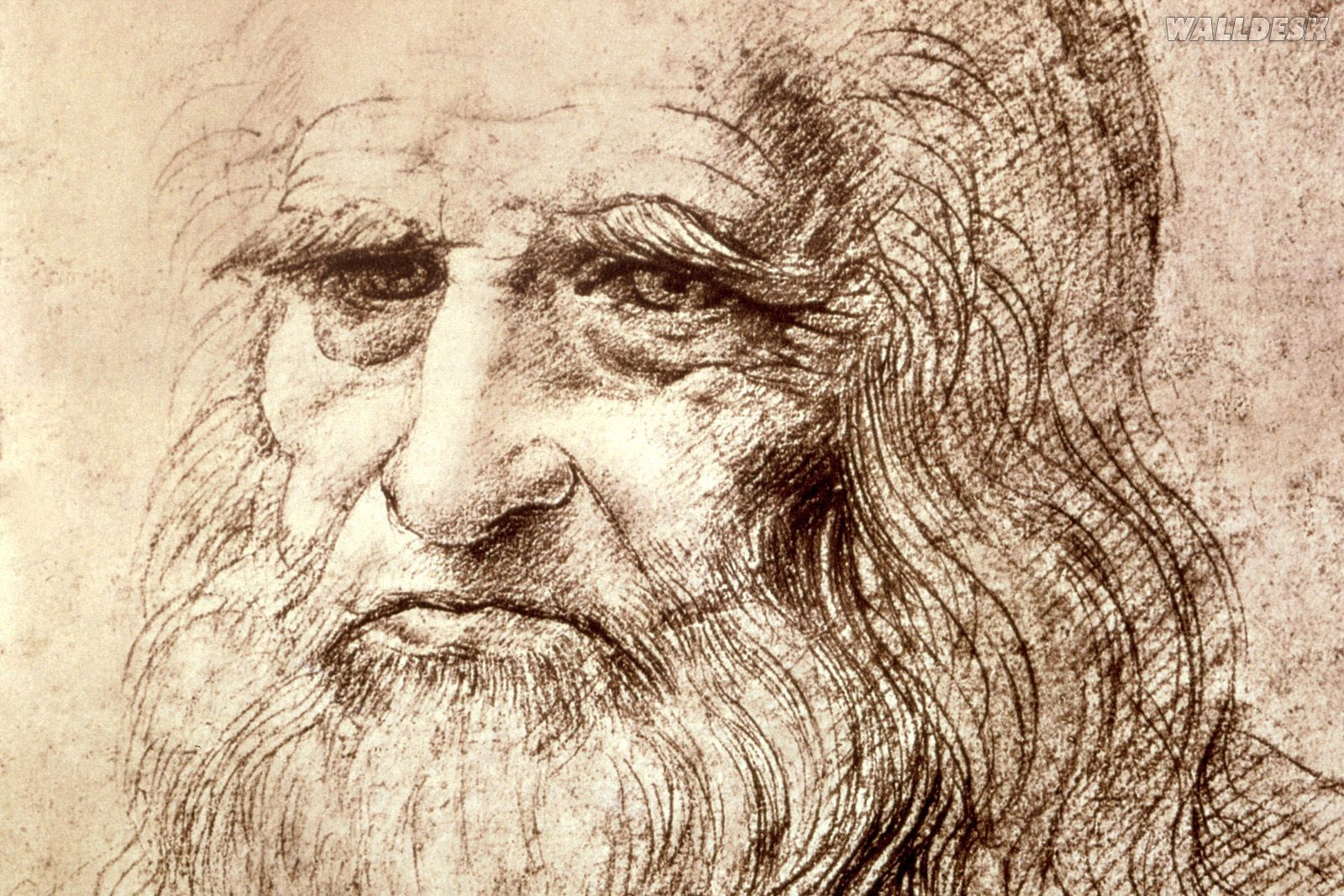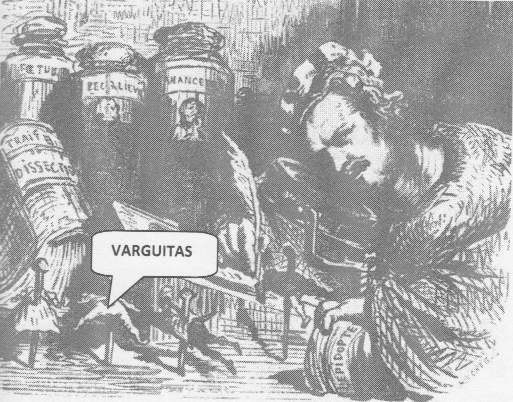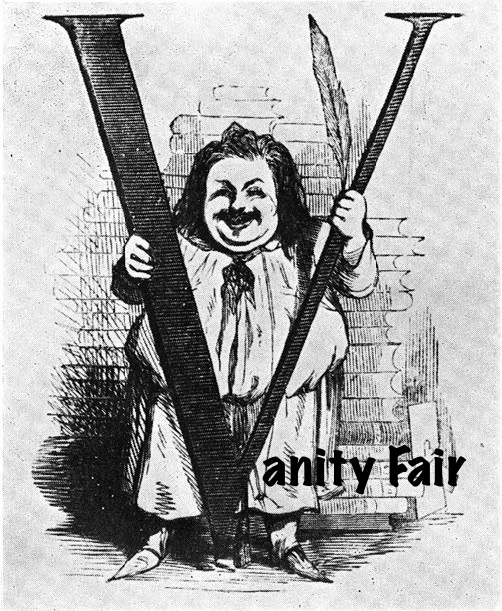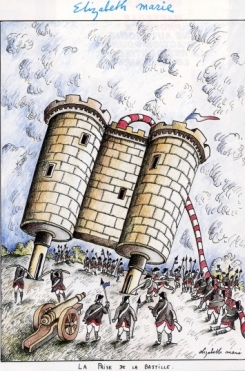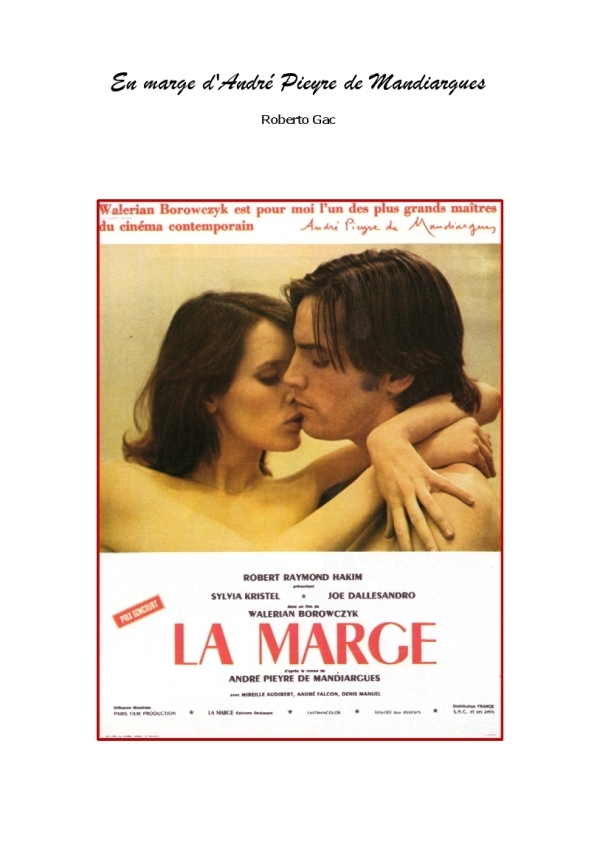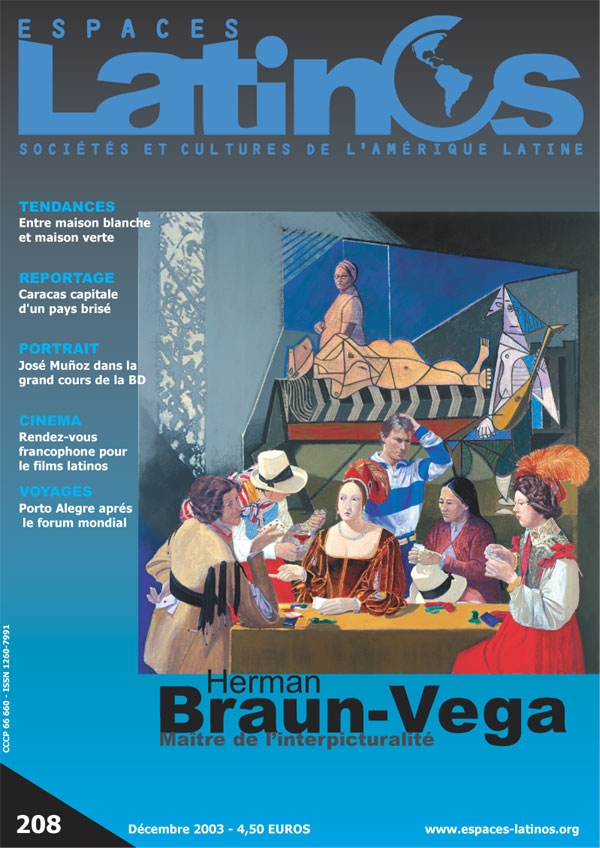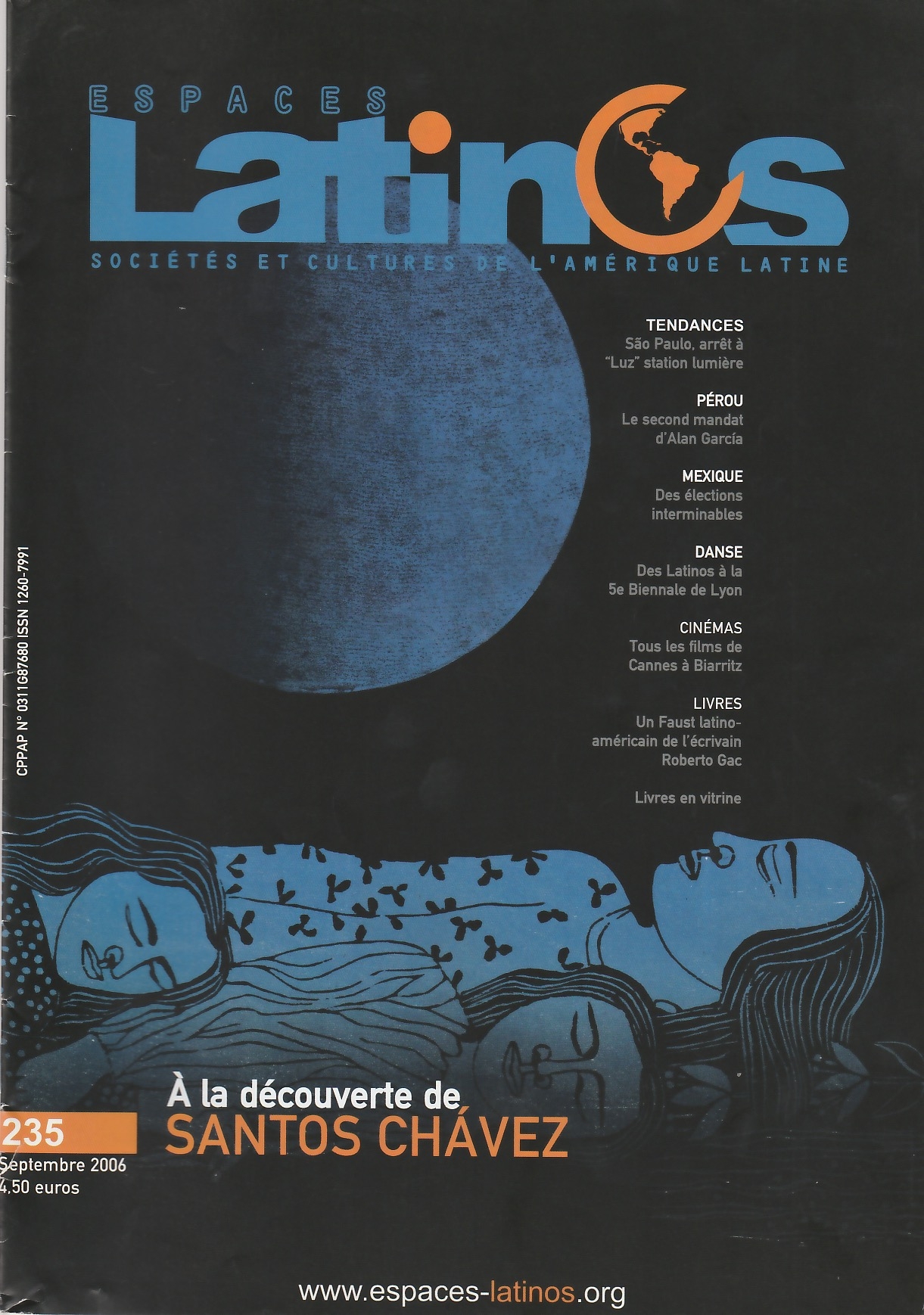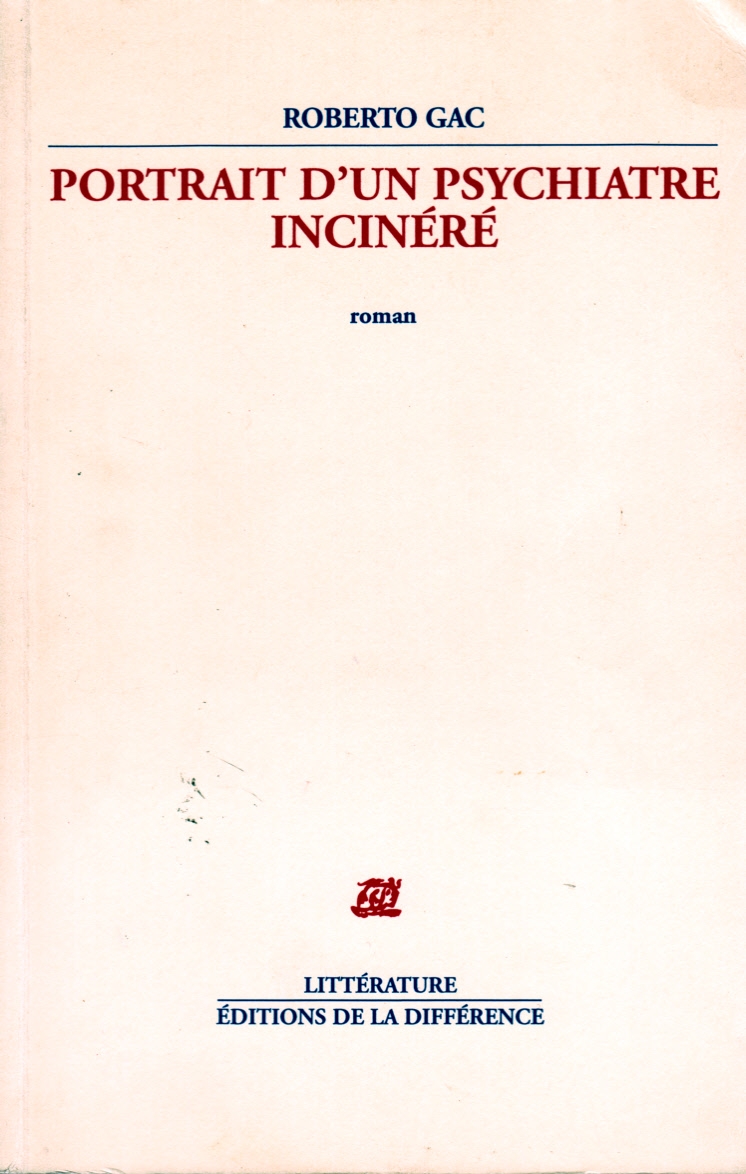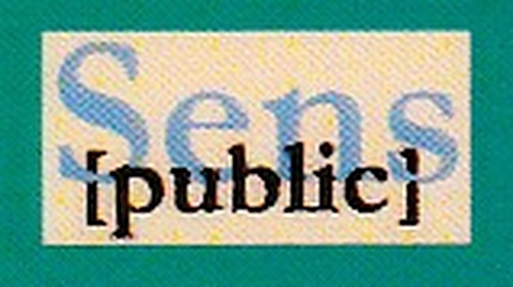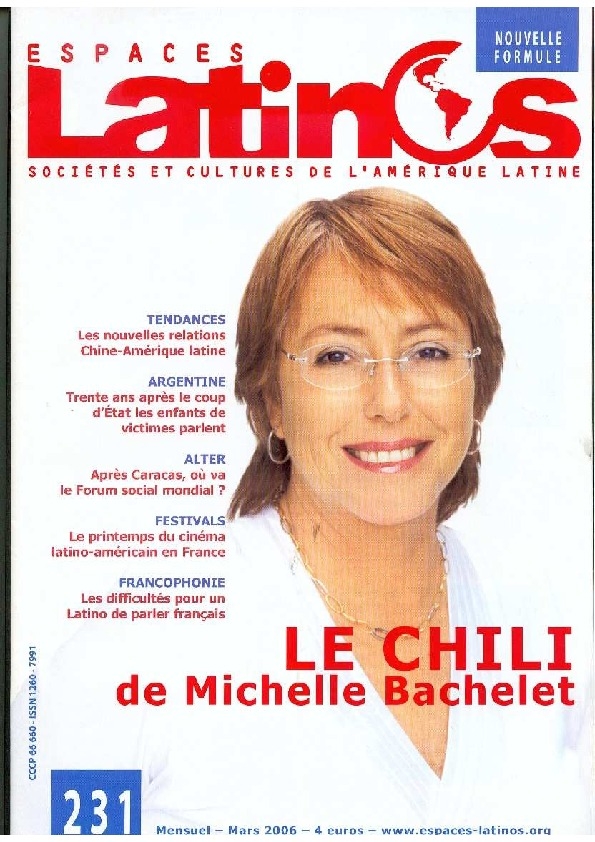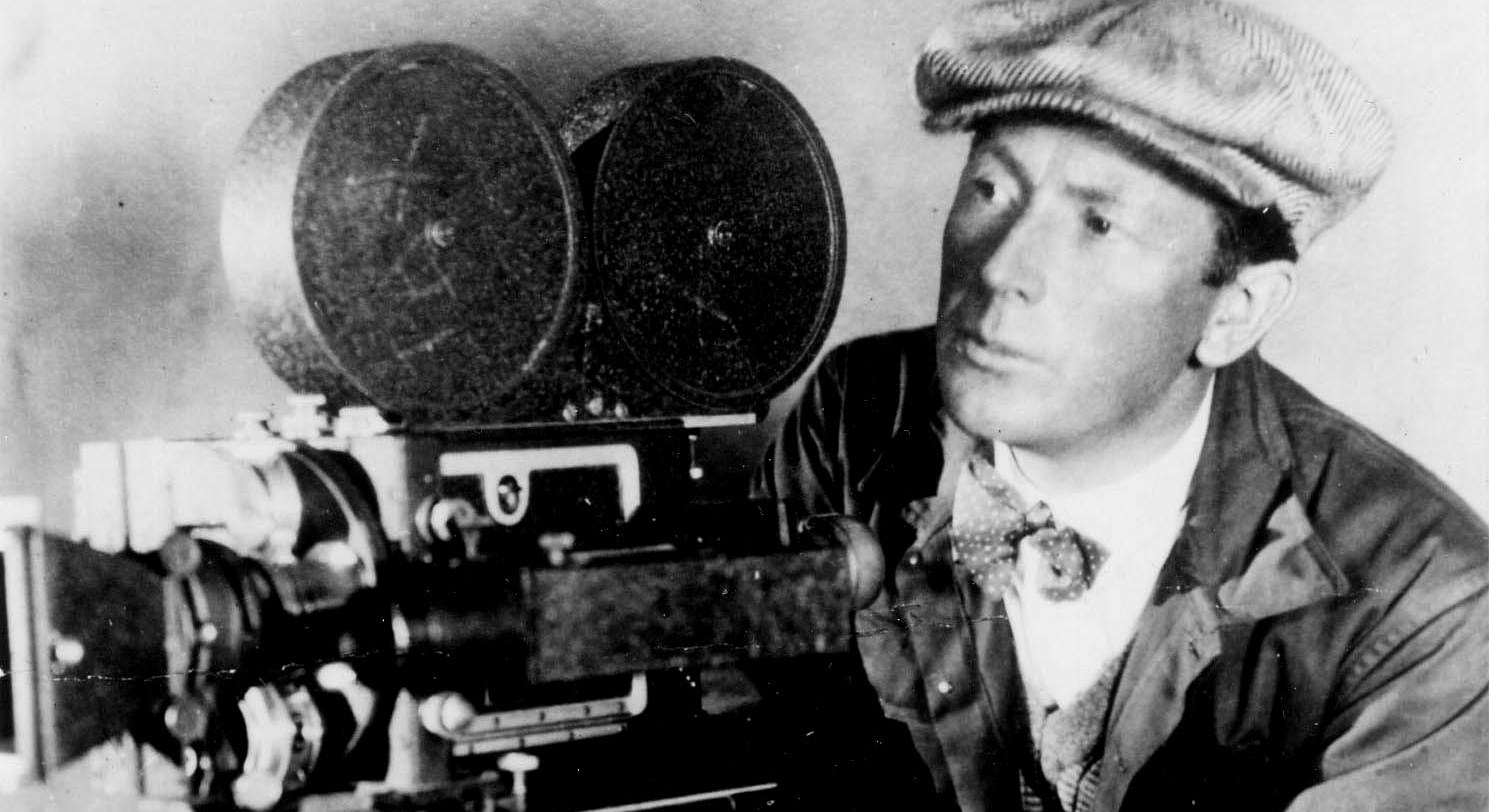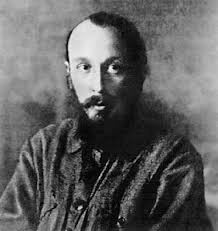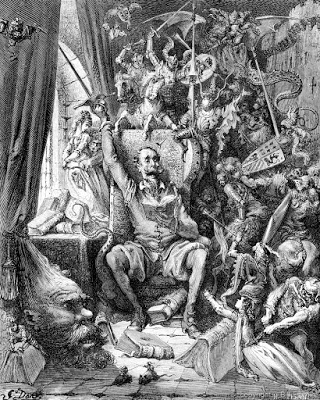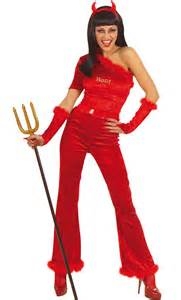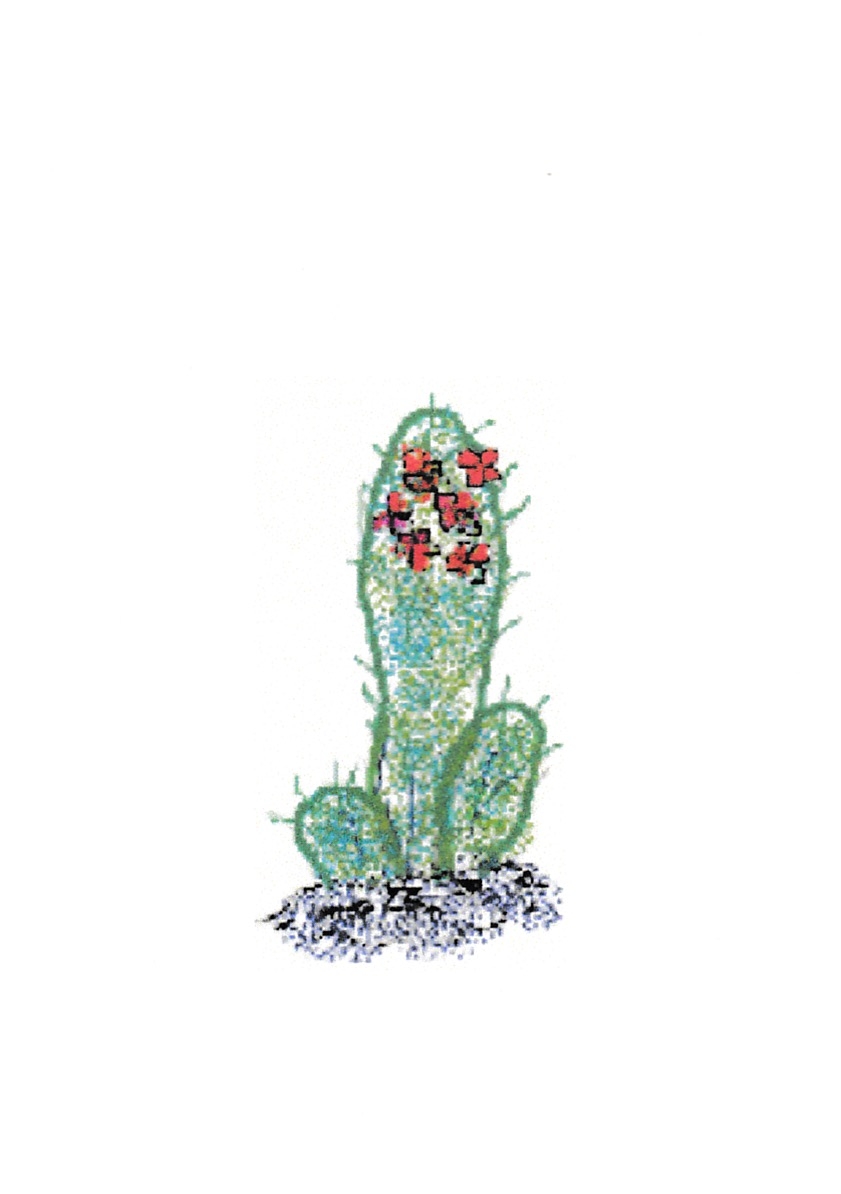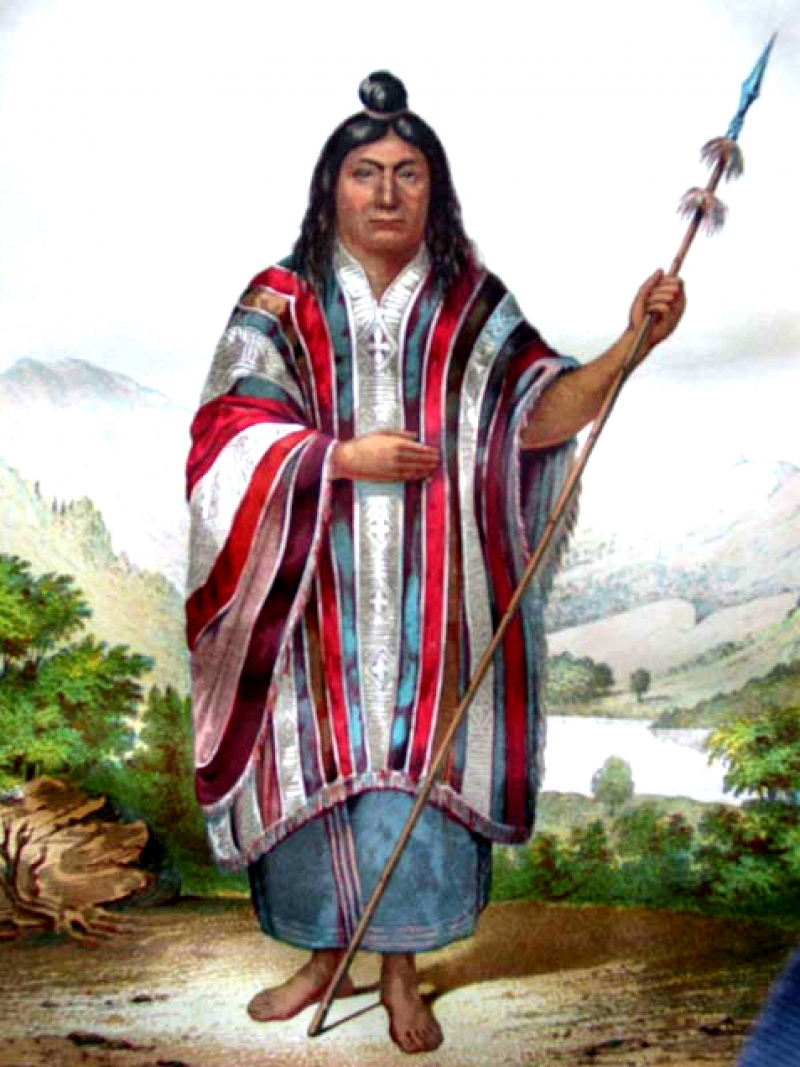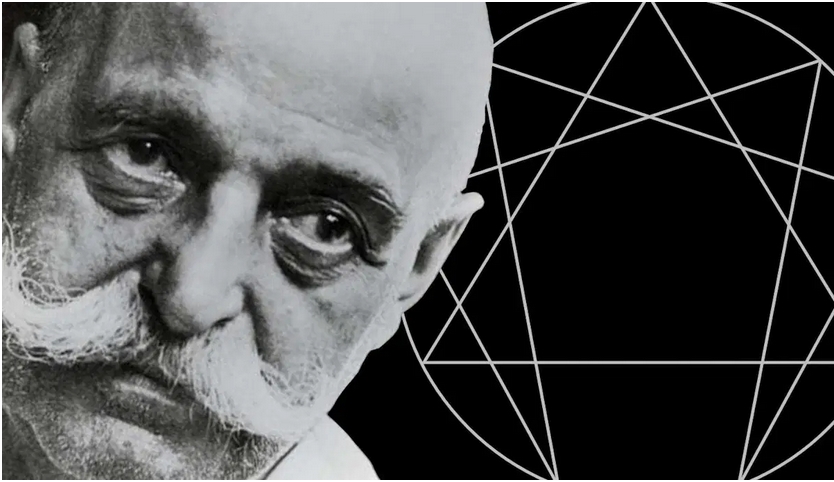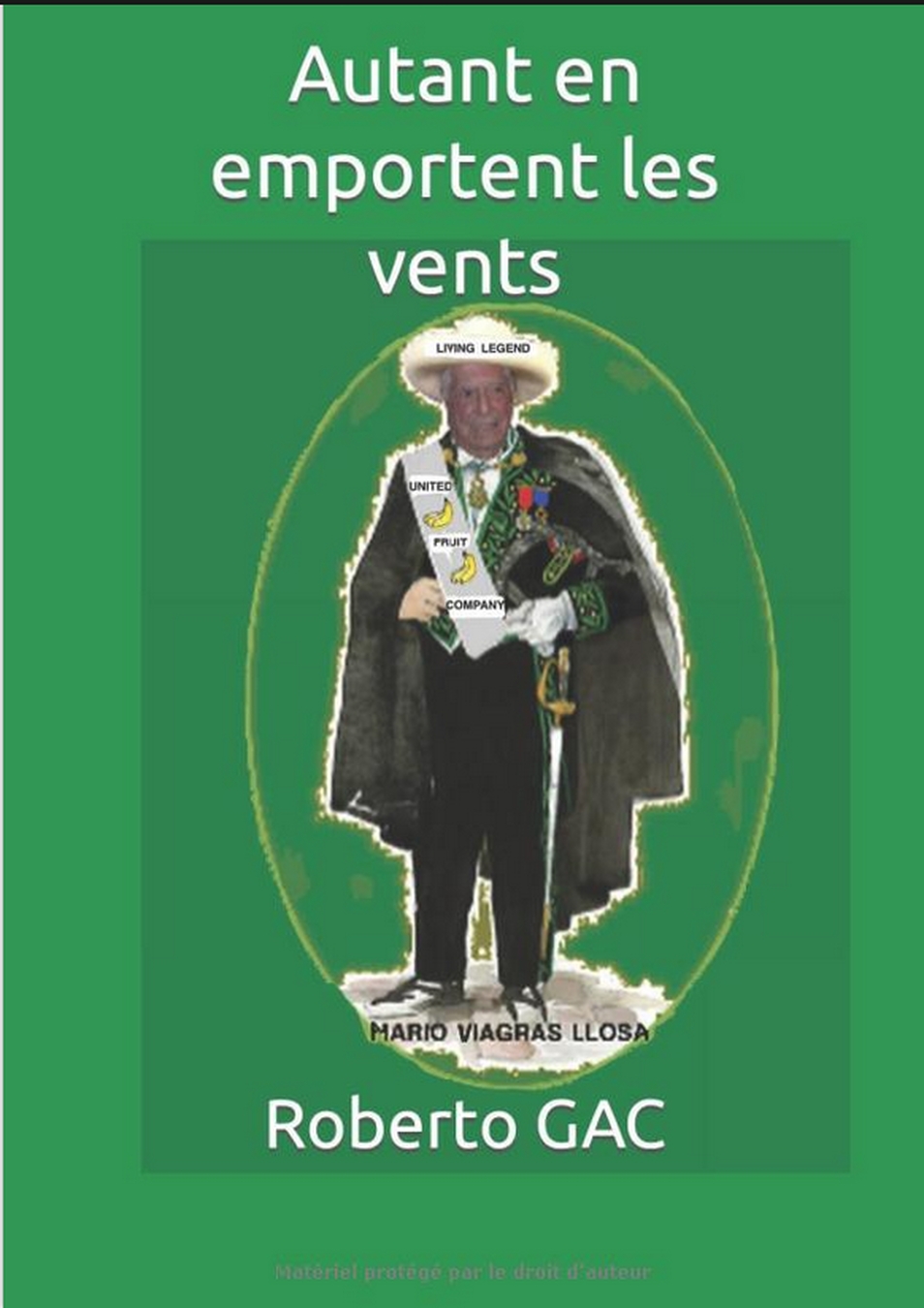L’illustration du Cycle Théorique de Roberto Gac, appuyée sur Le Commencement de Paul Klee, offre une cartographie visuelle très parlante de l’évolution littéraire de son œuvre, depuis un roman monolingue jusqu’à une création intertextuelle et plurilingue complexe.
Voici un commentaire structuré autour de cette spirale de la création :
La spirale : un chemin de transformation
La spirale au centre, inspirée du motif de Klee, suggère une dynamique d’expansion et de profondeur. Le point de départ, "La Curación", inscrit comme roman, marque une œuvre encore centrée, monolingue, narrative et linéaire.
Mais très vite, cette spirale s’élargit pour intégrer des anti-romans comme "El Bautismo" et "El Sueño" qui convoquent des symboliques fortes de transformation, de passage, de rêve ou d'inconscient, annonçant une mutation du roman vers une forme plus ouverte et hybride.
Vers une littérature plurilingue et intertextuelle
L’évolution mène à "La Guérison " (Dante), sommet du cycle, où se condensent plusieurs dimensions :
-
La guérison renvoie à la fonction cathartique ou thérapeutique de la littérature, mais cette "guérison" est avant tout la guérison du romanesque dévoyé, de la littérature contemporaine comme "parole putanisée" dénoncée par Gurdjieff in "Rencontres avec des Hommes Remarquables" :
"L'un des principaux moyens de développement de l'intelligence est la littérature. Mais à quoi peut bien servir la littérature de la civilisation contemporaine? Absolument à rien si ce n'est à la propagation de la parole putanisée."
-
L’ancrage dans Dante indique un retour et à la fois un prolongement dans une tradition littéraire majeure, revisitée.
-
On passe du monolinguisme du roman à une forme plurilingue, polyphonique, intertextuelle que Gac appelle "l’Intertexte".
Cette transformation fait écho aux pensées de Bakhtine (polyphonie, dialogisme) ou de Barthes (texte comme tissu de citations), tous deux présents dans les marges de l’illustration.
Un parcours guidé par des figures tutélaires
Les influences en périphérie donnent une carte mentale des affinités littéraires, philosophiques et psychologiques de Roberto Gac :
-
Freud, Joyce, Proust : introspection, mémoire, langage du rêve, monologue intérieur.
-
Gurdjieff : dimension spirituelle du chemin littéraire.
-
Madre/Montaña/Jazmín (M/M/J). Texte en espagnol (Chili) écrit en intertextualité avec La Madre de Maxime Gorki, La Montaña Mágica de Thomas Mann, La Comarca del Jazmín du poète chilien, Oscar Castro, écrivains liés aux grandes crises culturelles du XXe siècle, à l’éthique, à l’exil, à l’humanisme.
Ces influences ne sont pas simplement des références mais des interlocuteurs théoriques dans le dialogue de l’œuvre avec la tradition.
Éditorialisation et manifeste : un projet de littérature active
L'"éditorialisation" et le "Manifeste pour une nouvelle littérature" signalent que ce projet littéraire est aussi un projet critique et politique, soucieux de son mode de diffusion, de sa mise en forme, de sa portée sociale. Le lien avec les revues et les groupes "Sens Public" et "Tel Quel" renforce l’idée d’un engagement dans la réflexion collective sur la littérature.
Conclusion
Ce cycle représente une poétique du passage, de l’intériorité à l’altérité, du monolingue au plurilingue, du roman à l'Intertexte. L'œuvre de Roberto Gac devient un espace de guérison du romanesque, mais aussi de contamination volontaire par d'autres voix, d’autres langues, d’autres arts (cf. interpicturalité). C’est une littérature-monde, où le cheminement personnel est toujours en dialogue avec une constellation d’influences, une géographie littéraire mouvante et créatrice.
Exercices de théorie littéraire et théorie de l’Intertexte
S’inspirant sans doute de la Comtesse de Ségur, Sophie Rabau, maîtresse de conférences à la Sorbonne Nouvelle (et nouvelle romancière, auteure d'Embrasser Maria, Éd. Les Pérégrines, Paris 2022), s’est donné la peine de rédiger à l’intention de ses jeunes élèves, espiègles et désobéissants, un manuel très strict d’exercices de théorie littéraire... valable aussi pour tout écrivain impatient de gagner le prix Goncourt.
Sophie Rabau, assistée de Florian Pennanech, chargé de cours, a rédigé un remarquable recueil d’exercices à propos de la théorie littéraire. L’ouvrage, édité en forme de fascicule par les Presses de la Sorbonne Nouvelle, déploie en trois parties le mécanisme de création des concepts théoriques : par déduction, par extrapolation et par observation. Je ne peux décrire ici dans le détail les raisonnements qui soutiennent ces trois mécanismes, minutieusement étayés par une logique formelle impeccable, parfaitement aristotélicienne. Pour le lecteur qui aime les jeux de l’esprit, c’est un régal. Derrière le texte et ses connotations hautement pédagogiques (en dépit de quelques malheureuses erreurs romanesques) on aperçoit la célèbre « Bibliothèque de Babel » de l’écrivain latino-américain, Jorge Luis Borgès, et les théories de Gérard Genette qui sont utilisées (et souvent malmenées) presque comme un axe conducteur, tout au long des exercices. D'autres théoriciens (Jakobson et Barthes parmi eux) sont interpellés pour analyser les exemples pris dans l’histoire de la littérature. L’élan didactique des auteurs du fascicule est cohérent et d’un intérêt soutenu, d’autant plus qu’une subtile distance par rapport à leur sujet leur permet parfois une certaine drôlerie, une élégante joyeuseté digne de Borgès lui-même. On peut cependant regretter que, s’agissant d’une œuvre jouée comme une pièce pour piano à quatre mains, on ne puisse visualiser les mains. Qui pense ? Qui parle ? Qui écrit ? Pour des raisons pratiques imposées par la rédaction de cet essai, à mi-chemin entre le rapport de lecture et la critique textuelle, j’ai choisi comme auteur de référence Sophie R.
Donc, c’est « l’inter-relation » entre les textes qui me poussa à adopter, faute de mieux, le mot « intertexte », tout en acceptant l’ambiguïté du terme. En agissant de la sorte, je n’ai pas voulu travailler par simple déduction à partir d’un système déjà existant (le roman), ni tenter de construire un système à partir exclusivement d’un modèle déjà établi (par exemple, Ulysses, de James Joyce, Intertexte précurseur) ou, encore moins, de construire un système de toutes pièces (l’Intertexte a toujours comme référence un autre texte). En réalité, tout au début de ma démarche scripturale, je voulais simplement éviter de tomber dans la banalité romanesque, d’écrire des mièvreries sur mes états d’âme ou de produire des textes de divertissement pour gagner de l’argent. Je n’avais pas quitté l’exercice de la médecine et de la psychiatrie (qui me promettait un riche avenir aux États-Unis) pour écrire des romans à l'eau de rose, des polars ou pour me lancer dans la lutte idéologique en utilisant la littérature comme arme de combat. Et, bien entendu, je n’avais pas non plus la prétention d’inventer a priori un genre littéraire afin de m’en servir pour véhiculer mes idées. Non, je voulais, tout simplement, écrire. Et c’est en écrivant des milliers de pages que la nécessité de développer une nouvelle modalité narrative est venue s’imposer à ma conscience, surgissant de l’épaisseur de ma propre production textuelle, jusque-là chaotique et informe. Ma façon de procéder fut très simple, prévisible et logique d’un point de vue théorique : j’appliquai les principes de la science, l’observation et l’expérimentation que j’avais utilisées dans les laboratoires de la faculté de médecine, puis j’avançai, à tâtons, pour laisser de côté le roman conventionnel, le roman tout court, à la recherche, cette fois d’une façon pleinement consciente, de ce qui deviendrait l’Intertexte
Dans la première partie de ses exercices, Sophie R. examine le large éventail des concepts de théorie littéraire qui peuvent être conçus par «déduction». C’est dans cette première partie, en analysant Seuils de Gérard Genette, qu’elle fait la seule mention d’un phénomène néanmoins essentiel pour comprendre l’évolution de la littérature d’aujourd’hui. Je cite : « L’apparition des livres électroniques et la lecture en ligne ont ouvert un nouveau champ d’investigation que Seuils ne pouvait prévoir.4» Effectivement, Genette (comme d’ailleurs Barthes et tous les critiques et théoriciens ayant travaillé avant l’avènement de l’écriture électronique et de son utilisation informatique et, surtout, avant l’avènement d’Internet), n’eut pas le temps de mesurer l’importance de la révolution cybernétique pour l’incorporer d’une façon appropriée dans ses réflexions. Or, l’Intertexte est fondé, en tant que pratique scripturale, sur l’écriture électronique et sur Internet.5Cet aspect est si décisif qu’il aurait pu faire partie de ma définition de l’Intertexte comme genre narratif. Mais cela m’a semblé superflu, tant le passage de l’ère de l’imprimerie à l’ère de la cybernétique est une réalité incontournable.6
Restons pour le moment dans le cadre classique de l’ère de l’imprimerie et des concepts forgés avant l’apparition d’Internet puisque, dans ses Exercices de théorie littéraire, Sophie R. travaille principalement à l’intérieur de ce cadre : « Parmi les nombreux néologismes devenus d’usage courant proposés par Genette dans Discours du récit, une famille de termes en-lepse se distingue par sa remarquable plasticité : (…) l’analepse, la prolepse, la syllepse (syllepse itérative), la paralepse, la métalepse », etc. (p.19) Elle ajoutera le terme «isolepse» (iso, égal, lepse, prendre) pour compléter le système genettien et conclure qu’à l’heure actuelle la critique est nettement «isoleptique»: « Un commentateur peut trouver dans une œuvre une régularité, y découper des séquences équivalentes, ou bien construire, entre plusieurs œuvres, des parallèles, des éléments semblables.» (p.23) L’Intertexte serait-il donc «isoleptique»? « Sur le plan de la création littéraire, l’isolepse est une incitation à multiplier les expériences d’écriture (…) Elle offre donc un nouveau procédé d’écriture assez inédit. » (p.26) Puis, parlant toujours de l’invention de néologismes, elle reviendra sur une autre famille de mots genettiens « couramment usités, avec le substantif textualité qu’il décline, dans toute son œuvre, de manière similaire : transtextualité et, à l’intérieur de ce concept principal, l’intertextualité, l’hypertextualité (hypotexte, hypertexte, mimotexte), métatextualité, paratextualité, architextualité et autotextualité. » (p.27) (Je résume, bien sûr). Ensuite, dans ses Corrigés N° 1, 2, 3, 4, elle proposera quelques-uns de ses propres concepts pour parfaire la liste de Genette, notamment celui d’«antitextualité» et d’«antitexte»: « L’antitextualité désigne le fait qu’un texte prend la place d’un autre, le remplace ou cherche à le remplacer. » (p.29). Elle parle aussi d’une « antitextualité volontaire, dans le cadre d’une émulation, quand un auteur veut écrire une œuvre qui prendra la place d’une autre. L’Enéide comme antitexte des épopées homériques, par exemple ».(p.30) On approche, c’est évident, de l’Intertexte, en particulier de La Guérison », nouvelle Divine Comédie 7. Alors, « antitexte» au lieu d’«Intertexte»? « La dernière question que l’on peut se poser serait celle du texte qui n’aurait pas de genre, ou qui serait unique dans son genre (…) Or, un texte, qu’on le veuille ou non, appartient toujours à une classe…» (p. 33) Quelle classe pour l’Intertexte ? Une chose est certaine : on ne peut réduire l’Intertexte à un simple concept rhétorique. Ce serait une sorte de castration (castratura, pour utiliser un mot cher au Roland Barthes de S/Z), castración de sa perspective révolutionnaire en tant que nouveau genre narratif.8
Dans le chapitre 2 de la première partie, Construire un système à partir d’un modèle déjà établi, Sophie R. va se pencher sur la dimension communicationnelle de la littérature selon Roman Jakobson. Ce faisant, elle frôlera, à son insu, un élément fondamental de l’Intertexte : le lecteur comme agent décisif dans son élaboration. Un roman est écrit pour un lecteur, mais le rôle de celui-ci est purement passif, il est là pour lire, non pour écrire. Bien sûr, l’auteur (le romancier) est aussi un lecteur, parfois un « mauvais lecteur » de son propre texte, auquel il peut donner, de surcroît, une signification ou une importance erronée : « On peut tout à fait envisager qu’un auteur n’a pas compris la nature de son message : un message à une valeur poétique que son émetteur n’a pas vu. Genette, dans Fiction et Diction, nomme « littéralité conditionnelle » ce genre de cas – il veut dire par là que le caractère littéraire du texte est conditionné par la réception d’un lecteur et non par l’intention de l’auteur qui a un tout autre but. » (p. 39) Tout en le mettant en rapport avec l’auteur « mauvais lecteur », Sophie R. parle ici pour la première fois du lecteur, mais sans théoriser en profondeur sur sa position dans la littérature, position passive, purement réceptive dans le monde du roman. Ce qui n’est pas du tout le cas dans l’Intertexte.
La boîte à ouvrage de Sophie
En analysant le modèle logique (p.40) elle fera référence d’une façon plus appuyée au lecteur, notamment dans l’Exercice 1, Lire tous les livres et dans l’Exercice 2, Écrire pour tous les lecteurs. Il s’agit surtout de mettre en relief le « carré logique » qu’on attribue à Aristote :
3) Il faut écrire pour certains lecteurs
4) Il ne faut pas écrire pour certains lecteurs (p.41)
Les raisonnements qui accompagnent ce jeu aristotélicien sont d’une grande précision et d’une drôlerie à peine dissimulée, digne de la Comtesse de Ségur. Barthes, pour qui l’enjeu du travail littéraire (« de la littérature comme travail ») est de faire du lecteur non plus un consommateur mais un producteur du texte9, aurait sans doute ri devant cette exquise frivolité rhétorique et logique. Un peu plus loin, dans l’exercice N°3 Le système des genres littéraires, Sophie R. passant par-dessus toute frivolité, s’approchera de l’Intertexte : « Laissons de côté la Comédie et la Tragédie telles qu’elles sont définies par Aristote à partir de l’importance et de la qualité des personnages et allons à la proposition 4 où il nous faut imaginer un genre où les personnages principaux ne sont pas de condition supérieure, tandis que les personnages secondaires peuvent l’être. On peut certes trouver des exemples de ce dispositif : Les Bonnes de Jean Genet, certaines pièces de Marivaux, ou encore de Germinal de Zola (…) mais ces textes n’appartiennent pas à un même genre répertorié. Faut-il alors créer un nom de genre pour désigner la classe ainsi définie ? C’est l’intérêt théorique du carré logique que de soulever cette question. C’est alors à rien de moins que l’invention d’un nouveau rayon dans la bibliothèque de Babel que nous permet de rêver notre examen systématique. » (p.42) (Je souligne) « Or, quel modèle choisir ? » s’interroge encore Sophie R. Et elle répond, faisant appel à sa boîte à ouvrage : « Le choix d’un modèle comporte une part d’arbitraire et de bricolage : on prend le modèle dont on pense qu’il fonctionnera le mieux, quitte à revenir sur son choix chemin faisant ». (p.42) C’est ce que j’ai fait moi-même au moment de choisir un des modèles pour l’Intertexte : Ulysses, de James Joyce.
La lecture d’Ulysses n’est pas facile. Le Grand Bibliothécaire de Babel (et directeur de la « Biblioteca Nacional de Argentina » entre 1955 et 1973), Jorge Luis Borgès, qui aimait, de son propre aveu, davantage la lecture à l’écriture, ne se donna pas la peine de lire convenablement l’œuvre de l’écrivain irlandais, et cela en dépit de sa connaissance de l’anglais, langue qu’il dominait avec fierté10. Il ne comprenait pas l’engouement pour un livre porté aux nues par des critiques… qui ne le comprenaient pas non plus dans tous ses aspects. Même Richard Ellmann, considéré comme le meilleur spécialiste de Joyce, ne s’attarde pas suffisamment sur la construction intertextuelle de l’œuvre. Alors, je fus bien obligé d’examiner et de démonter le mécanisme intertextuel mis en œuvre sous la surface apparemment uniforme d’Ulysses, faisant l’effort, bien inutile, d’adresser à Philippe Sollers le résultat de mon investigation11.
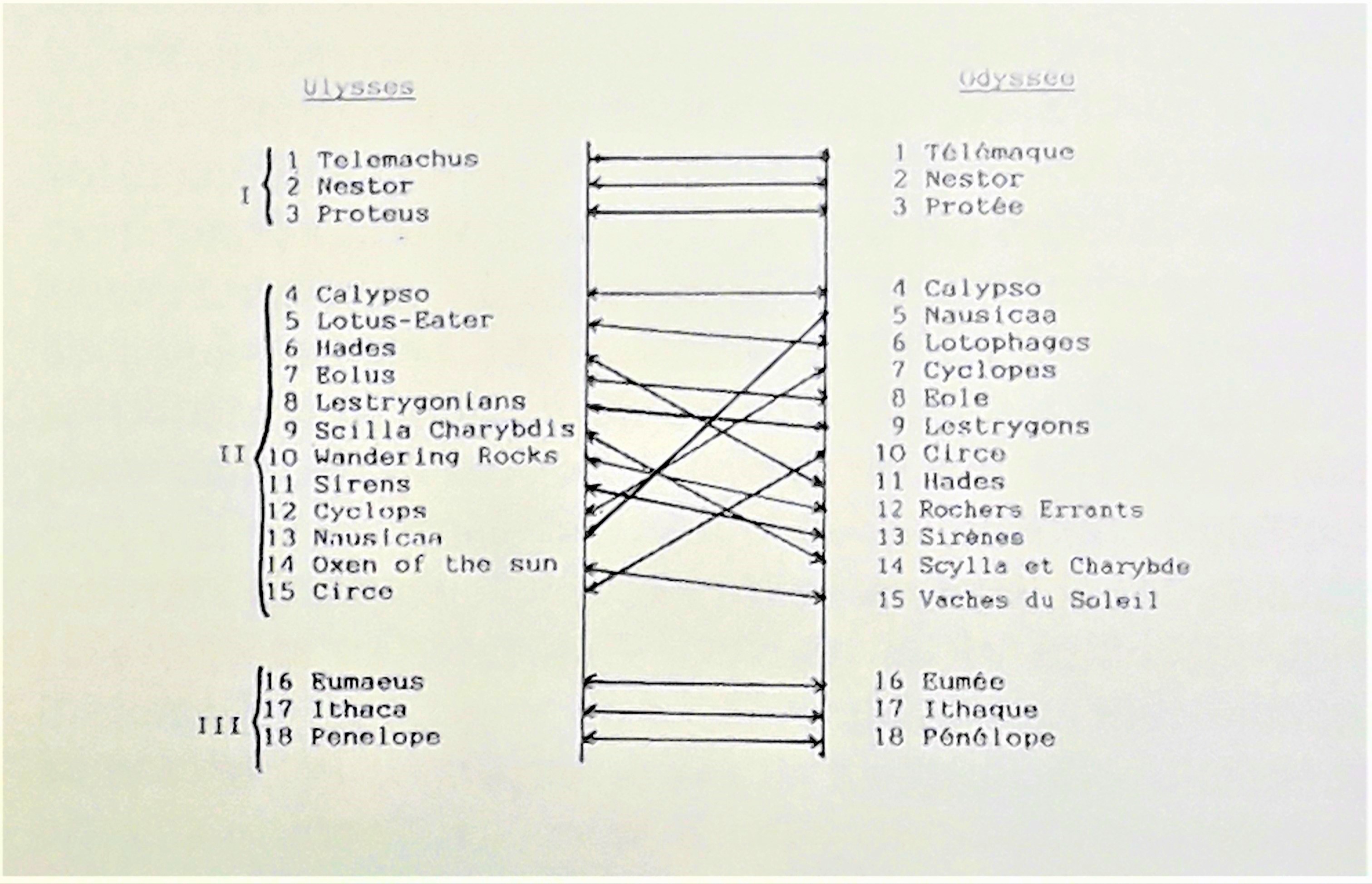
Tableau intertextuel Ulysse / Odyssée
En découvrant cette structure intertextuelle, tout en admirant l’intuition et l’audace scripturale de Joyce dans la construction d’un texte manifestement éloigné du roman conventionnel (non seulement par l’intertextualité sciemment choisie et structurée, mais aussi parce que Joyce donne une forme à la masse de son texte : la forme d’un pont 12), je me posai une question qui semblait évidente : pourquoi l’écrivain, intellectuellement très exigeant, avait-il choisi de travailler en intertextualité avec une œuvre écrite en grec (langue qu’il ne dominait pas) et non pas avec la Commedia de Dante Alighieri, matrice de l’italien moderne, langue qu’il connaissait assez bien ? (Joyce parlait italien à table avec ses enfants à l’époque où ils habitaient à Trieste). Alors, puisqu’il ne l’avait pas fait, j’allais le faire moi-même en prenant son Ulysses comme modèle. Le résultat, après plusieurs versions différentes, fut La Guérison.
Joyce était un ancien élève d’un lycée jésuite et son enfance et sa jeunesse ont été marquées par le catholicisme traditionaliste de l’Irlande du Sud. S’introduire dans la Commedia, le poème axial du christianisme (« le diamant de l’art catholique» selon Philippe Sollers13) était, sans doute, idéologiquement très difficile pour lui. Il avait raison de se méfier : La Guérison, en mettant à nu la Commedia, montre la qualité profondément révolutionnaire, dans un sens aussi bien individuel que social, de l’œuvre de Dante, dont l’apport le plus subversif est, peut-être, celui du dépassement du mythe chrétien vers sa poétisation. De mythe, il devient mythologie, à l’instar du mythe grec qui, en partie grâce à Homère, devient la mythologie grecque. C’en était trop pour les Papes contempteurs de Dante, qui voyaient dans son œuvre une critique et un affaiblissement redoutable du christianisme populaire, dont la naïveté est si nécessaire pour les intérêts matériels de l’Église ; c’était trop aussi pour Joyce, charmant petit-bourgeois de la ville de Dublin, toujours très catholique au fond de son cœur.
Passons rapidement sur le chapitre Construire un système de toutes pièces, car ce n’est pas le cas de l’Intertexte : il ne peut naître du néant, il est toujours tributaire d’autres textes. Barthes et sa disciple Julia Kristeva ont défini clairement (en s’appuyant sur Bakhtine et le dialogisme) le concept d’intertextualité, dépassant, par leur prolixité, le cadre fixé par Genette pour lequel l’intertextualité est englobée dans la « transtextualité ». Sophie R. le souligne dans l’Invention de Néologismes, exercice 2, La transtextualité et ses variantes. En ce qui concerne l’Intertexte, une seule incise est sans doute intéressante : celle qui rappelle la définition de Jakobson du couple métaphore / métonymie, dans la mesure où l’Intertexte utilise la métonymie comme figure rhétorique centrale, contrairement au roman, fondé plus largement sur la métaphore. 14 Par exemple, dans La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain) j’ai recours à un large éventail de citations prises dans les Faust classiques (Lenau, Goethe, Marlowe, etc.), que j’utilise ensuite non comme de simples citations métatextuelles, périphériques, mais comme des textes s’incorporant au texte principal du récit, sur un même niveau. Le lecteur du Faust latino-américain passe au Faust de Lenau, de Goethe, de Marlowe, de Valéry, de Thomas Mann, etc., sans aucune transition, comme s’il s’agissait d’un seul et même texte. La substitution métonymique est totale. Où est l’intérêt de cette procédure ? Cela dépend du lecteur, qui est appelé à introduire ses propres textes, à participer lui aussi à l’écriture de l’Intertexte, exactement comme je l’ai fait avec la légende faustienne. Tout cela est impossible dans le roman, puisque le roman est un texte fermé au lecteur, qui doit se contenter de lire ce que le romancier lui offre. Bien sûr, ce jeu entre lecture / écriture semble encore quelque peu utopique, mais les nouvelles technologies dérivées de l’invention de l’écriture électronique le rendent de plus en plus réalisable.15
Nous disions au début de cet article que dans ses Exercices de théorie littéraire Sophie R. prend comme outil de travail la logique formelle, tout en offrant à ses étudiants l’opportunité de prolonger leurs propres réflexions en suivant la même voie, parfaitement rodée depuis Aristote. Elle ira jusqu’à leur proposer de construire un système de toutes pièces (p. 44) y compris en ayant recours aux « tableaux ». (p. 46) Or, dans l’un de ces tableaux, elle fera mention d’autres concepts très intéressants pour éclairer l’Intertexte, notamment l’imitation et la transformation (dans ce sens, La Guérison serait une imitation de la Commedia, impliquant une transformation du texte dantesque). Plus compliqué est son tableau sur le syndrome de la case blanche, où elle touche, à son insu, un autre élément très important pour l’Intertexte : la dimension autobiographique du récit. Plus que le roman, l’Intertexte fait appel à l’autobiographie, réelle ou fictive, de l’écrivain. Dans La Société des Hommes Célestes, je fais le récit de ma propre éducation depuis l’école maternelle jusqu’à mes études en médecine et en philosophie, passant par l’éducation religieuse, l’école militaire, l’«école de psychanalyse» et l’« école de l’amour». C’est l’axe narratif du Faust latino-américain parti hardiment à la recherche de la connaissance depuis la petite enfance. Bien sûr, cette autobiographie comporte beaucoup d’aspects fictionnels imposés par l’architecture faustienne de la narration, mais elle est le contrepoint scriptural d’une vie. 16
Sophie R., toujours dans son tableau le syndrome de la case blanche, essayera d’y caser l’autobiographie et ses relations avec le roman, ce qui la poussera à parler de « l’autofiction » : « Serge Doubrosky écrit en 1977 un roman intitulé Fils dont le héros s’appelle Serge Doubrovsky. Il invente ainsi le genre de l’autofiction (néologisme qu’il forge en cette occasion), qui a connu beaucoup de succès depuis. » (p.49) L’éminente théoricienne (au CV flamboyant) se trompe. L’autofiction a été « inventée » par Marcel Proust, bien plus tôt. C’est lui qui fait coïncider pour la première fois, dans une œuvre de grande envergure comme la Recherche, le nom de l’auteur avec celui du protagoniste du texte 17. Cet escamotage historique et rhétorique de la Recherche n’est pas une méprise anodine. Elle est révélatrice d’une vision romanesque de la littérature. Car la Recherche, l’un des « modèles » de l’Intertexte, n’est pas un roman, mais bel et bien une « autofiction », genre intermédiaire entre le roman et l’Intertexte18. On peut spéculer à l’infini sur la distance entre l’auteur et le narrateur, nettement décelable dans le roman comme genre littéraire, mais dans la Recherche, qui se situe au-delà du roman, cette distance n’existe pas ou elle n’est pas de la même nature que dans Jean Santeuil, roman écrit à la troisième personne du singulier par le jeune Proust avant son œuvre maîtresse. Sophie R., analysant le Discours du récit de Genette, se méprend sur la véritable dimension narrative de la Recherche: « Plus encore, alors que l’on découvre depuis des années, grâce à la critique génétique qui se penche sur les brouillons et les manuscrits, que l’œuvre de Proust est totalement inachevée, de sorte qu’on en rencontre aujourd’hui même dans les librairies de multiples versions concurrentes, bien différentes de celles que connaissait Genette à l’époque où il écrivait Discours du récit (je souligne), cela ne signifie pour autant que la dimension proprement théorique de cet essai en soit invalidée. Comme l’écrit Genette dans Codicille, la Recherche telle qu’elle apparaît dans Figures III n’est finalement qu’«une sorte d’objet narratif non identifié, presque apocryphe, et forgé pour les besoins de la cause narratologique ». (p.13) C’est stupéfiant.
Nous pouvons nous demander ce que Proust, qui prolongea héroïquement sa vie de malade asthmatique pour pouvoir écrire le mot « Fin » au terme du manuscrit de la Recherche, penserait d’une affirmation si catégorique comme celle de Sophie R., stipulant que son œuvre est « totalement inachevée » et qu’elle comporte de « multiples versions » différentes.19 Lesquelles ? A part les mauvaises traductions (surtout en espagnol), la Recherche est un corpus narratif solide et univoque (une seule voix : celle de Marcel Proust). Si les imprécisions proustologiques de la théoricienne à propos de la Recherche sont regrettables (ainsi que celles de Genette qui parle -je répète pour souligner son extravagance- « d’une sorte d’objet narratif non identifié, presque apocryphe »), c’est parce que sa propre conception de la littérature est essentiellement « romanesque ». Sur ce point, aucune différence entre elle et un romancier comme William Styron, l’auteur du best-seller Le Choix de Sophie, où une mère doit faire le douloureux choix entre ses deux enfants, dont un seulement échappera à la mort dans un camp de concentration nazi.
Le choix de Sophie : roman ou intertexte ?
Imitant un peu Julia Kristeva, sémiologue qui, poussée par la mode germanopratine du succès parisien, s’éloigna de la linguistique pour écrire des romans (y compris un « thriller » désastreux), Sophie R. est devenue, elle aussi, romancière. Dans Embrasser Maria (Ed. Les Pérégrines, 161 pages, Paris 2022) 20 la narratrice, Sophia, s’approchant de la démarche proustienne, a le même nom que l’autrice, Sophie (la lettre «a» à la place de la lettre «e» rappelle forcément La Disparition, le roman de Georges Perec qui exclut la lettre « e » de son récit, mais ce remplacement de la voyelle n’arrive pas à camoufler le jeu identitaire indéniable entre l’autrice et la narratrice). Seulement, dans À la Recherche du temps perdu le narrateur et protagoniste - «Marcel» - est un écrivain à l’égal de l’auteur, Marcel Proust, qui déroule devant le lecteur sa propre vie « scripturale ». Écrire était son plus ardent désir, sa « vocation ». (Barthes voyait dans « le désir d’écrire » l’un des axes conducteurs de la Recherche qui serait, vue sous cet angle, l’histoire de l’accomplissement d’une écriture). La Recherche et ses 4000 pages sont loin d’Embrasser Maria mais, en revanche, ce premier roman de Sophie R. remplit avec virtuosité la case blanche du tableau de Philippe Lejeune pour laquelle il n’y avait pas encore un exemple concret21. Maintenant, c’est fait. Doit-on saluer un exploit narratologique et rhétorique historique ? De toute évidence, la théoricienne n’arrive pas à concevoir un genre narratif différent du roman, elle hésite à s’arracher au romanesque, choix déchirant et douloureux.
Pour revenir à La Guérison (la guérison du romanesque, bien entendu) ouvrage, nous disions, qui implique quelque chose comme une « transformation » de la Divine Comédie, serait-elle seulement un hypertexte inventé par un romancier à la limite de la folie ou une simple « hétérométalepse » dans le sens genettien du terme, et non pas un Intertexte ?22 Sophie R. assure que dans l’hétérométalepse, telle qu’elle la conçoit, celui qui réalise la métalepse est une autre personne que l’auteur et que « c’est au sein d’une réécriture -d’une opération hypertextuelle donc- que l’on peut opérer une telle transformation. On peut parfaitement concevoir, par exemple, une réécriture de l’Odyssée… » (p.52) J’abrège son propos pour mettre l’accent sur la possibilité qu’elle envisage, bien in ritardo, d’une réécriture de l’épopée homérique (performance intertextuelle déjà réalisée par Joyce en 1920 dans Ulysses, rappelons-le). Pour ma part, je préfère utiliser mon propre néologisme -l’Intertexte- pour dénommer la « réécriture » de la Divine Comédie : « La Guérison Intertexte » au lieu de « La Guérison Hétérométalepse » . Cela dit, si voir dans l’Intertexte un simple concept rhétorique correspond à une « castratura » de sa dimension comme genre narratif, lire La Guérison comme un roman historique autour de Dante (il y en a des dizaines) correspond à une lecture corsetée qui laisse en marge le véritable but de l’ouvrage : dépasser le roman comme forme narrative, aller vers une nouvelle forme de narrer. Le jeu intertextuel avec la Commedia n’est, au fond, qu’un moyen pour y accéder. La preuve (et contre preuve) est La Société des Hommes Célestes. Dans la SHC, intertexte qui a suivi La Guérison, je suis passé de l’expérimentation intertextuelle autour de l’œuvre d’un seul auteur (Dante), à l’intertextualité expérimentale avec le collège faustien (Marlowe, Lenau, Goethe, etc.), non pas pour écrire un nouveau Faust, mais toujours dans le but de dépasser les limites étriquées du roman. Dans ce sens, j'utilise la légende faustienne à la façon d'un fabuleux tremplin. Le Faust latino-américain (le titre rappelle le Faust Irlandais de Lawrence Durrell) n'est qu'une conséquence de ma tentative « post -romanesque».
Sophie R., dans le dernier chapitre de la première partie de son ouvrage, -Paradoxes et impossibilités- revient sur la problématique posée, d’un point de vue théorique, par la « lecture », notamment dans l’Exercice N°1, Écrire pour ne pas être lu. C’est émouvant. Elle appelle cela « lecture antilectoriale » et elle prend comme exemple une fois de plus Ulysses de Joyce, œuvre vouée à une lecture antilectoriale partielle : « C’est à peu près ce que dit Joyce à propos de son roman Ulysses quand il déclare, si l’on en croit Lacan, que son travail ne cessera de donner du travail aux universitaires, autrement dit qu’aucun commentateur savant ne parviendra à rendre compte de l’ensemble des allusions et références dont il a émaillé son texte ».(p.59) C’est faux en ce qui concerne Ulysses, livre dense mais intégralement lisible dans sa version originale en anglais. Néanmoins, c’est vrai en ce qui concerne Finnegans Wake, ouvrage écrit pour une lecture antilectoriale presque totale : le texte mélange plus d’une dizaine de langues, et il est semé de néologismes et de références factuelles approximatives, un peu comme dans un cauchemar nocturne. La métaphore-métonymie narratologique est magnifique et, grâce à cela, la lecture, très difficile, est néanmoins praticable... et passionnante. Cependant, Joyce voulait être lu, ne serait-ce que par des universitaires ou des théoriciens de la littérature. « La lecture antilectoriale nie une conception conative (centrée sur le destinataire) de l’écriture littéraire : le but de l’écriture littéraire ne serait pas une interaction avec un ou plusieurs autres »,(p.59) précise la théoricienne. Ceci est concevable peut-être dans le monde du roman, mais pas du tout dans celui de l’Intertexte. Le roman, nous le disions un peu plus haut, est un texte fermé scripturalement, qui, à la rigueur, n’a besoin d’aucun lecteur pour exister comme textualité : le lecteur est un élément complètement passif, il est là pour lire … ou ne pas lire. 23 L’Intertexte, par contre, a absolument besoin du lecteur pour exister en tant que tel, car le lecteur est appelé à écrire lui-aussi, à devenir « lecteur-écrivain » et à modifier, s’il le veut, le texte qu’il est en train de lire. Bien entendu, un lecteur naïf pourrait lire un Intertexte comme un roman un peu bizarre, pas très différent d’un autre roman. On est toujours dans le champ de la littérature narrative. Toutefois,« le vrai lecteur est celui qui veut écrire », disait Roland Barthes dans sa Théorie du Texte24, théorie, d’ailleurs, dont Sophie R. ne tient aucun compte dans ses Exercices, justifiant ainsi le mécontentement et le courroux de ses élèves chahuteurs.
Alors, qu’en est-il de l’«autolecture», de l’écriture pour soi, de l’«écriture privée», à l’instar de celle d’un journal intime qui n’envisage aucun destinataire? « On s’aperçoit alors que nous manquons de mots et d’idées pour désigner le curieux phénomène qui fait que l’on connaît généralement le texte qu’on vient d’écrire, alors qu’on ne l’a pas « lu » strictu sensu : comment appeler la prise de connaissance de ce que l’on écrit au fur et à mesure qu’on l’écrit et peut-on encore l’appeler « lecture » ? » (p.60) Brave question. Elle est au centre de l’acte très mystérieux d’écrire, de celui de l’attention-sur-soi au moment de l’écriture. Roland Barthes parlerait peut-être des « haïkus », les micro-poèmes de la tradition poétique japonaise, textes minimes qui veulent saisir dans son immédiateté le couple conscience-écriture et qui ont hanté la dernière partie de son œuvre et de sa vie.25 Or, l’autolecture se situe à un niveau de conscience différent de celui de l'haïku ; elle est, dans le meilleur des cas, un moyen de travail qui s’active chaque fois que l’écrivain révise et corrige son texte. C’est ce que Flaubert faisait sans cesse, toujours en quête de la phrase parfaite. Et Proust, corrigeant implacablement son texte en y ajoutant ses fameuses «paperolles» pour parachever son œuvre.26 Ou encore Michel Butor, dont chacun de ses livres est le fruit de plusieurs versions préalables.27 L’autolecture est une procédure déterminante de la qualité finale d’un texte. Le paradoxe «écrire pour ne pas être lu», s’efface de lui-même dans le cas de l’écrivain soucieux de « bien écrire ». On pourrait dire que le « premier » lecteur-écrivain est l’auteur lui-même et cela sans distinction de genres. Roman ou Intertexte sont le produit d’un lecteur-écrivain, même si le romancier (surtout le « mauvais » romancier, le romancier cliché, le romancier mécanique, le romancier automate, le romancier commercial) ne tient pas compte de cette dimension de son travail. En revanche, l’écrivain d’Intertextes (l’écrivain intertextuel) est, nécessairement, conscient de sa condition de « lecteur-écrivain ».
L’« écrivain intertextuel » (appelons-le ainsi) a recours aisément à l’« extrapolation ». « Celle-ci (signale Sophie R. au début de la partie II de son manuel) se situe à mi-chemin entre l’induction et la déduction, et elle désigne le recours à un concept en dehors du domaine où il est habituellement utilisé. »(p.65) Les extrapolations peuvent être purement littéraires, mais elles peuvent aussi aller chercher leurs objets dans d’autres arts ou dans les sciences. Cette dernière possibilité a été décisive pour moi, dans la mesure où je considère que le roman comme genre littéraire est « newtonien », tandis que l’Intertexte est « einsteinien ».28 Cela est particulièrement clair lorsqu’on compare le roman de personnages du XIXe siècle avec les intertextes précurseurs comme Ulysses, ou avec une autofiction comme la Recherche. « Toute la question est alors de savoir dans quelle mesure ces emprunts au discours des sciences constituent des métaphores et dans quelle mesure ils sont pris de façon littérale »,(p.66) prévient Sophie R. Dans Bakhtine, le roman et l’Intertexte, je mets en exergue le recours très fréquent de Bakhtine aux modèles des sciences, surtout à l’astronomie, « pas toujours comme métaphore »29. En effet, le grand théoricien du roman ne se prive pas d’«extrapoler » les modèles de la science vers la littérature, donnant ainsi à ses théories une validité supplémentaire. Pour ma part, l’extrapolation que je fais entre physique et littérature dans ma Théorie de l’Intertexte est avant tout théorique. Il ne s’agit pas d’extrapolations opérées entre des textes littéraires et la mécanique newtonienne ou la théorie de la relativité, mais de prendre appui sur ces dernières pour analyser le fonctionnement du roman. C’est ainsi que dans Bakhtine, le roman et l’Intertexte, j’ébauche les extrapolations qui éclairent la différence entre les deux genres («Théories esthétiques / Théories scientifiques»30), ébauche que je développe plus longuement dans Proust, Bakhtine et la polyphonie romanesque chez Dostoïevski 31. L’extrapolation est donc une procédure qui peut avoir lieu non seulement entre la science et les textes de fiction32, mais aussi entre les sciences exactes et les théories littéraires. Sophie R. abordera l’extrapolation en prenant comme référence la géométrie et les translations qui s’opèrent au niveau des figures géométriques : « On définit en géométrie la translation comme le déplacement d’une figure géométrique d’une certaine distance, suivant une certaine direction, autrement dit, suivant un vecteur. La translation est une transformation très limitée (…) La figure est pour ainsi dire reproduite exactement à l’identique, mais en un autre lieu…» (p. 67) Cependant, comme elle le reconnaît à la fin de son très intéressant Exercice sur la translation, « lorsque l’on tente d’extrapoler de la géométrie à la littérature, la notion de translation s’éparpille en une multitude de concepts dont aucun ne s’impose avec la force de l’évidence – or, lorsqu’on fabrique un concept, un des signes du succès de l’entreprise est d’avoir la sensation qu’il était nécessaire, qu’il vient combler un manque »(p. 71)
À cet égard, il est sans doute utile de mentionner Madre / Montaña/ Jazmín 33, Intertexte écrit en espagnol en intertextualité avec La Mère de Gorki, La Montagne Magique de Thomas Mann et La Comarca del Jazmín du poète chilien Oscar Castro. J’utilise le carré, la croix, le cercle et la spirale comme figures géométriques pour donner une forme à l’ensemble du texte et cela en rapport esthétique avec le récit, caractéristique essentielle de l’Intertexte. Le récit de M/M/J raconte les luttes de l’Unidad Popular chilienne au début des années 70, telles qu’on les observait depuis la France. Le texte qui raconte la bataille de La Moneda, le palais présidentiel où Salvador Allende mourut en martyr, est construit en forme de carré dans une sorte de translation de la forme carrée du palais. De plus, puisque le récit est écrit à Paris, ville développée en spirale autour d’un cercle (l’île de la Cité), il a été structuré suivant aussi les données géométriques de la spirale. Le jeu entre les textes et les figures géométriques se fait en tenant compte des théories de Kandinsky et de Klee à propos de l’engendrement du carré par la croix et de la spirale par le cercle34. Pour sûr, toutes ces subtilités (ou complexités) structurelles échappent au roman, dont la masse textuelle n’a pas d’autre forme que celle du nombre de pages et de son organisation éventuelle en chapitres, coupures, etc., mais ces complexités formelles sont normales dans la structure de l’Intertexte. Sophie Rabau, prisonnière des limites du roman, constate que « la translation en géométrie suppose en effet une identité des figures, tandis qu’en littérature, dès lors qu’on emploie le terme « translation » de façon métaphorique, cette identité est introuvable. Tout ce que l’on peut avoir, c’est une analogie entre deux textes. Or cette analogie est largement construite par le lecteur. On pourrait ici proposer une loi : toute translation est lectoriale. La translation est dans l’œil du lecteur qui fabrique de la similarité et qui construit de fait la relation translationnelle.»(p.71) La loi proposée n’est valable, à la rigueur, que dans le domaine du roman, mais pas dans celui de l’Intertexte, comme M/M/J le montre clairement : la relation entre les figures géométriques et les textes qui composent M/M/J n’est pas purement « lectoriale », subjective ; elle est le produit de l’écriture du « lecteur-écrivain » et fait partie objectivement de la structure textuelle.
La théoricienne et pédagogue sorbonnarde définira ensuite, dans le même Exercice (avec une certaine ambiguïté, sans doute inévitable, tant le sujet est complexe), d’autres concepts théoriques tels que monotranslation, polytranslation, translation en synchronie, translation en diachronie, et parlera de translation (en anglais), translatio (en latin) etc. « On peut imaginer des dispositifs, comme celui d’un texte mouvant, au sens littéral, c’est-à-dire dont les éléments se déplaceraient réellement sous nos yeux ».(p.68) Puis, sans trop s’attarder sur la révolution cybernétique, elle ajoute : « Les nouveaux supports de lecture vont sans doute rendre très courant ce phénomène », (p. 68) citant comme exemple… Harry Potter et la chambre des secrets, montage édito-commercial destiné aux enfants crédules ! 35 Elle aurait pu encore ajouter, sans se leurrer, que ces nouveaux « supports de lecture » vont rendre très courant le phénomène de la lecture-écriture et, par conséquent, de l’Intertexte (Habermas, rappelons, signale que l’invention de l’imprimerie a permis à l’homme de devenir lecteur ; parallèlement, il constate qu’Internet fait de nous des écrivains potentiels.) C’est logique. Sophie R. parle aussi de « transposition » : « La transposition qui mériterait le mieux l’appellation de translation serait peut-être celle qui se fait moyennant un déplacement non métaphorique du cadre de l’action (Ulysses de Joyce, par exemple, déplace l’Odyssée de la Méditerranée à Dublin) » (p.70). Dans cette perspective, La Guérison comme « nouvelle Divine Comédie » (comica, bien sûr) impliquerait-t-elle une « translation » puisqu’il y a un déplacement non métaphorique du cadre de l’action de la Florence de Dante à l’Araucanie chilienne ? Toutes ces questions sont encore trop rhétoriques. Essayons donc d’aller au-delà des limitations imposées par la rhétorique et la logique formelle, ainsi que celles de la « logique addictive» de l’algèbre que Sophie R. met en action dans les Corrigés 1, 2 et 3 de l’Exercice N°2 (Don Quichotte + x = Les Fleurs du Mal). « La littérature est rarement abstraite », admettra pourtant Sophie R. un peu plus loin. (p. 72 - 75)
Parlant d’extrapolations transesthétiques : littérature et autres arts , Sophie R. s’intéresse à la relation entre la musique et la littérature. Excellente musicologue, elle va se pencher sur le concept de « syngraphie », autrement dit, de la simultanéité des notes, fait habituel dans la composition musicale, mais impossible à imaginer entre les mots et, encore moins, entre les phrases d’un roman lequel, dans ce cas hypothétique, serait illisible.36 En vérité, c’est la rigidité de la structure du roman qui empêche le phénomène de la syngraphie dans une œuvre narrative. En revanche, l’Intertexte est « syngraphique » par définition, puisque sous le récit apparent il y a simultanément un autre récit ou plusieurs autres récits qui le soutiennent. Le tableau intertextuel entre Ulysses et L’Odyssée dont il était question plus haut dans cet essai, est très explicite à ce sujet.37 La structure de l’Intertexte est souple et, grâce à sa plasticité et à sa réceptivité, elle est esthétiquement beaucoup plus riche que le roman. Toujours en fine musicologue, Sophie R. analyse aussi le concept d’Appogiature (p.76) (de l’italien appoggiare, appuyer), concept utilisé en musique (ornement servant à retarder la note suivante, la note principale, sur laquelle on veut insister), « qui pourrait être défini, en tant qu’appogiature littéraire, comme un type particulier de motif retardant. » (p.78) Cette notion de « motif retardant », pris à Goethe, « désigne les procédés permettant de retarder un dénouement connu d’avance».(p 78) Je laisse de côté les admirables finesses musicales de Sophie R. pour aller directement à un autre aspect structuralement partagé entre musique et littérature : le rythme. Dans un roman, le rythme est souvent lié à l’histoire racontée et, bien sûr, à la façon dont l’écrivain la raconte en utilisant plus ou moins de mots, de phrases, de paragraphes, de chapitres, etc. Or, dans l’Intertexte le rythme est déterminé aussi par la structure qui soutient le récit. Par exemple, dans La Guérison il y a trois parties qui correspondent, « métaphoriquement / métonymiquement », à l’Inferno, Il Purgatorio et Il Paradiso. Cependant, ce n’est pas seulement le contenu raconté qui correspond intertextuellement à la Divine Comédie, mais aussi le rythme de la narration et, surtout, le rythme de la lecture du texte. La première partie (la plus longue) est construite (grâce au jeu des citations dantesques, du croisement entre le français, l’espagnol, l’italien, le mapudungún et l’anglais, de la prose et de la poésie), d’une façon saccadée, abrupte et oscura … à l’instar des précipices de l’Enfer. La deuxième est moins irrégulière, plus homogène, moins « plurilingue » (l’anglais a disparu, confiné dans l’Enfer), et donc plus légère et facile à suivre au fur et à mesure que la lecture avance vers la fin, soulagement progressif rappelant l’ascension de Dante à travers les plateaux de la montagne du Purgatoire. Et la troisième, le Paradis, est nettement plus rapide, plus aisée et agréable à lire dans une seule langue, le français (l’espagnol, a disparu à son tour, confiné dans le Purgatoire). Il serait peut-être possible de parler, pour suivre Sophie R., d’«appogiature inversée » (on accélère au lieu de freiner, de retarder). Tout ceci est totalement impossible dans un roman ordinaire. Quant à l’appogiature littéraire à proprement parler, elle est très nette dans La Société des Hommes Célestes lorsque le protagoniste, Faust, l’écrivain fou, plutôt fatigué, décide de mettre un terme à son récit. Mais le médecin (le Dr. M., Méphistophélès) qui s’occupe de lui, s’oppose à ce final (d’après lui, trop mauvais et précipité, comme celui du Faust de Goethe) et lui en impose un autre… qui sera suivi encore d’un troisième, la « farce pornotragique ou l’examen de faustologie » (Le Château de Méphistophélès)38. D’ailleurs, La Société des Hommes Célestes débutant comme un récit en prose, finit comme une pièce de théâtre, dans une sorte d’extrapolation transgénérique à l’intérieur même de l’ouvrage
Parmi les extrapolations transgénériques, Sophie R. analyse la Focalisation au Théâtre, concept sur lequel je ne ferai ici qu’une rapide allusion concernant Œdipe Rouge 39, pièce de théâtre qui raconte les luttes de l’Amérique Latine contre l’Empire des États-Unis et que j’écrivis en intertextualité avec la tragédie grecque, notamment avec Œdipe Roi. La théoricienne signale que dans le théâtre « le spectateur a une vue d’ensemble de l’histoire qui se déroule, sans avoir accès aux pensées des personnages : on serait donc tenté de dire qu’au théâtre, la focalisation est toujours externe. Il n’y a guère de possibilité d’avoir affaire à une focalisation interne, sauf dispositif de mise en scène particulière : projection sur un écran de la scène filmée en ‘caméra subjective’ pour donner le point de vue d’un des acteurs ou bien, comme cela se pratique parfois, sollicitation d’un spectateur pour jouer un des personnages. Dans ce dernier cas, seul le spectateur sollicité aura un point de vue en focalisation interne ». (p. 88) Ces deux procédés sont utilisés ponctuellement dans Œdipe Rouge, en particulier celui qui approche l’« inter-cinématographie », concept que la théoricienne aurait pu analyser dans ses Extrapolations transesthétiques : littérature et autres arts. Elle ne le fait pas, malgré les interrelations de plus en plus fréquentes entre littérature et cinéma. Certes, elle fait référence à Woody Allen et à son film « La rose pourpre du Caire », mais seulement en le nommant sur un même niveau sémiologique que la Continuité des Parcs de Julio Cortázar.40 C’est tout. Sophie R. laisse aussi de côté les extrapolations entre littérature et peinture. Dommage. Klee disait : « Écrire ou dessiner sont identiques dans leur fond»41. C’est un peu ce que j’observai en écrivant L’Enlèvement de Sabine, intertexte qui raconte une histoire d’amour et de viol qui se tisse autour des Annonciations parsemées dans la ville de Florence 42. Toutefois, derrière cette extrapolation entre littérature et peinture (les événements du récit et les tableaux se répondent entre eux), il y a aussi dans L’Enlèvement de Sabine une extrapolation géométrique (comme dans M/M/J) et algébrique, procédé dont nous parlions lorsqu’il était question de géométrie, d’algèbre et de « logique cumulative» (p. 75): le livre est construit en rappelant la géométrie analytique cartésienne et le célèbre rectangle d’or de l’Antiquité, utilisé par Leonardo da Vinci dans son Annunciazione (Uffizzi). Bien entendu, les « translations » entre les figures picturales et le texte sont nettement objectives et non pas subjectives, purement « lectoriales », comme c’est le cas dans The madona of the future, la nouvelle de Henry James qui est prise en intertextualité par mon ouvrage.
Au cours du dernier chapitre de la deuxième partie du fascicule, Sophie R. analyse les Extrapolations Transfictionnelles ; les œuvres préconceptuelles : « Nombreuses sont les fictions qui semblent faire appel à la théorie, la défier, n’attendre qu’elle, voire anticiper le travail conceptuel que le théoricien n’aurait plus qu’à achever. » (p.91) Puis, elle énumère : Histoire véritable (Lucien), Fictions (Borgès), Don Quichotte (Cervantès), Madame Bovary (Flaubert). « Il semble bien qu’il existe une sorte de bibliothèque idéale du théoricien où il suffit d’aller puiser quelques concepts déjà largement construits pour les importer dans un discours théorique. » (p 91) Précisément, l’Intertexte, étant donné sa construction, comporte, dans une certaine mesure, sa propre théorie, théorie qui sera différente d’Intertexte en Intertexte. Il n’y a pas une théorie de l’Intertexte, il y a autant de théories que d’Intertextes. C’est aussi l’une des différences essentielles avec le roman, généralement explicable par des théories globales extérieures à sa textualité, théories qui analysent les romans les plus divers utilisant toujours les mêmes paramètres. Mais, j’insiste, les théories romanesques sont, en principe (sauf les quelques exceptions répertoriées par Sophie R.), extérieures aux romans eux-mêmes. Le romancier s’occupe de narrer, non de théoriser. Par contre, l’écrivain intertextuel en tant que lecteur-écrivain est appelé à théoriser sur son propre texte : il incorpore la théorie littéraire presque comme un élément narratif de plus. Ce faisant, il réalise une véritable « auto-critique » de son travail. Le lecteur-écrivain se place dans une perspective d’«auto-conscience ». Il est, par définition, plus conscient que le romancier ordinaire, lequel souvent se perd volontiers dans ses développements textuels.
Dans Embrasser Maria, Sophie R., romancière, en dépit de sa haute condition de pédagogue et de théoricienne, part à la recherche de son ego perdu : Sophia, protagoniste et narratrice du roman, devient la maîtresse de Maria Callas, célébrité mondiale et idole de la presse, contrairement à elle, dont « on ne parle jamais ». On apprend aussi qu’Aristote Onassis est son riche « cousin ». À l’égal de la diva, elle passe de splendides vacances dans le yacht d’«Aris » ou sur son île privée, Scorpio (en l'absence de Jacqueline Kennedy, heureusement). De surcroît, elle est médecin et chirurgienne (« je ne vous ai pas dit que j’étais médecin ? ») capable de réaliser une fausse autopsie sur un faux cadavre (celui de Maria Callas) et de lui faire une phalloplastie (sic), opération aux antipodes de la castratura, pour métamorphoser Maria en Mario (Sophie de Réan et ses « opérations » sur sa poupée de cire, très endommagée et cadavérique, n’est pas loin).43 Sophia, chirurgienne lesbienne et fière de l’être (elle a raison), s’adonne curieusement, sans peur de se contredire, à une sorte de « thérapie » qui permet à la femme de cesser d’être femme pour -enfin!- devenir un homme (comprenne la féministe qui pourra). Pourquoi pas ? Une romancière, contrairement à une maîtresse de conférences attachée à ses lourds devoirs pédagogiques, peut se permettre n’importe quoi dans sa fantaisie !44 Ce type d’affabulations était déjà à la mode à l’époque des romans de chevalerie, pourquoi pas aujourd’hui ? En tout cas, c’est évident : le roman, y compris le roman enjolivé de petites touches intertextuelles et polyglottes, sert à conforter avant tout les fantaisies égocentriques du romancier. L’Intertexte, dans la mesure où l’écrivain le tisse explicitement avec l’écriture des auteurs autres que lui-même, échappe par définition à l’égocentrisme romanesque. 45
Rendant un hommage à peine voilé à Michel Houellebecq, le « romancier à la mode de Paris », étendard du milieu germanopratin et auteur du best-seller Extension du domaine de la lutte, la théoricienne propose à ses élèves un exercice qu’elle appelle Extension du domaine de la rime.46 Ce titre, qui met en valeur un romancier qui se définit lui-même comme « une putain de la littérature », est déplorable, surtout si on pense à la candeur et à la bonne foi de la jeunesse sorbonnarde, prête innocemment à tout pour s’instruire.47 Elle s’auto-interroge : « On n’a jamais pensé à se demander si on peut parler de rime, par extrapolation, dans (...) un texte narratif en prose. En quoi consisterait (…) la rime si on en faisait un instrument propre à raconter une histoire ? » (p. 85) Ses réflexions sur l’extrapolation possible de la rime poétique au récit en prose sont très pertinentes, mais elle laisse passer une superbe opportunité pour enrichir son sujet : elle oublie la rime comme mécanisme de narration fondamentale avant l’invention de l’imprimerie. Elle ne tient pas compte de la terza rima, la « tierce rime » que Dante utilise du début à la fin du récit versifié de la Divine Comédie. Ni du Roman de la Rose, long récit en octosyllabes à rimes plates de Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Ni d’Il Fiore, « remake porno » du Roman de la Rose, délicieusement accompli par Dante lui-même en trois mille hendécasyllabes organisés en deux cent trente-deux sonnets. Etc. Au Moyen Age, les récits littéraires se faisaient en vers pour, entre autres, faciliter le travail des copistes. Le domaine de la rime avait une extension somptueuse. La prose, rimée ou pas (Borgès exécrait la « prose rimée »), n’adviendra définitivement comme instrument propre à raconter une histoire qu’avec Rabelais, après l’invention de Gutenberg.
Je reviens à des choses plus sérieuses, à l’observation et l’expérimentation inspirée de la science. Dans la troisième et dernière partie de ses Exercices -Créer des concepts à partir de l’observation- Sophie R. fera le parallèle entre les méthodes de la science et de la littérature : « Dans le vocabulaire des sciences on parle d’induction quand on tire une loi unique de l’observation d’un phénomène qui se produit un grand nombre de fois. Dans le cas de la théorie littéraire la démarche inductive sera un peu différente, puisqu’on va partir aussi bien d’un phénomène unique, autrement dit d’un exemple, que de plusieurs exemples présentant un point commun, et chercher à généraliser à partir d’eux » (p.95). C’est ce que j’ai fait pour établir ma théorie de l’Intertexte, avec la différence que c’est de ma propre production fictionnelle que je tire mes exemples : d’abord à partir de La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain), ensuite à partir de La Guérison, qui serait « une sorte de biographie factile d’un écrivain par un autre écrivain qui en ferait son double et son précurseur »... pourrait ajouter Sophie Rabau elle-même en référence à la Commedia de Dante Alighieri.(p 98) Le point commun à ces deux Intertextes (et à tous les Intertextes) est celui des emprunts pris dans d’autres œuvres littéraires, des œuvres classiques dans mon cas : La Société des Hommes Célestes est tissée avec plus de six cents emprunts pris dans l’ensemble des Faust classiques (Marlowe, Lenau, Valéry, Butor, Boulgakov, Goethe, T. Mann, etc.), souvent directement dans les langues d’origine, car l’Intertexte est plurilingue, contrairement au roman, monolingue. La Guérison, quant à elle, prend en intertextualité plurilingue non seulement la Commedia, texte de référence principal, mais également l’ensemble de l’œuvre de Dante, depuis ses poèmes de jeunesse et La Vita Nuova jusqu’à la Questio de aqua et terra, y compris ses lettres. Le rappel intertextuel du classicisme est l’une des caractéristiques de l’Intertexte, renforçant ainsi le lien nourricier entre la littérature du présent et celle du passé.
Dans le chapitre appelé un peu pompeusement Créer des lois empiriques (mais Sophie a le sens de l’humour), après un court sous-chapitre consacré à Lois et concepts, elle propose un exercice sur la lisibilité et la relisibilité d’un texte. C’est très alléchant car elle se penche sur le phénomène de la lecture et de la relecture, mais malheureusement elle va rester sur des propos très superficiels, appuyés pourtant sur un tableau explicatif accablant, plutôt difficile à saisir. : « Pour donner un peu d’ordre à l’analyse, on classe ici les prédicats du texte lisible, illisible ou relisible selon des catégories plus ou moins nettement inspirées de Jakobson, introduisant un peu de déduction dans notre raisonnement inductif. » (p.105) Puis, elle commente : « En observant ce tableau, il apparaît que les lignes du bas désignent les propriétés plus objectives de la relisibilité, en particulier la ligne concernant le canal : pour pouvoir lire, il faut un support, et en cas de fragilité du papier, de disparition de l’encre, de perte du manuscrit, l’ouvrage ne peut être lu ou relu » (p.105). Sophie R., qui parle même de textes « écrits à l’encre sympathique », touche un phénomène déterminant pour la littérature d’aujourd’hui, mais, comme nous l’avons déjà relevé, elle ne s’y intéresse pas : le phénomène du support matériel de la lecture (et de l’écriture) à notre époque, laquelle est passée de l’ère de l’imprimerie et du papier, à l’ère de l’écriture et de la lecture électroniques. Le support de la lecture-écriture a radicalement changé 48. Et le passage du roman comme forme narrative prédominante à celle de l’Intertexte correspond à ce changement décisif.
Un des sous-chapitres les plus intéressants du chapitre 2 est celui consacré à la Notion d’Illusion. Sophie R. y fait référence au New Criticism et aux idées de Wimsatt et Beardsley qui refusent aussi bien la conception classique que la conception romantique dans le jugement d’une œuvre. « Pour la conception classique, il y des règles universelles que l’on peut appliquer, qui permettent de produire la beauté. Le jugement de valeur est donc soumis à ces critères universels. Pour la conception romantique au contraire, chaque œuvre étant individuelle, il n’y peut y avoir de critères universels, donc chaque œuvre doit avoir ses propres critères de jugement. Il faut donc juger l’œuvre par rapport à elle-même, par rapport au projet de l’auteur, qui est la norme, et au succès ou à l’échec qui constitue sa réalisation par rapport au projet ».(p.107) C’est cette conception « romantique » qui est rejetée par le New Criticisme anglo-américain, très prisé par le théoricien franco-américain Michael Riffaterre. Celui-ci a forgé l’expression « illusion référentielle », illusion selon laquelle l’œuvre littéraire parle de la réalité, alors qu’elle ne parle que des autres œuvres. Selon Riffaterre, on ne doit pas chercher à expliquer un texte en fonction de ce qu’il a censé représenter, mais en fonction de l’intertextualité qu’il met en jeu. Tout ceci concerne de très près l’Intertexte, évidemment. L’Intertexte serait-il un genre narratif romantique ou classique ? Ma réponse est aussi nette qu’ambiguë : les deux. Classique parce qu’il est soumis, au moins partiellement, aux critères universels qui permettent de produire la beauté (Faust, Divine Comédie…) ; romantique, parce qu’il faut juger l’Intertexte par rapport à lui-même, par rapport au projet du lecteur-écrivain et au succès et ou à l’échec que constitue sa réalisation par rapport au projet. (Riffaterre voit juste lorsqu’il affirme qu’on explique et valorise un texte en fonction de l’intertextualité qu’il met en jeu).
Immédiatement après ce sous-chapitre, Sophie R. mentionnera -pour la première et dernière fois- le rôle de l’éditeur dans la littérature, en prenant comme exemple le cas très particulier de l’« éditeur critique ». Celui-ci accompagne le texte par une pléiade de notes en bas de page et de commentaires ajoutés par des spécialistes en la matière.(p. 109) Le lecteur peut ou non tenir compte de ces ajouts et les lire en les attribuant naïvement à l’auteur... même si celui-ci n’est, en quelque sorte, que le support d’une « illusion textuelle », illusion fabriquée par l’éditeur et ses équipes. C’est un peu ce qu’il se passe avec les romans appelés « romans grecs », attribués souvent à des auteurs de l’époque hautement classique de la Grèce ancienne. Il n’en est rien.49 Provenant plutôt des débuts du premier millénaire après JC, les romans dits grecs ont été « trafiqués » dans tous les sens (l’absence des manuscrits authentiques le permet) et présentés comme la racine immortelle du roman d’aujourd’hui. « À vrai dire (…) on commentera les choix de l’éditeur et non ceux d’un auteur antique (…) C’est pourquoi on peut dire que bien des commentaires des textes écrits avant l’invention de l’imprimerie reposent sur l’illusion textuelle et, partant, que nous vivons dans une culture qui a besoin de l’illusion textuelle (…) (p 110) (Je souligne). Pour moi cette illusion n’est rien d’autre que l’illusion romanesque qui prédomine dans notre civilisation contemporaine, fondée sur la fiction et non sur la conscience. Quant à l’éditeur, critique ou pas, autant il est le pilier du roman comme produit littéraire par excellence de notre société (avec toutes les connotations commerciales que cela suppose), autant le lecteur-écrivain est le pilier autarcique de l’Intertexte. Du fait de l’écriture électronique, de la cybernétique et d’Internet, l’éditeur conventionnel n’a aucune autorité sur l’écrivain intertextuel. L’écrivain intertextuel est son propre maître, il est totalement libre de ses choix. À cet égard, je pourrai citer quelques exemples, à la fois risibles et tragiques, d’éditeurs qui ont abusé outrageusement de romanciers à la personnalité faible, pris dans l’engrenage de l’argent et de la publicité. Je me contenterai de signaler mon article Révolution dans l’édition littéraire.50
En approchant de la fin de son ouvrage, Sophie R. analysera ce qu’elle appelle « le changement d’échelle », autrement dit, passer du « local au global » : « Un type d’induction par changement d’échelle relativement répandu consiste à prendre une figure de style et à en faire le principe de fonctionnement d’un genre, sinon de toute la littérature. C’est le cas de la citation, procédé ponctuel qui a été généralisé sous le nom d’intertextualité, » souligne-t-elle.(p.118/119) L’intérêt que la théoricienne prête à ce phénomène est fondamental. Et sa formulation « passer du local au global » est en soi suffisamment explicite. Or, en analysant le changement d’échelle, elle affaiblit la portée de son propos en se tournant vers l’époque de la Comtesse de Ségur pour choisir l’«énallage » comme figure de style qui permettrait d’étudier le phénomène de la généralisation : « On peut donc proposer, à titre d’exercice, de choisir au hasard une figure de style dans les listes proposées par les manuels de stylistique afin de se demander en quoi l’ensemble de la littérature, ou l’ensemble d’un genre, répondrait à un fonctionnement semblable. Nous avons choisi ici la figure de l’ « énallage » définie par Fontanier dans les Figures du discours. » (p. 119) Pierre Fontanier (Moissac, 1765-1844), qui n'inclut même pas l'énallage dans sa liste des figures de style, le définit comme un « échange d’un temps, d’un nombre, ou d’une personne, contre un autre temps, un autre nombre, ou une autre personne ». (p.119) Son prédécesseur au XVIIe siècle, César Chesnau Du Marsais, considère pour sa part l'énallage comme une simple faute grammaticale non voulue par l'écrivain lequel, en pleine ère de l’imprimerie, ne disposait pas encore des correcteurs électroniques, c'est sûr. Sophie R. semble fascinée par la rhétorique du passé. Elle n'hésite pas à remettre en valeur une figure vieillie et contestée déjà au Siècle des Lumières,51choisie « par hasard ». Pour la Maîtresse de conférences de la Sorbonne Nouvelle, l'énallage correspond à « l’apparition d’une forme grammaticale qui n’est pas la forme attendue, mais qui s’y substitue (...) On prendra garde au fait qu’il ne s’agit pas de répertorier les énallages dans la littérature, mais bien de montrer que la littérature repose sur le principe de l’énallage », assure-elle.. (Je souligne) (p.119). On ne peut pas mieux rapetisser le concept de généralisation ! Avec aplomb, elle ajoute et conclut : « Toute généralisation par changement d’échelle à l’ensemble de la littérature aboutit à privilégier une certaine conception de la littérature qui se trouve ainsi essentialisée d’une façon qui est tout sauf neutre » (Je souligne)(p.120). Quoi qu'il en soit, cela permet à Sophie R. en toute jalousie (à l’égal de celle de Sophie de Réan envers Camille de Fleurville, sa rivale aux beaux cheveux frisés), de déprécier Julia Kristeva (diva de la scène stellaire de la linguistique, encore plus narcissique que la Callas) et sa définition de l’intertextualité, exemple véritable du changement d’échelle du local au global.52 Ce faisant, laissant de côté toute neutralité, elle ferme la porte à la reconnaissance de l’Intertexte, car l’intertextualité est le principe même du fonctionnement du nouveau genre. Le roman est sauvé ! La Comtesse de Ségur, qui conçut Sophie dans son célèbre roman, aurait sans doute applaudi.
Opiniâtre et ambitieuse (dans l’univers très particulier de la linguistique et de la théorie littéraire, les émotions et les sentiments, même refoulés et ignorés, existent avec la même intensité que partout ailleurs ), voulant obstinément dépasser le concept moderne d’intertextualité, Sophie R. citera le cas des « auto-traductions » de Samuel Beckett, qui traduisit lui-même plusieurs de ses ouvrages de l’anglais au français. Elle s’appuie alors sur un article de la jeune étudiante Lily Robert-Foley (Academia, 2016) à propos de la l'apparition d’un tiers-texte né de la rencontre entre les deux versions, l'originale et l'auto-traduction. Sophie R. profite pour forger le concept de « tertextualité » : « La tertextualité invite à considérer cette vision de choses (l’intertextualité) selon un modèle qui n’est plus binaire mais ternaire : entre deux textes, il en existe un troisième, encore à écrire (tertextualité orientée vers le futur d‘une écriture)... » (p 121-122)
Si le risque pris par Sophie R. pour affirmer que la littérature repose sur le principe de l’énallage est considérable (comparable au risque pris par Sophie de Réan pour monter sur son âne rebelle et têtu), son recours à la tertextualité pour relativiser le concept de l'intertextualité correspond (métaphoriquement parlant, bien sûr) à l'acte infantile de percer une grosse poupée gonflable (Sophie de Réan l'aurait sans doute adorée). Sophie R. ne fait en réalité que percer sa propre image de rhétoricienne. (La grosse poupée finira --métonymiquement parlant, bien entendu- tristement dégonflée). C'est décevant. Ses élèves, chahuteurs ou admirateurs, ne peuvent en fin de compte, qu'être consternés. Néanmoins, la « tertextualité » peut être utilisée pour observer et valoriser le phénomène de l’auto-traduction. Je peux le confirmer, dans la mesure où j’ai « auto-traduit » beaucoup de mes propres textes de l’espagnol au français (et vice-versa).
Par exemple, le Retrato de un Psiquiatra Incinerado est devenu, après plusieurs versions en espagnol, le Portrait d’un Psychiatre Incinéré53 (écrit en intertextualité avec Tender is the Night, de Scott Fitzgerald), auto-traduit en français en faisant de nombreuses modifications imposées par le changement des langues. Le texte principal de l’ouvrage en castillan est parsemé de commentaires cocasses sur le labeur de « Los Magníficos de la Real Academia de la Lengua Española » et, dans la version en français, par des commentaires (non moins cocasses) sur le travail exemplaire des « Immortels de l’Académie Française ». Les jeux linguistiques ne peuvent pas être les mêmes dans les deux langues.54 Or, si le texte d’origine et l’auto-traduction peuvent être envisagés, à la rigueur, comme deux textes différents, le « tertexte » imaginé entre les deux ne serait, tout au plus... qu’une sorte de nouvel Intertexte.
Dans le cinquième chapitre des Exercices, Sophie R. théorise sur la possibilité d’Inventer des fictions théoriques : « Rien n’empêche de théoriser à partir de données fictives dans le domaine des études littéraires, soit, plus précisément, d’induire des concepts à partir de situations fictives où l’on se place à titre exploratoire. »(p 123) Cette fois-ci, Sophie R. a entièrement raison et, contrairement à son adorable "cousine", Sophie de Réan, elle ne mérite pas de fessée. Le projet du Portrait d’un Psychiatre Incinéré (auto-traduit de l'espagnol) consistait avant tout à combler un vide et à résoudre un doute très angoissant dans ma vie. Ayant quitté la pratique de la médecine alors que j’étais membre de l’équipe du Columbus Hospital à Manhattan, New York, afin de me consacrer exclusivement à écrire, je ne savais pas avec certitude si je m’étais trompé en faisant un choix aussi risqué. Le doute persistant, je décidai de me raconter par écrit ce qu’aurait pu être ma vie si j’avais suivi mon parcours de médecin et psychiatre, me donnant dans mon récit les meilleures chances de réussite, y compris l’invention d’une nouvelle psychiatrie, post-freudienne. Cette nouvelle psychiatrie, inspirée de la pensée de Georges Gurdjieff,55 se développe à travers plusieurs chapitres du livre et, à bien y regarder, suppose une nouvelle théorie de la psyché. Qu’elle soit valable ou non, c’est une autre affaire, mais, comme le dit très bien Sophie R., il est tout à fait légitime d’« induire des concepts à partir de situations fictives où l’on se place à titre exploratoire. » (p. 123). Le résultat de cette exploration textuelle me permit, en tout cas, de confirmer ma vocation d’écrivain, libre de toute contrainte sauf de celles imposées par la littérature.
Inventer la littérature, c'est le titre monumental du dernier exercice du manuel pédagogique que Sophie R. propose à ses élèves de la Sorbonne Nouvelle, sans tenir nul compte de leur fatigue, suivi, par-dessus le marché, d'un exténuant « exercice non corrigé » : Conclure la littérature. (p. 128) Pas facile. Dans ses propres Conclusions, elle écrit : « Peut-être donc peut-on aussi répondre à cette question (l’utilité et la pertinence de la théorie littéraire) en disant que théoriser sert à théoriser, la théorisation a pour but premier la production théorique. » (p. 130). Autrement dit, tisser de l’air avec de l’air ? Elle oublie ce qu‘elle a dit au début de la deuxième partie de son ouvrage : « La littérature est rarement abstraite ».(p 82).
La théorie de la littérature, tout en étant parfois en apparence très abstraite, cesse de l’être dans la mesure où elle s’applique aux exemples concrets de l’histoire de la littérature ou lorsqu’elle découle des exemples concrets de l’histoire humaine. (L’opposition matérialisme /idéalisme est ici en jeu, avec ce qu’elle implique comme perspective individuelle et sociale.) Les théories littéraires, tout en faisant partie de la littérature elle-même, illuminent, dans tous les cas de figure (y compris les figures rhétoriques les plus farfelues), le chemin du lecteur-écrivain, l’écrivain intertextuel.
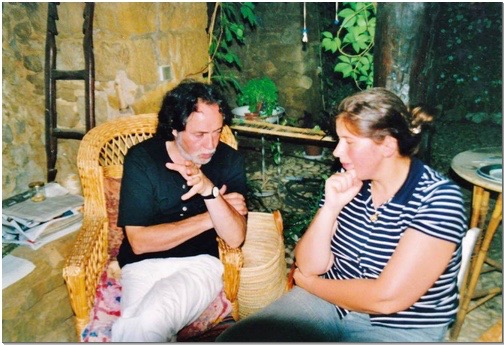
"Cause toujours..."
Sophie Rabau et Roberto Gac, Calaceite, Espagne, 2002.
1 El Bautismo. Montesinos Editores, Barcelona, 1983. El Sueño, Id, 1985
2 Essais, Roberto Gac, Amazon, CS, 2018, note 1, page 140.
3 Id, page 68
4 Rabau Sophie et Pennanech Florian. Exercices de théorie littéraire. Les fondamentaux de la Sorbonne Nouvelle, Paris 2016, p.17-18 (Toutes les citations de Sophie Rabau que j'utilise dans cet essai sont extraites du même ouvrage imprimé à Mayenne en 2019-2020 ).
5 Essais, p. 183
6 Si les limites historiques de l’ère de l’imprimerie en Occident sont assez précises (cela commence à Mayence avec Gutenberg, en 1450), les dates et même les noms pour cadrer l’ère « post imprimerie » sont encore flous : on parle pêle-mêle d’ère électronique, d’ère cybernétique, d’ère numérique, d’ère digitale, d’ère internaute, d’ère computationnelle, d’ère informatique, d’ère virtuelle, etc. Les synonymes et les pseudo-synonymes s’enchevêtrent entre-eux. Cela sans compter sur la confusion habituelle entre l’historique du développement des machines électroniques et de l’écriture électronique elle-même. Le mot « cybernétique » est l’un des plus précis : Norbert Wiener définit en 1948 la cybernétique comme une « science qui étudie les communications et leurs régulations dans les systèmes naturels et artificiels ». En France, Philippe Dreyfus invente en 1962 le mot « informatique » pour désigner la science du traitement de l'information et des ordinateurs. Quant à Internet, on peut dater ses débuts en 1981, mais il ne devient vraiment d’utilisation courante que dans les années 90. Ces dates et dénominations peuvent être rectifiées par n’importe quel lecteur-écrivain passionné d’histoire de l’écriture et de l’informatique. En ce qui me concerne, mes références vont toutes, depuis mes premiers essais, dans le sens de l’invention de l’écriture électronique autour des années 40, lorsque l’oscilloscope permit les premières projections sur écran d’un faisceau d’électrons.
7 La Guérison est une "nouvelle Divine Comédie" délirante et hilarante écrite par un indien araucan, fou amoureux de Béatrice, fille de Big Boss, multimillionnaire new-yorkais. L'Indien araucan croit être Dante réincarné et, logiquement, il est interné dans un hôpital psychiatrique où il rencontre le Dr. Virgile, médecin chargé de son traitement... Le texte est écrit en plusieurs langues et comporte de nombreuses citations de l'œuvre d’Alighieri.) Éditions de la Guérison (Ed de La Différence ; CS Amazon ; E-Book Kindle )
8 Car le développement de l’Intertexte implique non seulement le dépassement du roman, mais aussi un changement radical de l’édition conventionnelle, fait auquel s’opposent, pour des raisons commerciales, les éditeurs d’aujourd’hui.
9 Barthes Roland, S/Z, L’évaluation, p.10, Points, Seuil, Paris 1976 .
10 Plagiat et Intertextualité, note n° 20, Sens Public. 2018
11 Correspondance Unilatérale avec Sollers, CS, p.50, lettre N°3, note 3.
12 La Société des Hommes Célestes, R. G, p.413, Amazon, CS, 2012
13 Correspondance unilatérale avec Sollers, Aggiornamento, p.187, Amazon, CS, 2016
14 Dans sa brève incise sur Jakobson, quelque peu confuse, et le rapport entre la poésie et la métaphore et entre le récit et la métonymie (Exercices, p. 45), la théoricienne avance, apparemment, à contresens. Cela n’est pas très grave dans la mesure où, comme le signale si bien Roland Barthes «quand quelque chose qu’on a dit est dit un peu à contresens ou d’une façon déformée, cela est paradoxalement source de richesse. Le contresens couvre, en quelque sorte, la richesse de ce qu’on écrit… » (Théorie de l’Intertexte, p.341) Ce serait plus adéquat de parler d’un couple indissociable métaphore-métonymie comme on parle aujourd’hui de l’espace-temps en physique einsteinienne. Mais cela est le sujet d’un autre essai...)
15 Jürgen Habermas, le philosophe allemand membre de l'école de Francfort, signale dans un entretien (El País, 25 Avril 2018) que l’invention de l’imprimerie a permis à l'homme de devenir lecteur, processus qui a pris plusieurs siècles avant de s’imposer à la majorité de la population. Et, parallèlement, il constate que « deux décennies après son invention, Internet fait déjà de nous tous des écrivains potentiels. » Nous pouvons donc imaginer que l’invention de l’écriture électronique fera du lecteur un lecteur-écrivain… en beaucoup moins de temps.
16 La Guérison dantesque est aussi une autobiographie, mais purement fictive : c’est Dante qui raconte sa propre vie à partir de sa réincarnation au XXe siècle sous les traits d’un indien araucan. Cependant, fictive ou non, le narrateur raconte « sa » vie. Kandinsky disait dans Point/Ligne/Plan que « le but de l’art est de trouver la vie, rendre sensible sa pulsation et constater l’ordonnance de tout ce qui vit »,( Denoël, p. 161, 1972 Paris). L’autobiographie va dans ce sens.
17 L’autofiction à la Proust connaît des précurseurs illustres comme Laurence Sterne et aussi beaucoup de disciples, plus ou moins conscients de l’être : Anaïs Nin, Henry Miller, Dos Passos, Michel Leiris, Robert Musil, Ferdinand Céline, etc. (Bien entendu, la Commedia et, surtout, la Vita nuova de Dante peuvent être considérées aussi comme des autofictions.) L’attribution de son invention à Dubrovsky voile la qualité post-romanesque de l’autofiction proustienne et brouille les cartes autour du roman, précieux objet du commerce littéraire.
18 Essais, p.190
19 M. Butor, dans son essai La critique et l’invention (Répertoire III) parle aussi de l’« inachèvement » , mais cet « inachèvement » correspond à l’ouverture intertextuelle immanente à toute Œuvre littéraire. Dans ce sens, l’Intertexte est « inachevé » par définition, car il est ouvert à sa continuation par le lecteur-écrivain. L’inachèvement de la Recherche dont parle Sophie R. va dans le sens de manque, d’« incomplétude ».
20 Embrasser Maria est un roman « tendance » (transgenre, féministe, saphique), saturé de renseignements sur les opéras chantés par Maria Callas et joliment orné par d’innombrables touches intertextuelles et polyglottes. L’érudition musicale de Sophie R. dépasse allègrement sa connaissance « totalement inachevée » (c’est le cas de le dire) de la Recherche, l’une des œuvres littéraires parmi les plus importantes de ces derniers siècles. Ses élèves en littérature comparée auraient le droit de s’en étonner et de protester bruyamment.
21 Exercices, p. 49
22 Dans Bakhtine, le roman et l’intertexte , je définis la différence entre « hypertexte » et « intertexte ». L ‘hypertexte est souvent le produit purement automatique d’un appareil électronique manipulé par un technicien. Derrière l’intertexte, il y a toujours la conscience d’un écrivain, d’un artiste conscient de l’être.
23 « Notre littérature est marquée par le divorce impitoyable que l’institution littéraire maintient entre le fabricant et l’usager du texte (…), entre son auteur et son lecteur. Ce lecteur est plongé dans une sorte d’oisiveté, d’intransitivité... », se plaignait Roland Barthes. (Barthes Roland, S/Z, L’évaluation, p.10, Points, Seuil, Paris 1976)
24 Barthes Roland , Théorie du Texte, Études à l’école pratique des hautes études, Paris, 1974. En dépit de sa brièveté, la Théorie du Texte est probablement l’écrit de théorie littéraire le plus important produit en France au XXe siècle. Il prélude le dépassement du roman et du romanesque. Son occultation médiatique et académique systématique est destinée à effacer sa potentialité révolutionnaire et à protéger ainsi le commerce littéraire axé sur le roman. (R.G, L’énigme romanesque de Roland Barthes .Sens Public 2021)
25 L’énigme romanesque de Roland Barthes, Première partie, La sagesse orientale de R.Barthes.
26 Céleste Albaret, la gouvernante-secrétaire de Proust, qui l’aidait à coller ses « paperolles » sur le manuscrit de la Recherche pour parfaire son texte, serait furieuse d’apprendre qu’on puisse le considérer comme «inachevé».
27 Michel Butor, Entretiens avec Georges Charbonnier, nrf, p.117, Paris 1967.
28 Essais, p.158
29 Id, p. 158
30 Id, p. 158
31 Essai rédigé pour le colloque organisé autour de Proust et Bakhtine en novembre 2019 à l'Institut Gorki de Moscou. Luc Fraisse, professeur de littérature à l’Université de Strasbourg, après avoir lu par hasard dans Sens Public Bakhtine, le roman et l’intertexte, m’invita spontanément (et généreusement) à participer, avec la délégation française, à cette rencontre.
32 Par exemple, la théorie de la relativité extrapolée dans l’organisation de la tétralogie romanesque de Lawrence Durrell, The Alexandria Quartet, que je prends en intertextualité -en respectant sa qualité « einsteinienne »- dans ma nouvelle La chica judía de Filadelfia (Cuentos, Amazon CS, 2010) .
35 J.K. Rowling, l’autrice-écrivaine de la série potterienne (production qui comporte des casquettes, tee-shirts et autres accessoires vendus à profusion avec les récits), sorte de pauvre Cendrillon devenue, grâce à la magie des éditeurs-sorciers, « plus riche que la reine d’Angleterre », évite toute discussion sérieuse sur « son » œuvre, construction de toutes pièces réalisée par l’équipe de «nègres» des éditeurs. Le cas du Da Vinci Code de Dan Brown, n’est pas loin. Les enfants sont susceptibles de se faire abuser. Apparemment, les sorbonnards aussi.
36 La syngraphie en littérature. Exercices p.81
37 Tableau intertextuel « Ulysse/Odyssée ».
38 Le Château de Méphistophélès : https://roberto-gac.com/l-intertexte-en-ligne/presentation-intertextes-en-ligne/lechateaudemephistopheles
39 Œdipe Rouge, Amazon, CS, 2012
40 Malencontreusement, la superbe nouvelle de l’écrivain latino-américain est titrée, dans les Exercices de théorie littéraire, La Continuité des Parques : on passe inopinément des arbres somptueux aux méchantes déesses grecques. (p. 91). Simple lapsus calami ou métalepse inédite ? En tous cas, lapsus calami déjà perpétré dans Les Concepts qui échappent au système (p.15), et qu’aurait dû figurer, plus logiquement, dans les Exercices pas du tout corrigés. Il n’en est rien. Cela n’invalide pas pour autant l’ensemble des Exercices de théorie littéraire. Les élèves de la Sorbonne Nouvelle pourraient cependant se trouver désorientés et découragés moralement par ce type d’imprécisions. Ils ne sont pas coupables et ne méritent aucun châtiment, surtout pas des fessées (même si beaucoup d’entre eux en demandent).
41 Théorie de l’Art Moderne, Denoël, 1985
43 Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, p. 13, Casterman, Paris 1979.
44 Embrasser Maria illustre avec éclat ce que Nathalie Sarraute définissait comme un « faux bon roman » : "Les faux bons romans ne dressent plus d'obstacles, n'exigent plus guère d'efforts, et permettent aux lecteurs, confortablement installés dans un univers familier, de se laisser glisser mollement vers de dangereuses délices", écrit-elle dans son essai « Ce que voient les oiseaux ». Nonobstant, Embrasser Maria, roman rédigé avec soin, mérite, au moins, le prix Fémina… du faux bon roman.
45 On pourrait dire que se prendre pour Dante ou pour Faust, n’est pas moins égocentrique. Mais dans La Guérison et dans La Société des Hommes Célestes le protagoniste est fou. Son égocentrisme est paranoïaque. Pour lui, sortir de sa maladie est primordial.
46 Ce genre de clin d’œil à un romancier à succès, geste très fréquent dans le milieu germanopratin, mériterait un néologisme rhétorique. En latin, bien entendu. Parce que sans le latin la rhétorique nous emmerde, comme dirait Georges Brassens.
47 . L’extension du domaine germanopratin (corrompu et corrupteur) à l’université française est un véritable danger. Il faut s’y opposer, coûte que coûte. (Gac Roberto, : Blogs Mediapart, Houellebecq et la parole putanisée ; Proust et l’écrivain « afrancesado » ; Nathalie Sarraute, De l’ère du soupçon à l’ère de la honte.)
48 Essais, CS, p.180
49 Id, Le roman dit « grec », p.143
51 Aujourd'hui, à l'époque de la cybernétique, une nouvelle rhétorique se développe à grande vitesse. En ce qui me concerne, je suis redevable des recherches réalisées à l'Université de Montréal par Marcello Vitali-Rosati, professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, en collaboration avec Gérard Wormser, Servanne Monjour et la revue électronique Sens Public.
52 Dans son livre « L’Intertextualité » (GF Flammarion, 2002), Sophie Rabau résumait en deux pages l’approche du concept d'intertextualité définie par J. Kristeva. Ce résumé était tout à fait « neutre ». En revanche, dans ses Exercices de théorie littéraire, ce regard neutre n'est plus d'actualité, en tout cas dans le sens définit par Barthes, pour lequel le concept de Neutre «vise à la suspension des données conflictuelles du discours » (Cours et séminaires au Collège de France, 1977-1978)
53 Ed. La Différence, 1998, Paris
54 Il est nécessaire de rappeler que les textes auto-traduits sont couramment refusés par les éditeurs de l’establishment et malmenés par la critique conventionnelle, car ils menacent indirectement le système des droits d’auteur. Ce fut le cas du Portrait d’un Psychiatre Incinéré, édité par les Éditions de la Différence sans faire mention d’un quelconque traducteur appartenant au milieu germanopratin « comme il faut ». L’ouvrage fut ridiculisé par l’Express et la revue Lire, organe de commercialisation contrôlé par les éditeurs parisiens. Andreï Makine, aujourd’hui prix Goncourt et membre de l’Académie Française (grâce aux soins du critique Dominique Fernandez, son partenaire académique), subit à ses débuts comme romancier franco-russe une déconvenue semblable. Je rappelle ses humiliations « éditoriales » à Paris dans un de mes Essais (Révolution dans l'édition littéraire). Le cas de Beckett est un peu différent : il était déjà reconnu par les éditeurs lorsqu’il proposa ses auto-traductions.
55 G. Gurdjieff, Récits de Belzébuth à son petit-fils, Co-édition Institut Gurdjieff de Paris / Le bois d’Orion, Paris, février 2021
Additional Info
Mikhaïl Bakhtine, le grand théoricien russe du roman, n’eut pas la possibilité - pour des raisons conjoncturelles - d’analyser en profondeur l’œuvre de Marcel Proust. Dans cet article, rédigé pour le colloque « Bakhtine / Proust, regards croisés », organisé par Tatiana Victoroff et Luc Fraisse à l’Institut Gorki de Moscou (octobre 2019), il est question de ce manquement et de ses répercussions sur l’histoire de la littérature, notamment sur l’évolution des genres littéraires entre le roman polyphonique de Dostoïevski et l’intertexte, genre post-romanesque dont le développement implique la reconnaissance de À la recherche du temps perdu en tant que genre narratif intermédiaire, l’autofiction.
Additional Info
CYCLE THÉORIQUE
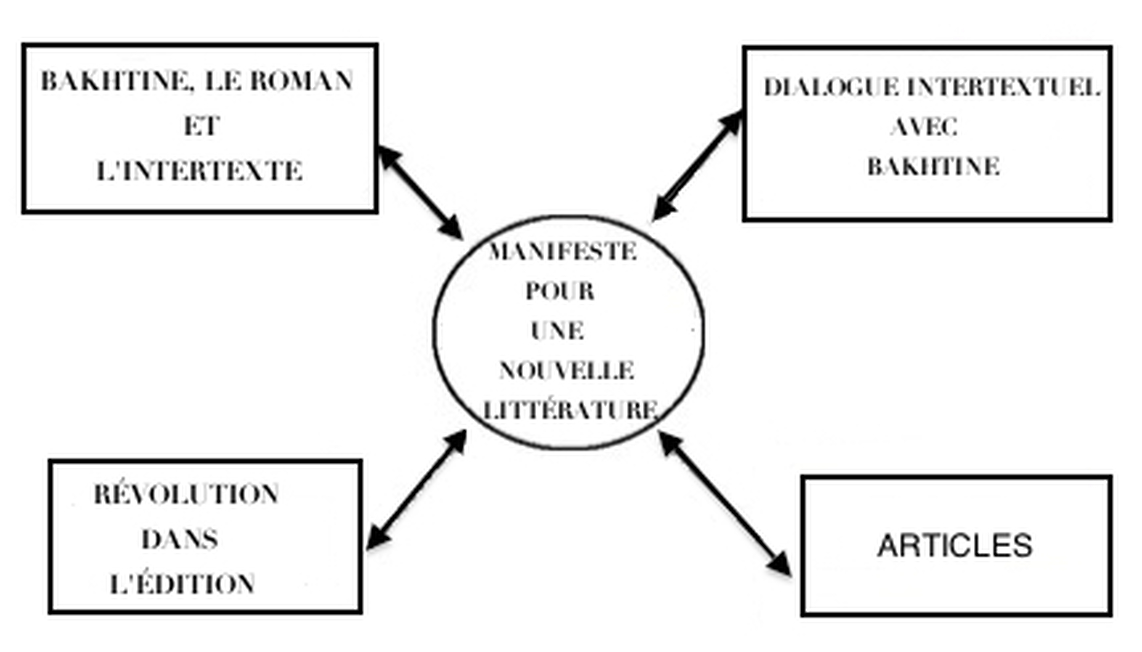
|
Un troisième (et dernier) cycle, essentiellement théorique et centré sur les aspects formels impliqués par l'Intertexte en tant que modalité narrative post-romanesque, a commencé à se structurer en 2003-2004. Jusqu'alors, seules les questions formulées par les écrivains de la Nouvelle Fiction Française à propos de l'Intertexte, m'avaient fait sentir la nécessité d'y répondre par des concepts esthétiques. Je croyais, un peu naïvement, que mes textes de fiction littéraire étaient suffisants. Ainsi, suite à un colloque international que j'avais organisé à Calaceite (Teruel, Espagne, 1998) pour les écrivains du groupe présidé par Frédérick Tristan, j'écrivis En marge d'André Pieyre de Mandiargues (Songe intertextuel autour de la Nouvelle Fiction) dans le but d'éclaircir le problème. Mais ce ne fut pas le cas. Même la publication à Paris du Portrait d'un Psychiatre Incinéré (Éditions de La Différence, 1999) et de La Guérison (id., 2000), textes repérés et commentés, assez élogieusement, par la critique parisienne, ne suffirent pas à lever les ambiguïtés à propos de l'Intertexte, d'autant plus que Joaquim Vital, le directeur de La Différence, me demanda de publier ces deux livres sous la rubrique "roman" et cela pour des raisons strictement commerciales. ("Si je publie tes livres sous la rubrique "intertexte", tu risques une mésaventure pareille à celle encourue par Breton à New York avec Les Champs Magnétiques, placé par les libraires dans la section "électricité". Tu pourrais trouver La Guérison dans le rayon "informatique", me dit-il.) Bien entendu, les critiques parisiens ont estimé que mes livres étaient des romans drolatiquement étranges mais, de toutes façons, des romans quand même.
En 2004, invité à participer à la rencontre annuelle des Belles Latinas à Lyon, je programmai un "intertexte collectif" autour de la légende de Faust avec les élèves du prestigieux lycée Édouard Herriot. Gérard Wormser, docteur en philosophie et professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon, fondateur de l'association Sens Public (revue électronique plurilingue et maison d'édition créées à Lyon en 2003), m'aida à guider les élèves dans l'écriture électronique de cet Intertexte collectif expérimental. Toutefois, ce ne fut que l'année suivante, dans le Manifeste pour une nouvelle littérature? présenté dans le stand de Sens Public au Salon du Livre (Paris 2005), parallèlement à l’édition SP de La Société des Hommes Célestes, qu'il a été question d'une formalisation conceptuelle de l'Intertexte en tant que genre post-romanesque. La Société des Hommes Célestes (Un Faust latino-américain) est un ouvrage tissé avec des centaines de citations de Faust classiques, publié sous la rubrique "Intertexte". La langue de base est le français, mais par le biais des citations des textes faustiens originaux, le texte s'ouvre constamment au plurilinguisme. Le livre fut édité sur papier et imprimé en Espagne sous la supervision de Chantal Waszilewska et d’Émilie Tardivel, alors secrétaire de Sens Public. La beauté de la couverture et la configuration du livre, conçues par le peintre péruvien Herman Braun-Vega, retinrent l’attention du Salon du Livre et il fut placé dans la salle réservée aux plus beaux ouvrages. Simultanément, grâce aux nouvelles technologies, le texte commença à émerger dans une "version électronique" où les citations devinrent "actives". Le lecteur n'est plus obligé d’aller les chercher en bas de page ou à la fin du livre, mais il peut accéder immédiatement, pendant sa lecture sur support numérique, aussi bien au texte original de la citation qu'à son hypertexte (ouvrage, langue et édition d'origine). La version électronique, à la charge de Chantal Waszilewska, n'a été complètement achevée que pour Le Château de Méphistophélès ou L'Examen de Faustologie, farce qui clôt l'œuvre. "Clore" n'est pas le verbe à utiliser dans le cas de La Société des Hommes Célestes car, en tant qu'Intertexte, le livre a pour vocation d'être toujours ouvert au lecteur-écrivain. Celui-ci peut, en s'appuyant sur les facilités offertes par le support numérique et par l'ajout de nouvelles citations faustiennes, participer à l’évolution d'une œuvre qui s'inscrit dans la longue tradition faustienne, initiée en 1583 par le Volksbuch von Doktor Johannes Faustus, première transcription littéraire de la légende du Docteur Faust, légende à la fois périodiquement enrichie et perpétuellement inachevée. La version en espagnol du livre -La Sociedad de los Hombres Celestes (Un Fausto Latinoamericano)- n’existe pour le moment que sur papier. Il ne s’agit pas d’une simple traduction du texte français, mais d'une "traduction intertextuelle", laquelle implique des modifications parfois très significatives du texte original. Toutefois, l’axe du livre, dans ses deux versions, est le même : une fresque de l’éducation occidentale au XXe siècle, depuis le kindergarten jusqu’au doctorat… en faustologie, bien sûr. En mars 2006, la présentation de La Société des Hommes Célestes eut lieu à la Maison de l'Amérique Latine à Paris, puis dans les salons de l'ambassade du Chili en France (mai 2006, Hernán Sandoval, ambassadeur; Raúl Fernández, responsable culturel), avec la participation de Hermán Braun-Vega, du journaliste de Radio France Internationale, Fernando Carvallo, de Gérard Wormser et de Sophie Rabau, professeure de littérature comparée qui m'avait préalablement invité à donner une conférence à la Sorbonne Nouvelle sur La Guérison et écrit un article sur le sujet, publié par l'Université Stendhal de Grenoble. Dans le public invité à l'ambassade se trouvaient aussi Julia Peslier, docteure en littérature, spécialiste de faustologie (Université Paris VIII, Vincennes Saint-Denis), et Alejandro Canseco-Jerez, professeur de littérature latino-américaine à l'université Paul Verlaine de Metz et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Deux mois plus tard le livre fut présenté en Espagne (château de Valderrobres, Aragón, juillet 2006), conjointement à la rétrospective de Herman Braun-Vega, que je définis dans l'un de mes essais comme "maître de l’interpicturalité", terme -l'interpicturalité- dérivé de celui de l'intertextualité littéraire. En effet, ce que je tentais au niveau de la littérature, d'autres artistes le tentaient aussi dans leurs propres disciplines. Ainsi, Braun-Vega "cite" souvent dans ses tableaux les grands classiques de la peinture : Velázquez, Rembrandt, Rubens, Ingres, Goya, Gauguin, Cézanne, Picasso, etc. Des œuvres comme Double éclairage sur Occident avec des emprunts à Velázquez et à Picasso, La leçon à la campagne où Rembrandt est cité, ou bien le triptyque ¿La realidad es así?, conçu autour de Goya et Picasso, montrent que d'autres artistes d'avant-garde cherchent à renouer avec le courant central du classicisme et à sortir des formes stéréotypées et dévitalisées de l'art et de la littérature de notre époque.
La melancolia de Don Pablo (Velázquez, Rembrandt, Ingres, Duncan) 2006, acrylique sur toile, 200 x200cm. Au fond, le château de Valderrobres, lieu de la rencontre avec Sens Public.
Plusieurs membres de Sens Public et des spécialistes présents au château de Valderrobres donnèrent des conférences sur la signification de l'intertextualité (Ingeburg Lachaussée, germaniste, professeur en classes préparatoires, maître de conférences de philosophie politique à Sciences Po), de l'interpicturalité (Madeleine Vallette-Fondo, Maître de conférences à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée), et de l'intermusicalité (Margarita Celma, musicologue, Directora de la Coral Matarranya), De son côté, le cinéaste Yann Kilborne (maître de conférences à l’Université Bordeaux-Montaigne) prolongea ces réflexions vers le cinéma. De toute évidence, l'apparition de l'Intertexte comme nouvelle forme narrative post-romanesque n'est donc pas un phénomène isolé des autres pratiques artistiques mais, bien au contraire, elle fait partie d'un mouvement de renouveau de la culture contemporaine au sein duquel le multiculturalisme, le plurilinguisme et l’échange de principes esthétiques et de techniques est déterminant. Or, malgré toutes ces conférences et ces débats, je rencontrais toujours maintes difficultés pour résumer et expliquer conceptuellement ma démarche, surtout face aux éditeurs qui hésitaient à publier des textes non seulement dits "d'avant-garde", destinés en principe à un public restreint, mais qui posaient aussi de complexes et très coûteuses exigences techniques, pratiquement insurmontables pour l'édition conventionnelle. Dans le Manifeste j'avais attiré l'attention sur un fait décisif : "pas de nouvelle littérature, sans nouvelle édition". Le refus par les éditeurs conventionnels (y compris par Sens Public, encore à ses débuts comme maison d'édition) de publier Madre / Montaña / Jazmín à cause de ses dessins et de ses couleurs, venait confirmer cette situation. L'Intertexte semblait destiné à se perdre ou à rester comme une simple curiosité dans l'histoire de la littérature. Ce fut alors que je découvris Create Space, la structure de "self-edition" montée par Amazon aux États-Unis. Comme je le raconte dans mon article Révolution dans l'édition littéraire (Mediapart, septembre 2021), tout ce que j'avais imaginé à propos de l’évolution indispensable de l'édition traditionnelle pour aboutir à l'épanouissement d'une nouvelle littérature, avait déjà été mis en place par un groupe d'écrivains américains, dont les dénonciations concernant la pusillanimité et l'affairisme des éditeurs avaient été entendues par Amazon. J'éditai donc Madre/Montaña/Jazmín d'après mes propres exigences, décidant personnellement de chaque aspect formel de l'édition, poursuivant de la sorte le processus créatif de l’écriture. Puis, suivant le même procédé, je publiai, à partir de 2010, la totalité de mes manuscrits inédits, parmi lesquels L'Enlèvement de Sabine, ouvrage à la fois intertextuel et interpictural qui contient des reproductions "full color" des Annonciations de la ville de Florence, ouvrage refusé par les éditeurs sous le prétexte du coût très élevé de l'impression, coût en revanche parfaitement raisonnable à l'intérieur des paramètres de la "new fashion edition". Et je pus, enfin, développer, compléter et publier mes textes théoriques sur l'Intertexte (Bakhtine, le roman et l'intertexte, Dialogue Intertextuel avec Bakhtine, etc.), groupés dans le Manifeste pour une Nouvelle Littérature, dépourvu désormais du signe interrogatif qui avait caractérisé sa première mouture en 2005. Après la rencontre au château de Valderrobres, je poursuivis à Paris le processus de théorisation de l’intertexte. Encore une fois, alors que je croyais avoir atteint une clarté suffisante dans ma démarche, je me heurtai à une pénible réalité : le marché littéraire, solidement protégé contre toute tentative pour aller au-delà du roman, poutre maîtresse de l’industrie littéraire. Dans le monde de la littérature actuelle, éminemment romanesque, l’Intertexte comme nouvelle modalité narrative, impliquant de surcroît un changement du mécanisme d’édition, ne pouvait intéresser que les chercheurs en linguistique...et encore ! J’avais déjà tenté de m’approcher des écrivains de l’avant-garde française « officielle » (Correspondance Unilatérale avec Sollers) pour partager mes réflexions, sans aucun succès. Certes, la critique du roman comme genre narratif était archivée depuis un moment et convenablement oubliée dans l’intérêt du négoce éditorial. Or, cela ne m’empêcha pas de récupérer l’opinion de Roland Barthes sur les avant-gardes en général, y compris le groupe Tel Quel, dont il faisait partie : « Il y a sans doute des révoltes contre l’idéologie bourgeoise. C’est ce qu’on appelle en général l’avant-garde. Mais ces révoltes sont socialement limitées, elles restent récupérables. D’abord parce qu’elles proviennent d’un fragment même de la bourgeoisie, d’un groupe minoritaire d’artistes, d’intellectuels, sans autre public que la classe même qu’ils contestent, et qui restent tributaires de son argent pour s’exprimer. Et puis, ces révoltes s’inspirent toujours d’une distinction très forte entre le bourgeois éthique et le bourgeois politique : ce que l’avant-garde conteste, c’est le bourgeois en art, en morale, c’est, comme au plus beau temps du romantisme, l’épicier, le philistin ; mais de contestation politique, aucune. Ce que l’avant-garde ne tolère pas dans la bourgeoisie, c’est son langage, non son statut. Ce statut, ce n’est pas forcément qu’elle l’approuve ; mais elle le met entre parenthèses : quelle que soit la violence de la provocation, ce qu’elle assume finalement, c’est l’homme délaissé, ce n’est pas l’homme aliéné (...)» affirme-t-il, mettant en garde ses lecteurs dans Mythologies, conscient des limites de son activité avant-gardiste. Quelques années plus tard, il va nuancer sa position : « C’est pourquoi je pourrais dire que ma propre position historique est d’être à l’arrière-garde de l’avant-garde : être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ; être d’arrière-garde, c’est l’aimer encore. J’aime le romanesque, mais je sais que le roman est mort. » La lucidité de Barthes me laissa stupéfait. Le plus grand théoricien contemporain de la littérature française, dont la lumière (parfois « oscillante ») éclairait la démarche sinueuse et souvent confuse de Tel Quel, signalait l’existence d’un mur pratiquement infranchissable pour tout écrivain d’avant-garde : les intérêts et les valeurs statutaires de la bourgeoisie, autrement dit, de la société capitaliste. Le roman, d’avant-garde ou pas, devait satisfaire ces intérêts pour continuer à exister. Et l’écrivain, s’il voulait être publié et gagner de l’argent, devait se proclamer « romancier » et faire l’éloge du roman. Dans un contexte pareil, quelles étaient les possibilités de survie ou de simple manifestation d’un nouveau genre narratif comme l’Intertexte, qui cherche à dépasser le roman ? À la rigueur, on peut élaborer les objets littéraires les plus sophistiqués dans l’intimité des laboratoires de linguistique, mais à condition de ne pas franchir les frontières fixées par la bourgeoisie. Sinon, la tentative avant-gardiste sera étouffée. C’est, d’ailleurs, ce qui advint au groupe Tel Quel après la mort de Roland Barthes, comme je le raconte dans « L’Énigme romanesque de Roland Barthes ». Par conséquent, toute velléité de voir l’Intertexte reconnu, accepté et promu dans le monde des lettres conventionnel, tributaire de l’imprimerie et du support papier, était à exclure. Cela ne servait à rien de me rappeler les exemples classiques de Schopenhauer, Cézanne, Pessoa, Kafka et encore d’autres créateurs et innovateurs, grands ou petits, qui sont morts inconnus ou méconnus. Pourtant, au moins d’un point de vue théorique, il y avait encore quelque chose à développer sans faire de concessions à l’establishment édito-littéraire : la réflexion sur la liberté de création, toujours prônée, mais rarement respectée dans l’univers romanesque, et sur la liberté d’édition, toutes deux essentielles pour l’Intertexte. Sur ce point, l’aide apportée par Marcello Vitali-Rosati, professeur de littérature et des recherches numériques à l’université de Montréal, dont Sens Public était devenu un partenaire grâce à sa revue électronique, fut pour moi fondamentale. J’avais choisi en 2004 de suivre la démarche de Gérard Wormser parce qu’elle s’écartait radicalement de la voie suivie par les médias ordinaires. Wormser avait saisi, depuis le début d’Internet, l’immense portée de la révolution cybernétique à une époque où d’éminents sorbonnards croyaient toujours qu’Internet et les ordinateurs ne seraient qu’une mode de plus, vouée à une disparition rapide pour le plus grand soulagement d’une génération de professeurs plutôt âgés, incapables d’apprendre le maniement des appareils électroniques. Ses efforts s’appuyaient sur cette nouvelle réalité technologique, plateforme bienvenue et indispensable pour l’Intertexte qui allait trouver dans l’éditorialisation, telle qu’elle est définie par Wormser et par Vitali-Rosati, le moyen pour dépasser le barrage opposé par la bourgeoisie (Barthes dixit) à la liberté de création et à la liberté d’édition : Qu’est-ce que l’éditorialisation ? me demandais-je dans un court essai Editorialisation et Littérature, publié en mars 2016. Deux réponses apparaissent, rappelant analogiquement Einstein et sa théorie de la relativité : celle, restreinte, de Marcello Vitali-Rosati, qui ne concerne principalement que le monde de l’édition ; l’autre, plus générale, de Gérard Wormser, qui englobe un ensemble beaucoup plus vaste de manifestations de l’univers du numérique. Commençons par cette dernière : « Nous nommons "éditorialisation" le processus d’explicitation dialogique qui permet aux groupes de structurer leurs échanges pour devenir acteurs des réseaux de connaissance », note Wormser dans son invitation au colloque Mondialisation et Éditorialisation (Salon Dionys’Hum, 2015). Allons maintenant vers la définition la plus restreinte, celle qui se limite au monde de l’édition : « On peut définir l’éditorialisation comme un ensemble d’appareils techniques (le réseau, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche), de structures (l’hypertexte, le multimédia, les métadonnées), de pratiques (l’annotation, les commentaires, les recommandations via les réseaux sociaux) qui permet de produire et d’organiser un contenu sur le web », propose Vitali-Rosati. Revenant sur le problème spécifique de l’édition « papier », il précise : « L’ouverture de l’éditorialisation par rapport à l’édition papier implique une certaine perte de contrôle de l’éditeur sur les contenus. On pourrait dire que l’éditeur ne représente plus qu’une partie de l’instance éditoriale qui est devenue beaucoup plus large. Cette ouverture est ce qui relie l’éditorialisation à une forme particulière de circulation du savoir et des contenus en général : une forme en réseau, disséminée et fragmentaire. L’éditorialisation produit une sorte d’intelligence en réseau – ou un réseau d’intelligences. Le concept d’éditorialisation renvoie donc à une dimension collective du savoir. » Et à une dimension collective de la littérature, pourrait-on ajouter. Éditorialisation et Littérature résume, à peu près, ma tentative avant-gardiste la plus osée dans la mesure où je mets en question non seulement le roman, mais tout l’appareil commercial monté par les éditeurs d’aujourd’hui, y compris les plus prestigieux. Les effleurer était déjà risqué, mais les dénoncer en tant que responsables de la décadence de la littérature contemporaine, transformée par leur truchement dans une sorte de divertissement banal, était vraiment téméraire. Beaucoup d’écrivains qui ont voulu s’affranchir des règles, pour ne pas dire des « interdictions », explicites ou tacites, imposées par les éditeurs, ont payé très cher cette insolence. D’abord, en se voyant freinés ou exclus des maisons où ils étaient publiés, puis trouvant portes fermées chez n’importe quel autre éditeur. Ils étaient « blacklistés », c’est à-dire, répertoriés comme infréquentables et dangereux pour il negozio littéraire, négoce dans lequel ce n’est pas l’écrivain qui décide, mais l’éditeur, acteur principal et souvent unique d’un processus qui n’a rien de « collectif » en dépit de ses apparences. Lecteurs de manuscrits, agents littéraires, comités de lecture, imprimeurs, publicistes, critiques, journalistes, attachés de presse, présentateurs-Tv, speakers-radios, libraires, etc., conglomérat impressionnant de professionnels du monde des lettres, ne font que masquer le centre de gravité d’un système centré non sur l’écrivain, mais sur l’éditeur, « individu » qui engage son argent en lançant sur le marché un produit souvent façonné selon ses paramètres esthétiques personnels ou, plutôt, selon ses désirs et ses caprices. Je décris cette situation dans Révolution dans l’édition littéraire, empli d’anecdotes tantôt drôles, tantôt tragiques sur cette mainmise des éditeurs sur les écrivains.Mais cette révolution dans l’édition littéraire ne concerne que la publication sur papier, toujours essentiellement tributaire de l’imprimerie et laisse en marge le processus de création lui-même, aujourd’hui tributaire du numérique.
L’éditorialisation met fin à tout ça. À condition qu’elle soit mise en pratique, bien entendu. Ce qui n’est pas du tout évident. En effet, l’écrivain d’aujourd’hui, surtout le romancier, même le plus malmené et méprisé par l’establishment littéraire ou, au contraire, le plus glorifié et enrichi par les éditeurs, a une attitude essentiellement passive face à tous ces phénomènes. Au fond, il veut un éditeur qui s’occupe efficacement (« paternellement », pourrait-on dire) de son œuvre. Pour lui, l’œuvre est finie au moment de rendre son manuscrit. Sa publication ne le concerne pas et il est très soulagé que cela soit ainsi. Cette pusillanimité, sciemment entretenue par l’éditeur, est le hiatus dont il profite pour faire ce qu’il veut avec l’œuvre en question. Par contre, dans l’éditorialisation (comme c’est la cas pour l’auto-édition en papier), l’écrevain doit avoir une attitude résolument active. C’est lui, avec son effort créateur qui décide de tout ce qui concerne son travail d’écriture, dans la mesure où il ouvre celui-ci à un « réseau d’intelligences » fondé sur la solidarité et l’honnêteté intellectuelles, réseau appelé à participer collectivement à la création de l’œuvre. En 2012 j’avais déjà abordé le problème du lecteur passif /lecteur actif (le lecteur passif étant, principalement, le lecteur de romans) dans un essai, Bakhtine, le roman et l’Intertexte, où j’explorais la richissime pensée du savant russe sur le roman. Ébloui par son érudition et par le style de son écriture, qui me rappelait Hegel et sa Phénoménologie, je pris très au sérieux tout le bien qu’il disait sur le roman proclamé « forme suprême et définitive de la littérature ». Démonter ses arguments n’était pas chose facile. Et pourtant il fallait le faire. La faille essentielle, le proton pseudos de sa théorie du roman, nettement décelable au début de sa logique, nonobstant très rigoureuse, est l’amalgame qu’il fait entre le roman et la littérature narrative, amalgame réfutable dans la mesure où le roman n’est qu’un genre littéraire séculaire et la littérature narrative une pratique millénaire. Et sa faiblesse principale, est celle de ne pas analyser sémiologiquement le rapport entre la lecture et l’écriture, entre le lecteur et l’écrivain, analyse qui ne serait entreprise que des années plus tard en France par Roland Barthes. Pour Bakhtine, entre le romancier et le lecteur il ne peut y avoir d’autre relation que celle de la lecture. Le roman est une structure fermée, à laquelle le lecteur n’a d’accès qu’en le lisant. Dans l’Intertexte, la relation écrivain-actif / lecteur-passif, se trouve donc profondément modifiée et permet l’apparition du lecteur-écrivain. L’Intertexte se développe alors comme un jeu de systèmes de références textuelles très mobiles, d’où le lecteur n’est pas exclu. Bien au contraire, le lecteur cesse d'être réduit à la catégorie de consommateur passif d’un texte et il est appelé à entrer dans celui-ci pour y participer. L’invention de l’écriture électronique rend possible cette éventualité, à l'apparence utopique, et les nouvelles technologies vont, de toute évidence, faciliter un phénomène qui deviendra de plus en plus courant. L’analyse de la pensée de Bakhtine, que j’ai sciemment pris à rebours dans mon Dialogue intertextuel avec Bakhtine, me permit de résoudre maints doutes à propos de l’Intertexte et surtout, de confirmer sa nécessité pour aller au-delà du roman. Le concept « lecteur-écrivain », où la passivité du lecteur imposée par la forme romanesque est dépassée, concept étayé par le « réseau d’intelligences » dont parlent Wormser et Vitali-Rosati, change radicalement le centre de gravité de la création littéraire. « On peut définir l’éditorialisation comme un ensemble d’appareils techniques (le réseau, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche), de structures (l’hypertexte, le multimédia, les métadonnées), de pratiques (l’annotation, les commentaires, les recommandations via les réseaux sociaux) qui permet de produire et d’organiser un contenu sur le web. » Ce contenu, s’agissant de littérature, c’est précisément l’Intertexte, qui trouve dans l’univers numérique, spécifiquement dans le web, le milieu idéal pour son épanouissement. Les éditeurs conventionnels peuvent utiliser aussi les outils cybernétiques, lesquels facilitent maintes tâches de l‘édition « papier » (y compris l’impression des livres par commande), mais cela ne modifie pas le fait essentiel : c’est l’éditeur et non pas l’écrivain le centre de gravité de la littérature, déséquilibre consolidé par le mécanisme de diffusion, solidement maîtrisé par les éditeurs. Dans un autre de mes essais Mme Filipetti, Ministre de la Culture et Romancière, je m’étonnais de cette conception tordue de la littérature en tant que produit -en premier chef- de l’éditeur, l’écrivain n’étant que l’ouvrier qui apporte la marchandise à exploiter. Sans éditeur, pas de littérature ! disait en substance la Ministre de la Culture et Romancière, ignorant le Roland Barthes de Mythologies, où le sémiologue dénonçait la déviation mercantile de la littérature. Dans sa Théorie du texte Roland Barthes affirme que le vrai lecteur est celui qui veut écrire : « Sans doute, il y a des lectures qui ne sont que des simples consommations : celles précisément tout au long desquelles la signifiance est censurée ; la pleine lecture, au contraire, est celle où le lecteur n'est rien de moins que celui qui veut écrire (...) » C’est le cas de Marcel Proust. Le jeune Proust rêvait d’écrire et il désespérait de ne pas être capable de le faire, croyant qu’il manquait de talent. Mais son désir d’écrire était si intense, qu’il appelait cela « sa vocation », sans laquelle sa vie n’avait pas de sens. Ses lectures de jeunesse, surtout la lecture de l’œuvre d’Anatole France, dont la prose élégante et transparente l’avait subjugué, mais aussi les articles de Sainte-Beuve, le critique littéraire le plus important de son époque, cristallisèrent chez lui « le lecteur-écrivain ». Or, lisant la théorie du roman de Bakhtine, je m’étonnais du fait qu’il ne prenne compte ni de Proust ni de son œuvre maîtresse, À la Recherche du temps perdu, œuvre fondamentale pour comprendre l’évolution de la littérature narrative. Même escamotage en ce qui concerne Ulysses et Finnegans Wake, de James Joyce. Cependant, il connaissait les deux auteurs, célèbres depuis les années 20 (Bakhtine est décédé en 1975). C’était assez incompréhensible de la part d’un érudit comme lui. Le « rideau de fer » culturel entre l’Union Soviétique et le reste de l’Europe ne suffisait pas à expliquer cette négligence, comme je le signale dans mon premier essai sur le savant russe. Je ne résolus le mystère qu’en écrivant un nouvel essai - Bakhtine, Proust et la polyphonie romanesque chez Dostoievski-, texte que je présentai personnellement à l’Institut Gorki de Moscou, où je me suis rendu pour participer à une rencontre littéraire organisée par Tatiana Victoroff et Luc Fraisse, professeur de littérature à l’Université de Strasbourg. Le colloque intitulé « Proust / Bakhtine, regards croisés » se prêtait particulièrement bien pour éclairer le problème. Comment concilier la pensée du savant russe et la création de l’écrivain français ? Et comment comprendre la position de Proust face au roman, genre qui échappait à son désir d’écriture absolue ? En 2017, je m’étais rendu à Santiago pour répondre à une invitation de David Wallace, professeur de littérature à l’Université du Chili, où j’eus l’occasion d’examiner avec ses étudiants les données de la naissance de l’Intertexte. Pendant les « Conversaciones sobre la (anti) novela » (titre de la rencontre universitaire), je pus une fois de plus constater les malentendus, aussi inévitables que nombreux, qui entourent l’Intertexte. Mes deux premiers livres, El Bautismo et El Sueño, publiés en Espagne par Montesinos Editor (Barcelona, 1983-1985) sous le pseudonyme de Juan Almendro ne sont pas, à proprement parler, des romans, mais des antiromans. Je suivais un peu la mode anti-romanesque dont Rayuela, ouvrage de l’écrivain argentin, Julio Cortázar, et les antiromans de l’écrivain chilien, Juan-Agustín Palazuelos, étaient pour moi des indices prémonitoires de la fin de l’époque romanesque. Je fus surpris de découvrir que ces antiromans, en particulier El Bautismo, étaient suivis à l’Université du Chili depuis trente ans… sans que je le sache. En effet, exilé d’abord aux États-Unis, puis en Europe et empêché de rentrer au Chili à cause du pinochétisme, j’avais coupé pratiquement tous mes liens avec mon pays. Mais David Wallace avait lu El Bautismo et il l’avait incorporé aux lectures proposées à ses étudiants. Seulement, mon travail y était étudié sous l’angle de l’antiroman. L’Intertexte n’existait pas pour les étudiants et, pendant nos échanges, ils firent le rapprochement plutôt entre l’Intertexte et le plagiat. Je raconte ces vicissitudes dans Entretien avec David Wallace, entretien réalisé lors de notre première rencontre à Santiago, en 2015, puis dans un nouvel essai, Plagiat et Intertextualité, rédigé après les « Conversaciones sobre la anti-novela » à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université du Chili. La Recherche n’est donc pas un antiroman… et elle n’est pas non plus un roman, en dépit de tous les efforts de l’establishment édito-littéraire pour qu’il en soit ainsi. Le prestige du prix Goncourt et les affaires du clan Gallimard dépendent d’une appellation qui « fait vendre ». Proust, lecteur-écrivain qui avait présenté timidement son manuscrit à Monsieur Grasset pour lui demander de le publier à compte d’auteur (il paya environ 10.000 euros d’aujourd’hui, amputant son texte de quelques centaines de pages « inutiles » d’après l’éditeur), ne s’intéressait pas beaucoup à la Rhétorique. Il écrivait suivant son propre génie. Et ce génie l’amenait hors des limites du roman traditionnel, le roman de personnages, celui-là même que Dostoïevski avait fait évoluer jusqu’à son apogée grâce à la polyphonie romanesque. La Recherche, j’insiste, n’est pas un roman, ni un antiroman, ni un Intertexte, mais une autofiction, genre intermédiaire entre le roman et l’Intertexte. C’est à peu près ce que je « démontre » (Proust disait que son œuvre était une « démonstration ») dans mon essai présenté à l’Institut Gorki en novembre 2019. La définition de la Recherche comme « autofiction », genre « intermédiaire », est très importante. Il est impossible de quitter la forme « roman » d’une façon abrupte. Plusieurs siècles d’habitudes romanesques ont engendré une puissante inertie, très difficile à vaincre. L’Intertexte ne surgit pas brusquement, il provient de plusieurs tentatives préalables : le Satyricon de Petronius peut être considéré comme un premier précurseur, presque vingt siècles avant Tristram Shandy de Laurence Sterne et de l’Ulysses de James Joyce. Or, la Recherche est aussi un texte précurseur d’une nouvelle forme où le lecteur cesse d’être un agent passif et peut devenir, comme Marcel Proust lui-même, un écrivain actif. Tout dépend de son désir d’écriture, car il n’est pas tributaire d’un éditeur pour savoir si ce qu’il écrit est « bon ou mauvais », « rentable ou pas rentable » mais, grâce à l’éditorialisation, il peut écrire (lire-écrire) selon les dictées de sa propre conscience et partager sa création dans un « réseau d’intelligences » réceptif, éloigné de considérations mercantiles. Si la définition de l’éditorialisation de Vitali-Rosati fut déterminante pour me permettre d’esquisser une théorie de l‘Intertexte, sa thèse de doctorat à l’Université de Pise, Riflessione e Trascendenza, m’apporta aussi une grande aide pour observer l’Intertexte d’un point de vue strictement logique. En effet, la logique qui régit la structure du roman est la logique aristotélicienne, la logique formelle, la même que Newton applique dans sa théorie de la gravitation. Le roman est newtonien. (Je parle de l’architecture du roman et non pas de son contenu, évidemment.) Or, la logique de l’Intertexte suppose une logique différente, puisque son approche du temps et de l’espace en tant que espace-temps, est « einsteinien ». Et c’est la logique de la transcendance, telle que la conçoit Vitali-Rosati dans son analyse de l’Éthique de Lévinas (« Les idées lévinassiennes ne respectent pas les principes de la logique formelle, elles semblent plutôt se fonder sur une logique "autre"), la logique qui permet aussi de mieux comprendre la structure de l’Intertexte, où le temps et l’espace sont bouleversés par le jeu intertextuel et par la relation lecteur-écrivain. « La logique formelle est fondée sur une conception du Temps comme étant continu. Il est possible de parler logiquement à tout moment du futur si le Temps est quelque chose d’homogène. L’acceptation d’une discontinuité du Temps conduirait à une série de paradoxes que la logique formelle ne peut pas admettre (...) La validité du principe de causalité est impensable pour celui qui pense à la possibilité des sauts du Temps, d’un morcellement qui casse la relation entre présent, passé et avenir », précise Vitali-Rosati. Ces « sauts du Temps » constituent un phénomène typique de l’Intertexte : La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain) reflète, sans peur des « contradictions » chronologiques ou autres, dans un même texte, le Faust de Marlowe (1592), celui de Goethe (1808-1832), de Thomas Mann (1947), de Valéry (1946), etc. « La logique formelle ne suffit pas pour expliquer la rencontre avec l’altérité », insiste Vitali-Rosati. Mais qu’est-ce que l’Altérité ? «L’altérité est tout ce qui reste indépendant de n’importe quel rapport : à partir de maintenant le mot "Autre" doit être compris comme synonyme de transcendance. L’Autre n’est pas seulement l’autre homme (...) Même un objet est "Autre" dans la mesure où il est différent du sujet qui cherche un rapport (...) Le sujet s’ouvre dans le sentiment d’être la condition de la possibilité de l’expression de l’Autre : sans moi (autoréférence) la voix reste inaudible (…) Que l’altérité s’exprime "pour moi" ne signifie pas que je la possède mais que je suis le "moyen" d’expression de l’altérité » Voici donc une nouvelle analogie possible avec l’Intertexte, forme narrative tissée avec un ensemble de citations qui trouvent leur origine dans l’expression de l’auteur cité. Expression manifestée à travers un « pour soi » autoréférentiel : l’écrivain intertextuel n’occulte pas l’écrivain cité, comme cela advient dans le plagiat, lequel détruit toute altérité. Cet « aplatissement » (appiattimento) advient habituellement dans le roman, que nous pourrions peut-être considérer, suivant la logique de la réflexion et de la transcendance, comme une forme réflexive « inauthentique », où l’altérité n’est jamais trouvée. L’écrivain et le lecteur sont irrémédiablement séparés. En revanche, dans l’Intertexte, ouvert au lecteur-écrivain, l’altérité peut se consolider esthétiquement, scripturalement. « En ce sens, l’homme est, principalement, écriture, concrétisation du langage. », soutient Vitali-Rosati. Ceci ouvre les portes à une véritable révolution dans la communication humaine en général, et dans la littérature en particulier : l’homme-communicant, notamment dans l’univers du numérique, répétons-le, cesse d’être un simple lecteur comme dans le roman, il peut devenir « lecteur-écrivain », comme dans l’Intertexte. Au début de l'année 2019, Sens Public publia un entretien du dramaturge, metteur en scène et réalisateur de cinéma, Peter Brook - Presence and Creation- réalisé en 2016 dans le cadre de la Academy of Arts of New York par le peintre et architecte chilien, Pedro Pérez-Guillón. L’entretien, publié simultanément en anglais, français et espagnol grâce à l’effort de Servanne Monjour et de son équipe SP à Montréal, se développe essentiellement autour du théâtre et des arts plastiques. La littérature n'y est abordée que tangentiellement. Ayant été moi-même élève de Peter Brook pendant sept ans (1979 -1986) à l'Institut Gurdjieff de Paris (sous la direction de Madame Jeanne de Salzmann et du docteur Michel de Salzmann), il me semble utile et nécessaire de regarder mon travail théorique à la lumière de la pensée de celui qui est considéré comme l'un des hommes de théâtre parmi les plus importants de notre époque, mais qui restera aussi dans la mémoire de notre temps comme un guide spirituel. La difficulté est considérable, d’autant plus que le mécanisme de création dans la littérature narrative -le roman en particulier- est plutôt réfractaire à une approche "spirituelle", contrairement à la poésie. Peut-être pourrions-nous considérer À la Recherche du Temps Perdu comme une exception. Le Livro do Desassossego du poète portugais Fernando Pessoa, pourrait aussi être lu comme une œuvre de fiction narrative où la spiritualité est intensément perceptible par le lecteur attentif. Cet ouvrage, transcendantal dans la littérature occidentale, est comparable par sa profondeur aux écrits du poète et maître spirituel indien, Krishnamurti. Coïncidence rhétorique étonnante, tous deux ont constamment recours à l’oxymoron comme figure de style, mais ils s’opposent formellement et fondamentalement dans la mesure où Krishnamurti propose un chemin d’apaisement et de douceur pour atteindre en soi la présence de l’être, tandis que Pessoa reste dans la constatation de l’absence de cette présence chez l’homme ordinaire et se limite à poétiser son désespoir. Même ainsi, son œuvre constitue l’un des rares exemples de haute spiritualité dans la littérature du XXe siècle. La création et la présence dans le sens où Peter Brook en parle dans cet entretien, semblent étrangères à la narration, surtout lorsqu’il s’agit de longs récits romanesques. Y a-t-il quelque chose d’authentiquement spirituel dans Les Frères Karamazov ? Peut-on parler de "spiritualité" quand Dostoïevski introduit le personnage d’Aliocha, le jeune novice serviteur et dévot de son starets moribond, ou lorsque le romancier fait parler Le grand Inquisiteur pour accuser le Christ de ne pas tenir ses promesses ? Il ne faut pas confondre spiritualité et "bondieuserie". La conscience de soi des personnages dostoïevskiens et leurs dialogues autour du christianisme orthodoxe ne sont pas plus "spirituels", malgré leur prétendue liberté polyphonique, que les réflexions monophoniques, densément psychologiques et matérialistes, des romans philosophiques de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus. L’Intertexte cherche à s'approcher au plus près de la conscience de soi de l’écrivain et de celle du lecteur. La spiritualité se joue sur ce niveau-là, celui de la conscience. En introduisant l’intertextualité comme mécanisme central de la narration, je cherche à créer un jeu de références qui me permet -en tant qu’écrivain- de prendre en compte consciemment l’écriture d’autrui et de laisser ouverte une nouvelle proposition textuelle au lecteur qui, à son tour, peut l’utiliser comme un nouveau système de références et ainsi de suite. « Ce qui est terrible dans les universités et les écoles d’art, c’est qu’elles commencent toujours par la forme », se plaint Peter Brook. Ce que nous cherchons (toujours avec l’aide de la forme), c’est trouver ce qui peut illuminer la forme. Et c’est ce qui peut illuminer la forme qui est vraiment valable. Si nous sommes attentifs à la vie, nous pouvons sentir que la vie est en mouvement permanent et, par conséquent, ses formes changent aussi tout le temps. Les grands artistes de toutes les époques sont conscients que la vie et ses formes changent constamment. Et c’est pour cette raison que pour un compositeur de notre temps écrire de la musique à la façon de Stravinsky ou de Bach, n’a aucun sens. Ces formes-là étaient très justes à leur époque. Plus tard, on les reconnaît, on les enregistre et on les inclut dans ce qu’on appelle "Histoire de l’art". Plus tard, il arrivera un moment où l’artiste sentira le besoin d’un changement et, comme Picasso, il dira : "Non, nous ne pouvons pas continuer à faire les choses de la même façon qu’il y a 50 ans, nous ne pouvons pas continuer à faire des peintures naturalistes parfaites, il y a quelque chose de nouveau qui doit être révélé et il faut essayer de chercher quelle est la forme adéquate pour cela". Peter Brook reconnaît la nécessité d’innover, de trouver des formes nouvelles pour exprimer ce qu’il y a de nouveau dans l’évolution de la vie humaine. Pour moi la "forme roman" est dépassée, périmée, elle ne correspond plus aux besoins de l’individu ni à ceux de la société. L’invraisemblable banalité des romans encensés par la critique des journaux est consternante. La cascade des prix littéraires déversés sur la production romanesque mondiale dissimule la basse qualité des ouvrages proposés néanmoins comme des "chefs d’œuvre de la littérature universelle", tous façonnés à peu près sur la même forme. Il faut trouver une issue pour échapper à cette médiocrité formelle qui ronge de l'intérieur la littérature la transformant dans un simple objet de consommation, en pitoyable "parole putanisée", comme dit Gurdjieff dans le prologue de Rencontre avec des hommes remarquables, livre devenu un film réalisé par Peter Brook en 1978-1979. Et je vois dans l’Intertexte l'un des moyens de mettre fin à cette dérive et de redonner à la littérature une nouvelle vitalité. Je mets fin à cet historique en faisant référence à mon dernier livre Théorie de l’Intertexte, ouvrage où je réunis l’ensemble de mes réflexions sur l’Intertexte, en y incorporant un dernier essai, Exercices de théorie littéraire et théorie de l’Intertexte. Dans cet essai, je prends à rebours, comme je l’avais fait en 2012 avec la pensée de Bakhtine, les idées de Sophie Rabau sur la théorie littéraire. En substance, pour Sophie Rabau (maîtresse de travaux à la Sorbonne Nouvelle, experte en Rhétorique, devenue romancière et qui nie, par conséquent, la réalité de l’Intertexte), la théorie littéraire ne sert pas à grande chose : « Peut-être donc peut-on aussi répondre à cette question (l’utilité et la pertinence de la théorie littéraire) en disant que théoriser sert à théoriser, la théorisation a pour but premier la production théorique. ». Autrement dit, tisser de l’air avec de l’air ?
|
Un tercer (y último) ciclo, esencialmente teórico y centrado sobre los aspectos formales del Intertexto en cuanto modalidad narrativa post-novelesca, comenzó a estructurarse en 2003-2004. Hasta entonces sólo las interrogaciones formuladas por los escritores de la Nouvelle Fiction Française a propósito del Intertexto, me habían hecho sentir la necesidad de responder mediante conceptos estéticos. Erróneamente había creído que mis textos de ficción literaria eran suficientes. Así, como consecuencia de un coloquio internacional que organicé en 1998 en Calaceite (Teruel, España) para el grupo de escritores presidido por Frédérick Tristan, escribí En marge d’André Pieyre de Mandiargues (Songe intertextuel autour de la Nouvelle Fiction) con el fin de aclarar el problema. No fue el caso. Incluso la publicación en París del Portrait d’un Psychiatre Incinéré (Éditions de la Différence, 1999) y de La Guérison (id., 2001), textos comentados más o menos elogiosamente por la crítica parisina, no bastaron para suprimir las ambigüedades en torno al Intertexto, tanto más cuanto Joaquim Vital, el director de La Différence, me pidió publicar esos dos libros bajo la rúbrica ‘ novela ’ por razones comerciales. (« Si publico tus libros bajo la rúbrica ‘intertexto’, te puede pasar lo mismo que le ocurrió a Breton con Les Champs Magnétiques en Nueva York, donde los libreros pusieron el libro en la sección ‘electricidad’. Aquí en París tú podrías descubrir La Guérison en la sección ‘informática’). Por su parte, los críticos franceses, belgas y suizos estimaron que mis libros eran novelas droláticas un poco extrañas, pero novelas al fin y al cabo.
En 2004, invitado a participar en el encuentro anual de Belles Latinas en Lyon, programé un « intertexto colectivo » con los estudiantes del prestigioso liceo Édouard Herriot. en torno a la leyenda de Fausto. Gérard Wormser, doctor en filosofía y profesor en l'École Normale Supérieure de Lyon, fundador de la asociación Sens Public (revista electrónica plurilingüe y casa editorial), me ayudó a guiar a los alumnos en la escritura electrónica de este Intertexto colectivo experimental. Sin embargo sólo fue al año siguiente, en el Manifeste pour une nouvelle littérature?, presentado simultáneamente con la edición de La Société des Hommes Célestes en el stand de Sens Public en el Salon du Livre de Paris (2005), que fue cuestión, por primera vez, de una formalización conceptual del Intertexto en cuanto género post-novelesco.
Varios miembros de Sens Public presentes en el castillo de Valderrobres dieron conferencias sobre el significado de la intertextualidad (Ingeburg Lachaussée, germanista, Maître de conférences de philosophie politique à Sciences Po), de la interpicturalidad (Madeleine Vallette-Fondo, Maître de conférences à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée) y de la intermusicalidad (Margarita Celma, doctora en musicología, directora de la Coral Mataranya), mientras que el cineasta Yann Kilborne (maître de conférences à l’Université Bordeaux-Montaigne) prolongó sus reflexiones hacia el cine. La aparición del Intertexto como nueva forma narrativa post-novelesca no es entonces un fenómeno aislado de otras prácticas artísticas, sino al contrario, forma parte de un movimiento de renovación de la cultura contemporánea en cuyo seno el multiculturalismo, el plurilingüismo y el intercambio de principios estéticos y de técnicas es determinante. Pese a todas estas conferencias y debates, yo seguía encontrando grandes dificultades para resumir y expresar conceptualmente mi trabajo y mis intenciones, sobre todo frente a los editores que dudaban en publicar textos no solamente « vanguardistas », destinados en principio a un público restringido, sino que además imponían complejas y costosas exigencias técnicas, prácticamente insuperables para la edición convencional. En el Manifiesto había llamado la atención sobre un hecho inevitable : « no habrá una nueva literatura sin un nuevo sistema de edición ». El rechazo de los editores tradicionales (incluso Sens Public, todavía en sus comienzos como editorial), para publicar Madre/Montaña/Jazmín a causa de sus dibujos y colores, confirmaba esta situación. El Intertexto parecía destinado a perderse como modalidad narrativa o a quedar como una simple curiosidad en la historia de la literatura. Fue entonces que descubrí Create Space, la estructura de ‘self-edition’ inaugurada por Amazon en Estados Unidos. Según lo cuento en mi artículo Revolución en la edición literaria (Agoravox, octubre de 2011), todo lo que había imaginado a propósito de la evolución indispensable de la edición tradicional para hacer factible el desarrollo de una nueva literatura, había sido realizado por un grupo de escritores americanos cuyas denuncias de la pusilanimidad y ‘affairisme’ de los editores convencionales habían sido escuchadas y comprendidas por Amazon. Pude entonces editar Madre/Montaña/Jazmín siguiendo mis propias exigencias, decidiendo personalmente cada aspecto formal de la edición, prolongando así el proceso creativo de la escritura. Luego, siguiendo el mismo procedimiento, publiqué la totalidad de mis manuscritos inéditos, entre ellos El Rapto de Sabina, libro a la vez intertextual e interpictural que contiene reproducciones ‘full color’ de las Anunciaciones de Florencia, cuyo manuscrito había sido rechazado por los editores bajo el pretexto del elevado costo de su impresión, costo en cambio abordable dentro de los parámetros de la ‘new fashion edition’. Y pude también, al fin, desarrollar, completar y publicar mis textos teóricos, poco o nada comerciales, sobre el Intertexto (Bakhtine, le Roman et le Intertexte, Dialogue intertextuel avec Bakhtine, etc.), reunidos en el Manifiesto por una Nueva Literatura, ahora desprovisto del signo de interrogación que acompañaba su primera versión en 2005.
Tras la reunión en el castillo de Valderrobres, continué en París el proceso de teorización del Intertexto. Una vez más, cuando creía haber alcanzado una estabilidad suficiente en mi enfoque intertextual, choqué con una realidad lamentable : el mercado literario, sólidamente protegido contra cualquier intento de ir más allá de la novela, eje principal de la industria literaria. En el mundo de la literatura actual, fundamentalmente novelesca, el Intertexto como nueva modalidad narrativa, que implica además un cambio en el mecanismo de edición, sólo podía interesar a los investigadores lingüísticos. Tampoco fue el caso. Ya había intentado acercarme a los escritores de la vanguardia francesa “oficial” (Correspondance unilatérale avec Sollers) para compartir mis investigaciones, sin ningún éxito. La crítica de la novela como género narrativo había sido archivada y convenientemente olvidada en interés del comercio editorial. Ahora bien, eso no me impidió rescatar la opinión de Roland Barthes sobre las vanguardias en general, incluyendo al grupo Tel Quel, del cual fue un miembro emérito :
La lucidez de Barthes me dejó atónito. El mayor teórico contemporáneo de la literatura francesa, cuya luz (a veces “oscilante”) iluminó la sinuosa y a menudo confusa trayectoria de Tel Quel, señala la existencia de un muro prácticamente insuperable para cualquier escritor de vanguardia : los intereses y valores estatutarios de la burguesía, es decir, de la sociedad capitalista. La novela, vanguardista o no, satisface estos intereses para continuar existiendo. Y el escritor, si quiere publicar y ganar dinero, tiene que proclamarse “novelista” y elogiar la novela. Dadas estas circunstancias, ¿cuáles eran las posibilidades de supervivencia o de simple manifestación de un nuevo género narrativo como el Intertexto, que busca ir más allá de la novela? Se pueden inventar los objetos literarios más sofisticados en la intimidad de los laboratorios lingüísticos, pero a condición de no cruzar las fronteras marcadas por la burguesía. De lo contrario, el intento vanguardista será asfixiado. Es lo que le ocurrió al grupo Tel Quel tras la muerte de Roland Barthes, como cuento en “L’énigme romanesque de Roland Barthes”. En consecuencia, cualquiera pretensión de que el Intertexto sea reconocido, aceptado y promovido en el mundo convencional de las letras, dependiente de la imprenta y del soporte en papel, parecía irrisoria. No tenía sentido recordar los ejemplos clásicos de Schopenhauer, Cézanne, Pessoa, Kafka y otros creadores e innovadores, grandes o pequeños, que murieron desconocidos o no reconocidos. Sin embargo, al menos desde un punto de vista teórico, todavía había algo que desarrollar sin hacer concesiones al establishment editorial-literario: la reflexión sobre la libertad de creación, siempre mencionada, pero rara vez respetada en el universo novelesco y sobre la libertad de publicación, ambas esenciales para el Intertexto. Sobre este punto, la ayuda brindada por Marcello Vitali Rosati, profesor de literatura e investigación digital en la Universidad de Montreal, miembro de Sens Public, fue fundamental para mí.
En 2004 tomé la decisión de seguir el enfoque mediático de Gérard Wormser, radicalmente opuesto al camino seguido por los medios de comunicación convencionales. Wormser había comprendido, desde el inicio de Internet, el inmenso alcance de la revolución cibernética en una época en la que eminentes “sorbonnards” todavía creían que Internet y las computadoras no eran más que una nueva moda, condenada a una rápida desaparición para alivio de una generación de profesores ya ancianos, incapaces de aprender a utilizar los dispositivos electrónicos. Sus esfuerzos se basaron en la nueva realidad tecnológica, una plataforma bienvenida e imprescindible para el Intertexto que encontraría en la editorialización, tal como la definen Wormser y Vitali-Rosati, el método para superar la barrera que opone la burguesía (Barthes dixit) a la libertad de creación y a la libertad de publicación.
¿Qué es la editorialización?, me preguntaba en un breve ensayo Editorialización y Literatura, publicado en marzo de 2016. Hay dos respuestas posibles que recuerdan analógicamente a Einstein y sus dos teorías de la relatividad : la restringida, de Marcello Vitali-Rosati, que se refiere principalmente sólo al mundo de la edición ; la otra, más general, de Gérard Wormser, que engloba todo un conjunto de manifestaciones del mundo digital. Empecemos por esta última: “Llamamos editorialización al proceso de explicación dialógica que permite a los grupos estructurar sus intercambios y convertirse en actores de las redes de conocimiento”, señala Wormser en su conferencia Globalización y Editorialización (Salón Dionys’Hum, 2015). Pasemos ahora a la definición más restringida, la que se limita al mundo editorial:
Editorialización y literatura resume mi tentativa vanguardista más audaz pues cuestiono no sólo la novela, sino todo el aparato comercial montado por los editores actuales, incluidos los más prestigiosos. Criticarlos, como se atrevió a hacerlo el joven Barthes, ya era arriesgado, pero denunciarlos como responsables de la decadencia de la literatura contemporánea, transformada por su intermedio en una especie de entretenimiento banal, era temerario. Muchos escritores que trataron de liberarse de las reglas, por no decir "prohibiciones" explícitas o tácitas, impuestas por los editores, han pagado muy caro esta insolencia. Fueron excluidos o frenados (fue el caso de Barthes) en las editoriales donde habían sido publicados, encontrando luego las puertas cerradas en cualquier otra editorial (fue mi propio caso en España y también en Francia). Pasaron a estar “en la lista negra”, es decir, catalogados como peligrosos para il negozio literario, un negocio en el que no es el escritor quien decide, sino el editor, actor principal de un proceso que no tiene nada de “colectivo” a pesar de sus apariencias. La multitud de lectores profesionales, agentes, comités de lectura, impresores, publicistas, críticos, periodistas, attachés de prensa, presentadores de televisión, locutores de radio, libreros, etc., conglomerado impresionante de trabajadores del mundo de las letras, sólo enmascara el centro de gravedad de un sistema centrado no en el escritor, sino en el editor, “individuo” que compromete su dinero lanzando un producto al mercado a menudo modelado según sus parámetros estéticos personales o, mejor dicho, según sus deseos y sus caprichos. Describo esta situación en otro de mis artículos, Revolución en la edición literaria, que recoge algunas anécdotas a veces divertidas, a veces trágicas, sobre el control y dominio de los editores sobre los escritores. Pero esta revolución en la edición literaria sólo afecta a la publicación en papel, todavía esencialmente dependiente de la imprenta, y deja al margen el propio proceso creativo, hoy dependiente de la tecnología digital.. La editorialización pone fin a todo eso. Siempre que se ponga en práctica, desde luego. Lo cual no es evidente. De hecho, el escritor de hoy, especialmente el novelista, incluso el más maltratado y despreciado por el establishment literario o, por el contrario, el más glorificado y enriquecido por los editores, tiene una actitud esencialmente pasiva ante todos estos fenómenos. El novelista quiere un editor que se ocupe eficazmente de su trabajo (“paternalmente”, se podría decir). Para él, su trabajo está terminado cuando entrega su manuscrito. Su publicación no le preocupa y se siente muy aliviado de que sea así. Esta pusilanimidad, confortada sagazmente por el editor, es el hiatus que aprovecha para hacer lo que quiere con el trabajo del escritor. En cambio, en la editorialización (como es el caso en la auto-edicion en papel), el escritor debe tener una actitud decididamente activa. Es él, con su esfuerzo creativo, quien decide de todo lo concerniente a su obra literaria, en la medida en que se abre a una “red de inteligencias” basada en la solidaridad y la honestidad intelectuales, red llamada a participar colectivamente en la creación de la obra.
En 2012 abordé el problema del lector-pasivo/lector-activo (el lector pasivo es, principalmente, el lector de novelas) en un ensayo, Bajtín, la novela y el Intertexto, donde exploré el pensamiento del erudito ruso. Deslumbrado por su erudición y por el estilo de su escritura, que me recordó Hegel y su Fenomenología, tomé muy en serio todo que decía sobre la novela, proclamada “forma suprema y definitiva de literatura”. Desmontar sus argumentos no fue fácil. Y, sin embargo, había que hacerlo. El defecto esencial, el pseudo proton de su teoría de la novela es detectable desde el comienzo de su lógica (sin embargo muy rigurosa) : la amalgama entre la novela y la literatura narrativa, amalgama refutable dado que la novela es un género literario secular y la literatura narrativa, una práctica milenaria. Y su principal debilidad, la de no analizar semiológicamente la relación entre lectura y escritura, entre el lector y el escritor, análisis que realizaría años más tarde Roland Barthes. Para Bajtín, entre el novelista y el lector no puede haber otra relación que la de lectura. La novela es una estructura cerrada, a la que el lector sólo tiene acceso leyéndola. En el Intertexto la relación escritor-activo/lector-pasivo es profundamente modificada y permite la aparición del lector-escritor. El Intertexto se desarrolla como un conjunto de sistemas de referencia textuales móviles, del cual el lector no queda excluido. Por el contrario, el lector deja de verse reducido a categoría de consumidor pasivo de un texto y está llamado a entrar en él para participar en su desarrollo. La invención de la escritura electrónica hace posible esta eventualidad, en apariencia utópica, y las nuevas tecnologías facilitan un fenómeno que será cada vez más frecuente.
El análisis del pensamiento de Bajtín que completé en mi Diálogo intertextual con Batín me permitió resolver muchas dudas sobre el Intertexto y pude confirmar su necesidad ineludible para ir más allá de la novela. El concepto “lector-escritor”, concepto respaldado por la “red de inteligencias” teorizada por Wormser y Vitali-Rosati, cambia radicalmente el centro de gravedad de creación literaria.
Vuelvo a la definición de la editorialización según Vitali-Rosati:
Es el caso de Marcel Proust. El joven Proust soñaba con escribir y se desesperaba por no poder hacerlo, creyendo que le faltaba talento. Pero su deseo de escritura era tan intenso que llegó a llamarlo “su vocación”, sin la cual su vida no tenía sentido. Sus lecturas juveniles, especialmente la lectura de la obra de Anatole France, cuya prosa elegante y transparente lo había cautivado, pero también los artículos de Sainte-Beuve, el crítico literario más importante de su época, cristalizaron en él al “lector-escritor”. Leyendo la teoría de novela de Bajtín, me sorprendió que no tuviera en cuenta ni a Proust ni a su obra maestra, En busca del tiempo perdido, obra fundamental para comprender la evolución de la literatura narrativa. Misma omisión en lo que se refiere a Ulises y Finnegans Wake, de James Joyce. Sin embargo, él sabía de la existencia de los dos autores, reconocidos mundialmente desde la década de 1920 (Bajtín murió en 1975). Su indiferencia era incomprensible viniendo de un erudito como él. El “telón de acero” cultural entre la Unión Soviética y el resto de Europa no era suficiente para explicarla, como lo señalé en mi primer ensayo sobre el sabio ruso. Sólo resolví el misterio escribiendo un nuevo ensayo, Bakhtine, Proust et la polyphonie romanesque chez Dostoïevski, texto que presenté personalmente en el Instituto Gorky de Moscú, donde fui para participar en un encuentro literario organizado por Tatiana Victoroff y Luc Fraisse, profesor de literatura en la Universidad de Estrasburgo. La conferencia titulada “Proust / Bakhtine, regards croisés” se prestó particularmente bien para iluminar la problema. ¿Cómo conciliar el pensamiento del estudioso ruso y la creación del escritor francés ? ¿Y cómo entender la posición de Proust respecto de la novela, género que escapó a su deseo de escritura absoluta?
En 2017 fui a Santiago respondiendo a una invitación de David Wallace, profesor de literatura de la Universidad de Chile. Durante las “Conversaciones sobre la (anti) novela” (título del encuentro universitario), pude comprobar una vez más los innumerables malentendidos que rodean mi trabajo. Mis dos primeros libros, El Bautismo y El Sueño, publicados en España por Montesinos Editor (Barcelona, 1983-1985) bajo el seudónimo “Juan Almendro”, no son novelas sino antinovelas. En ellos seguí un poco la moda de la antinovela influenciado por Rayuela, la obra del escritor argentino, Julio Cortázar, y por las antinovelas del escritor chileno Juan- Agustín Palazuelos, obras premonitorias del fin de la época novelesca. Pues bien, me sorprendió descubrir que mis antinovelas, en particular El Bautismo, eran estudiadas en la Universidad de Chile desde hacía treinta años... sin que yo lo supiera. De hecho, exiliado primero en Estados Unidos, luego en Europa e impedido de regresar a Chile a causa del pinochetismo, prácticamente había cortado todos mis vínculos con mi país. Pero David Wallace había leído El Bautismo y lo había incorporado en las lecturas propuestas a sus alumnos. Sólo que mi trabajo era estudiado desde el ángulo de la antinovela. El Intertexto no existía para los estudiantes y en nuestras discusiones hicieron la comparación entre el Intertexto y el plagio. Relato estas vicisitudes en una entrevista con Wallace y en un nuevo ensayo, Plagio e Intertextualidad, escrito después de las “Conversaciones sobre la anti- novela” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile.
La Recherche no es una antinovela... y tampoco es una novela, a pesar de todos los esfuerzos del establishment editorial-literario para que sea así. El prestigio del premio Goncourt y los negocios del clan Gallimard dependen de una etiqueta que “vende”. Proust, lector-escritor que presentó tímidamente su manuscrito al señor Grasset para rogarle que lo publicara “a cuenta de autor” (pagó el equivalente de unos 10.000 euros actuales, obligándose a amputar su texto de cientos de páginas, “inútiles” según el editor), no se interesaba mucho en la retórica. Escribió según su propio genio, genialidad que lo llevó más allá de los límites de la novela tradicional, la novela de personajes, forma que Dostoievski había llevado hasta su apogeo gracias a su invención, la polifonía novelesca. La Recherche, insisto, no es una novela, ni una antinovela, ni un intertexto, sino una autoficción, género intermedio entre la novela y el intertexto. Esto es más o menos lo que “demuestro” (Proust decía que La Recherche es una “demostración”) en mi ensayo presentado en el Instituto Gorky de Moscú en noviembre de 2019. La definición de La Recherche como “autoficción”, género “intermedio”, es muy importante. Desde un punto de vista histórico (materialismo histórico) es imposible salir de la forma “novela” de un solo golpe, de manera abrupta. Siglos de hábitos novelescos han generado una poderosa inercia, muy difícil de superar. El Intertexto no surge de repente, surge de varios intentos anteriores: el Satiricón de Petronio puede considerarse como primer precursor, casi veinte siglos antes que Tristram Shandy de Laurence Sterne y Ulysses de James Joyce. La Recherche también es un texto precursor de la nueva forma , donde el lector deja de ser un agente pasivo y puede convertirse, como el propio Marcel Proust, en un escritor activo. Todo depende de su deseo de escribir, porque no es tributario de un editor para saber si lo que escribe es “bueno o malo”, “rentable o no rentable”. Gracias a la editorialización, puede escribir (leer-escribir) según los dictados de su propia conciencia y compartir su creación en una “red de inteligencias”, alejado de consideraciones mercantiles.
Si la definición de la editorialización de Vitali-Rosati fue decisiva para esbozar una teoría del Intertexto, su tesis doctoral en la Universidad de Pisa, Riflessione e Trascendenza, me ayudó también a observar el Intertexto desde un punto de vista estrictamente lógico. La lógica que gobierna la estructura de la novela es la lógica aristotélica, la lógica formal, la misma que aplica Newton en su teoría de la gravitación. La novela es newtoniana. (Me refiero a la arquitectura de la novela y no a su contenido, obviamente.) Ahora bien, la lógica del Intertexto supone una lógica diferente, puesto que su acercamiento al tiempo y al espacio es “einsteiniano”. Esta lógica diferente es la lógica de la trascendencia, tal como la concibe Vitali-Rosati en su análisis de la Ética de Levinas (“Los levinassianos no respetan los principios de la lógica formal, parecen basarse en una lógica "otra"). La lógica de la trascendencia permite comprender mejor la estructura del Intertexto, donde la perspectiva newtoniana del tiempo y el espacio es revolucionada por el juego intertextual y por la relación lector-escritor.
Hablando de “contradicciones”, Vitali-Rosati se refiere al pensamiento de psicoanalista y lógico chileno Ignacio Matte Blanco, autor del libro Unconscious as Infinite Sets (Londres 1980), donde examina magistralmente la lógica del Inconsciente:
La lógica formal no basta para explicar el encuentro con la alteridad”,
En estas proposiciones es posible establecer nuevas analogías con el Intertexto, tejido con un conjunto de citas que encuentran su origen en la expresión del autor citado. Expresión que se manifiesta a través de un “para sí” auto-referencial: el escritor intertextual no “aplasta”, ocultándolo, al escritor citado, como ocurre en el plagio, práctica que destruye toda alteridad. Este “aplastamiento” (appiattimento) ocurre normalmente en la novela, que podríamos considerar, según la lógica de Riflessione e Trascendenza, como una forma reflexiva “inauténtica”, donde nunca se encuentra la alteridad. El escritor y el lector son irremediablemente separados. En cambio en el Intertexto, abierto al lector-escritor, la alteridad puede consolidarse estéticamente, “escrituralmente”. Es decir, “el hombre es, principalmente, escritura, concreción del lenguaje”, concluye Vitali-Rosati. Se abren así las puertas a una auténtica revolución en la comunicación humana en general y en la literatura en particular : el hombre comunicante, particularmente en el mundo digital, deja de ser una simple lector como en la novela, puede convertirse en “lector-escritor”, como en el Intertexto.
A principios de 2019, Sens Public publicó una entrevista del dramaturgo y director de cine, Peter Brook -”Presencia y Creación”- realizado en 2016 bajo el patrocinio de la Academy of Arts of New York por el pintor y arquitecto chileno, Pedro Pérez-Guillón. La entrevista, publicada simultáneamente en inglés, francés y español gracias al esfuerzo de Servanne Monjour y de su equipo SP en Montreal, se desarrolla principalmente en torno al teatro y las artes plásticas. De la literatura sólo se discute tangencialmente. Puesto que fui alumno de Peter Brook durante siete años (1979 -1986) en el Instituto Gurdjieff de París (bajo la dirección de Madame Jeanne de Salzmann y del Doctor Michel de Salzmann), me parece oportuno, útil y necesario, mirar mi trabajo teórico a la luz del pensamiento de quien es considerado uno de los hombres de teatro más importantes de nuestro tiempo, pero que permanecerá también en nuestra memoria como un guía espiritual. La dificultad es considerable, sobre todo porque el mecanismo de creación de la literatura narrativa -la novela en particular- es refractaria a un enfoque "espiritual", a diferencia de la poesía. Quizás podríamos considerar En busca del tiempo perdido como una excepción. El Libro del Desassossego del poeta portugués, Fernando Pessoa, también podría leerse como una obra de ficción narrativa donde la espiritualidad es intensamente perceptible por el lector atento. Esta obra, rara en la literatura occidental, es comparable por su profundidad a los escritos del poeta y maestro espiritual indio, Krishnamurti. Sorprendente coincidencia, ambos recurren constantemente al oxímoron como figura retórica, aunque difieren fundamentalmente en la medida en que Krishnamurti muestra un camino suave y tranquilo para lograr la presencia del ser dentro de uno mismo, mientras que Pessoa se queda en la constatación de la ausencia de esta presencia en el hombre común y se limita a poetizar su desesperación. Aun así, su obra constituye uno de los pocos ejemplos de alta espiritualidad en la literatura del siglo XX. Creación y presencia, en el sentido que Peter Brook habla en esta entrevista, parecen ajenos a la narración, especialmente cuando se trata de historias novelescas. ¿Hay algo auténticamente espiritual en Los hermanos Karamazov? ¿Podemos hablar de "espiritualidad" cuando Dostoievski introduce el personaje de Alyosha, el joven novicio y devoto de su moribundo starets, o cuando el novelista hace hablar al Gran Inquisidor para acusar a Cristo de no cumplir sus promesas? No hay que confundir “espiritualidad” y “beatería”. Los personajes dostoievskianos y sus diálogos sobre el cristianismo ortodoxo no son más "espirituales", a pesar de su pretendida libertad polifónica, que las reflexiones monofónicas de las novelas densamente psicológicas y materialistas de Jean-Paul Sartre o de Albert Camus. El Intertexto busca acercarse lo más posible a la autoconciencia del escritor y del lector. La “espiritualidad” se desarrolla en este nivel, el de la conciencia. Al introducir la intertextualidad como mecanismo central de narración, busco crear un conjunto de referencias que me permitan - como escritor- tomar conscientemente en cuenta los escritos de otros escritores dejando simultáneamente abierta una nueva proposición textual al lector quien, a su vez, puede utilizarla como un nuevo sistema de referencias, etc.
"Lo terrible de las universidades y escuelas de arte es que empiezan siempre por la forma”,
Termino esta crónica haciendo referencia a mi último libro, Teoría del Intertexto, donde reúno todas mis reflexiones al respecto, incorporando un ensayo final, Ejercicios de Teoría Literaria y Teoría del Intertexto. En este ensayo analizo, como lo hice en 2012 con el pensamiento de Bajtín, las ideas de Sophie Rabau sobre la teoría literaria. En substancia, para Sophie Rabau (profesora de literatura en la Sorbonne Nouvelle, que se convirtió en novelista y que por tanto niega lógicamente la realidad del Intertexto), la teoría literaria no es necesariamente útil: En otras palabras, ¿tejer aire con aire? En verdad, la teoría de la literatura, aunque a veces es muy abstracta, deja de serlo si se aplica a ejemplos concretos de la historia de la literatura. El Intertexto, dada su construcción, incluye, hasta cierto punto, su propia teoría, una teoría que tal vez será diferente de Intertexto en Intertexto. No existe una teoría única del Intertexto, podríamos decir que existen tantas teorías como Intertextos. Esta es también una de las diferencias esenciales con la novela, generalmente explicable por teorías globales externas a su textualidad, teorías que analizan las más diversas novelas utilizando siempre los mismos parámetros. Pero las teorías novelísticas son, en principio, externas a las propias novelas. Al novelista le preocupa narrar, no teorizar. Por otra parte, el escritor intertextual como lector-escritor está llamado a teorizar sobre su propio texto : incorpora la teoría literaria casi como un elemento narrativo más. Al hacerlo, lleva a cabo una verdadera autocrítica de su trabajo. El lector-escritor se sitúa a sí mismo en una perspectiva de “auto-conciencia ”. Es, por definición, más consciente que el novelista común y corriente, quien a menudo se pierde desastrosamente en las ficciones de su desarrollo textual. La "nueva literatura", conscientemente intertextual, apoyada sobre una "nueva edición", la editorialización, volverá a ser un medio valiosísimo para el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, como lo ha sido en los períodos más luminosos de la historia de la Humanidad.
|
C'est à partir de cette question décisive -la liberté de la littérature- qu'un manifeste pour une nouvelle littérature peut s'esquisser.
Non que la littérature ait vieilli -les grands classiques sont et seront toujours d'une parfaite actualité- mais parce que, précisément, la littérature contemporaine perd, de plus en plus, sa liberté. Cela est dû, en grande partie, à cette néfaste confusion qui s'installe partout entre la pratique littéraire et les pratiques commerciales...
La théorie du roman du savant russe Mikhaïl Bakhtine (1895-1975) est probablement l'analyse la plus profonde jamais réalisée sur le genre. Or, son extraordinaire érudition ne lui permit pas d'éviter le "proton pseudos" qui fragilise sa théorie : l'amalgame entre "littérature narrative" et la forme "roman". Son "erreur" appelle à une autre vision de la littérature et à la définition d'un nouveau genre narratif -l'Intertexte- dont la gestation est liée à la révolution cybernétique. Cette "dispute" esthétique est offerte au lecteur sous la forme d'un dialogue intertextuel qui représente (dans la mesure où la fiction joue aussi son rôle) un échantillon de l'Intertexte comme genre littéraire post-romanesque rendu possible par les nouvelles technologies et le plurilinguisme de l'Europe unifiée d'aujourd'hui.